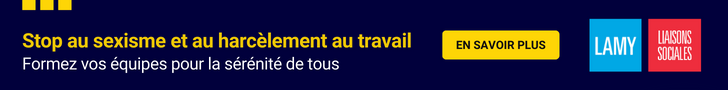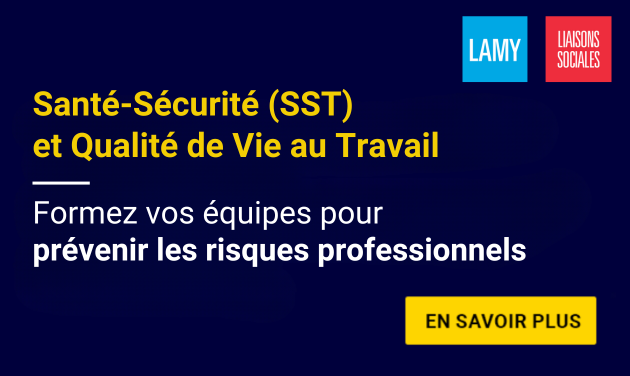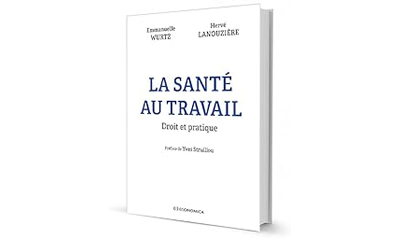Le point de vue d'une sociologue sur la judiciarisation des accidents
Après l'ingénierie et le droit, qu'en est-il du regard du sociologue ? La montée de la scène judiciaire participe-t-elle d'une mise en société des risques ?
Mont Saint-Odile, AZF... : depuis une vingtaine d'années, beaucoup d'accidents ayant occasionné des victimes et/ou des dommages de grande ampleur ont donné lieu à des procès retentissants. Pourquoi une telle importance de la scène judiciaire ?
À mon avis, l'importance de la scène judiciaire est à mettre en relation avec la montée de la société d'individus, dans ce que les sociologues appellent la seconde modernité, qui se traduit par l'émergence de l'individualisme, des droits de l'individu, de la force de la subjectivité, de la valeur de l'expérience singulière – en l'occurrence, dans le cas des catastrophes, l'épreuve et le vécu personnel – qui s'affirment face à la raison d'État et à ses prérogatives, face à l'intérêt général abstrait. Ceci étant, on se trouve dans une situation paradoxale, dans la mesure où les associations de victimes, toutes sans exception, affiche un engagement altruiste, audelà de la reconnaissance et de la réparation de leur épreuve personnelle. Il s'agit de faire en sorte que la catastrophe ne se reproduise pas pour d'autres – « plus jamais ça » – donc d'oeuvrer pour la prévention en partant de l'idée que la catastrophe était évitable, si les sécurités et les systèmes d'alerte avaient correctement fonctionné. Cette démarche de prévention des associations a pour objectif de mettre en évidence les dysfonctionnements et les responsabilités de l'accident survenu pour prévenir les autres. Il y a bien évidemment le désir de faire la lumière sur les circonstances de la mort de proches et de sanctionner les responsabilités.
La scène judiciaire est-elle la plus appropriée pour établir la « vérité » ?
La scène judiciaire n'est sans doute pas idéale, mais il n'y en a guère d'autres ! Les juridictions civiles sont vouées à la réparation des dommages et non pas à la recherche de la vérité. Et les victimes ont appris à ne pas compter sur les enquêtes administratives ou s'en méfient. La justice pénale a le double avantage d'être orientée vers la recherche de la vérité et d'être peu coûteuse.
Maintenant, il est clair que la vérité judiciaire ne coïncide pas nécessairement avec la vérité technique de la survenue de l'accident. Le magistrat pénal juge selon l'écart à la norme, le non-respect des procédures écrites ; or on sait que le fonctionnement optimal des organisations n'est justement pas celui de l'observation scrupuleuse des procédures, du travail prescrit. Le magistrat se trouve en outre très contraint par le Code de procédure pénale et par le catalogue des incriminations possibles, lui-même dépendant de l'état de la législation à un moment donné. Par exemple, on peut considérer la période du début des années 1990 comme favorable aux victimes, du fait notamment de l'introduction d'une nouvelle incrimination pénale, celle de la mise en danger délibérée d'autrui, de l'avènement de la responsabilité pénale des personnes morales, sans compter les droits obtenus par les associations, puis par leurs fédérations à se porter partie civile, ce qui a favorisé l'ouverture d'une série de procès très médiatisés.
À la fin de la décennie, on constate un retour du balancier : le personnel politique et de la haute administration s'est mobilisé pour limiter la mise en jeu de leurs responsabilités. La loi Fauchon du 10 juillet 2000 a sérieusement limité les possibilités de mettre en cause les auteurs indirects1 – c'est-à-dire qu'on a eu tendance à revenir à la responsabilité du lampiste, au contraire des efforts des associations visant à mettre en cause toute la chaîne des responsabilités, pour justement ne pas se satisfaire d'une justice du lampiste et du bouc émissaire.
On peut noter également la grande résistance des juridictions à mettre en jeu la responsabilité des personnes morales – du coup, le poids des procès en correctionnel pour homicides involontaires tend à retomber sur les épaules des individus, agents des institutions ou des entreprises impliquées.
L'appréhension d'un accident sous l'angle juridique permet-elle de comprendre réellement ce qui s'est passé et d'en identifier toutes les causes ?
Le problème, outre celui signalé plus haut, est que les effets de cette peur de l'incrimination du risque pénal sont difficiles à mesurer, tant du point de vue de la recherche des causes et des faits dans un accident précis, que du point de vue de ses effets en termes de comportements de prévention.
Toutes les associations de victimes font état de disparition de pièces (par exemple les enregistrements de salle de contrôle) au début des investigations. Le juge peut demander des expertises et il le fait bien sûr, mais il n'est pas simple pour un magistrat non versé dans la matière technique de savoir où orienter les investigations, quelles questions poser, etc.
Face à la menace du procès pénal, les institutions, les entreprises se rétractent et les individus se crispent...
En fait, on a en face à face deux vérités : celle des procès, la vérité judiciaire, et celle des rapports d'enquête postaccidentelle.
Peut-on dire que l'une est plus proche de la vérité que l'autre ? Ce n'est pas certain. Les expertises administratives peuvent aussi voir leur objectivité remise en cause, car les experts appartiennent au même milieu que les auteurs de l'accident, ils peuvent apparaître plus ou moins en connivence. Les freins à la connaissance de ce qui s'est passé peuvent être aussi fort dans une arène ou dans l'autre : voyez le procès d'AZF à Toulouse – ni le procès, ni les enquêtes techniques n'ont réussi à identifier les causes de l'accident, si bien que la plus grande catastrophe technologique que la France ait connu depuis 1945 n'a pas de causes connues !
Les victimes d'un accident ou leur famille demandent à la fois
une sanction des comportements, mais en même temps poursuivent
un objectif de prévention : « Plus jamais ça ».
Le procès pénal permet-il de remplir ces deux objectifs ?
Il arrive que le procès remplisse ces deux objectifs, comme ça a été le cas dans l'affaire du Drac, où au cours du procès, EDF a décidé de coopérer avec l'association de victimes en vue de la prévention. Mais ce n'est pas toujours le cas. Les victimes comptent sur l'effet salutaire de la peur du procès, mais pas seulement : l'instruction judiciaire est la seule façon pour elles d'accéder au dossier et d'identifier là où il faudrait faire porter l'effort de prévention.
C'est aussi souvent la seule façon pour elles de se reconnaître entre elles et de se regrouper pour agir collectivement.
Les victimes d'un accident collectif, par exemple de transport, n'ont aucun lien les unes avec les autres (comme pour un attentat), et il n'y a aucune structure qui soit chargée de les mettre en rapport les unes avec les autres après la catastrophe.
Elles doivent se débrouiller par elles-mêmes. Mais bien souvent, c'est finalement le procureur qui les réunit au moment d'ouvrir une procédure.
Il faut néanmoins souligner qu'il y a très peu de condamnations pénales effectives et encore moins à des peines lourdes comme la prison. La plupart des jugements distribuent des peines avec sursis. En réalité, la sanction du procès, c'est l'épreuve de la mise en examen et de la comparution au procès : la vraie peine pénale est là.
Et cet aspect est très douloureux et très lourd pour les personnes concernées.
Un effet pervers d'une sanction judiciaire suite à un accident est l'ouverture du parapluie, pour éviter à l'avenir tout engagement de la responsabilité. La perspective d'une responsabilité pénale devient un risque en lui-même. Cette tendance va à l'encontre de l'objectif d'amélioration de la sécurité.
1. Depuis la loi du 10 juillet 2000, qui a modifié l'article 121-3 du Code pénal, la responsabilité pénale de l'auteur indirect d'un dommage ne peut être engagée que si la faute est d'une exceptionnelle gravité ou en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
Partagez et diffusez ce dossier
Laissez un commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.