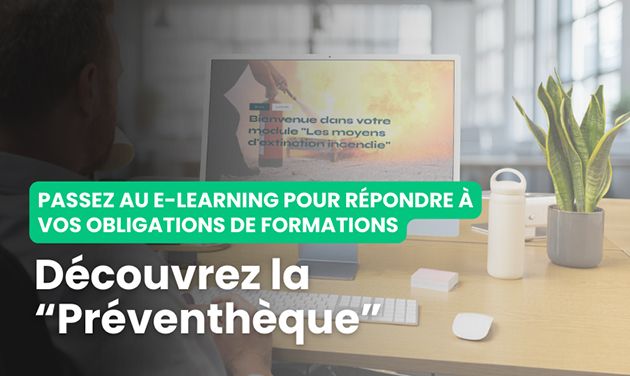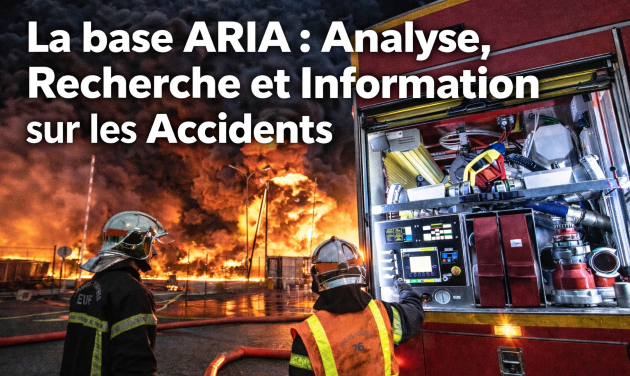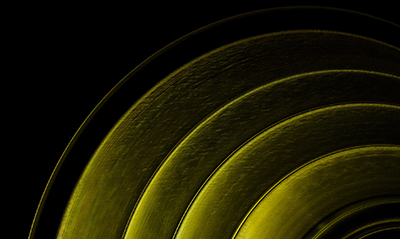La circulation interne en entreprise, à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments, constitue un risque constant souvent sous-estimé, car les facteurs qui contribuent aux accidents sont quotidiens et d’apparence banale et sont présents dans toutes les activités industrielles au point de représenter une grande part des accidents du travail.
La circulation interne en entreprise, à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments, constitue un risque constant souvent sous-estimé, car les facteurs qui contribuent aux accidents sont quotidiens et d’apparence banale et sont présents dans toutes les activités industrielles au point de représenter une grande part des accidents du travail : déplacements des piétons, des véhicules et chariots pour les approvisionnements des stocks, des chaines de fabrication, des chantiers du BTP, mouvements des camions de livraison sur les quais de transbordement, des automobiles dans les garages ou sur les parkings, sont responsables de collisions entre véhicules et heurts avec des personnes ou des obstacles, de chutes de charges, provoquant des traumatismes pouvant être graves voire mortels.
Chaque chef d’établissement doit analyser les flux de circulation interne et mettre en place un plan de circulation, qui limite les risques de collision, et prendre les mesures de prévention telles que : indiquer clairement, dégager et éclairer les allées et les voies de circulation, faire respecter les règles et les procédures (vitesse des véhicules, respect de la signalisation, cheminement des piétons dans les zones prévues,...), entretenir les sols des voies de circulation et vérifier le bon état des véhicules, dimensionner les aires d’évolution en fonction des flux des produits et des matériels qui doivent y circuler, améliorer la visibilité etc.
L’échange d’informations avec les entreprises extérieures intervenantes et la coordination des mesures de prévention avec elles sur les règles de stationnement et de circulation sont aussi très importantes car, les relations non formalisées, entre transporteur et entreprise d’accueil, sont en effet souvent sources de nombreux dysfonctionnements et malentendus qui peuvent créer des situations dangereuses.
Enfin, en matière de circulation interne comme pour la circulation routière, le facteur humain est prépondérant : l’implication des employés est à la base de la culture sécuritaire et les « erreurs humaines » sont souvent révélées lors des expertises des accidents de circulation interne, ce qui implique d’abord la nécessité d’une formation à la conduite spécifique et de perfectionnement approprié pour les caristes, conducteurs d’engins, mais aussi de développer la sensibilisation au risque de circulation interne de tous les travailleurs et leur responsabilisation lors des observations et des feedback sur les incidents ou accidents.
Situations à risques dans les circulations internes
La circulation interne en entreprise correspond à l’ensemble des déplacements des personnes et des transports et manutentions de matières premières, pièces détachées et produits finis, à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments et dans les locaux annexes.
Prés de 200 000 accidents de travail sont liés aux circulations internes dans l’entreprise soit un quart environ des accidents annuels.
C’est une activité difficile à maitriser, en raison du caractère varié des circulations à la fois dans leur parcours, leur modalité et leur intensité, des interférences avec les personnels d’autres services, fournisseurs, livreurs, clients ou public, de la variété et de la multiplicité des déplacements des chariots, des piétons, avec des caractéristiques différentes dans les vitesses, capacités de manœuvre : plusieurs catégories d’usagers peuvent se côtoyer avec des niveaux d’information différents sur les dangers éventuels. C’est aussi une activité intrinsèquement dangereuse, du fait des énergies cinétiques élevées mises en œuvre (fonction de la masse et de la vitesse au carré), générant potentiellement des accidents graves. C’est enfin une activité concernant un nombre important de personnes (conducteurs et travailleurs), car tous les secteurs industriels et logistiques (distribution, ports, aéroports, ...) y font appel, d’où la proportion élevée des accidents de circulation interne par rapport aux autres. Les risques concernent les collisions entre véhicules, les heurts de véhicules sur des travailleurs ou des obstacles, des freinages ou virages brusques d’engins qui mènent à la chute de la charge sur des personnes. Les dangers concernent donc non seulement les conducteurs d’engins ou les caristes mais également tous les travailleurs qui se trouvent à proximité, qui peuvent être heurtés par l’engin ou sa charge du fait de l’inattention, du manque de visibilité, ... Les situations à risques tiennent aux voies de circulation, aux véhicules et engins, à l’organisation des flux circulatoires et aux comportements humains : tous ces facteurs agissent de façon autonome mais aussi inter-dépendamment, et à chaque modification apportée à l’un d’entre eux, le risque d’accident est susceptible de changer lui aussi.
- Les voies de circulation
- La largeur et la géométrie de la voie
Les aires d’évolution en fonction des flux des produits et des matériels qui doivent y circuler sont parfois insuffisantes et/ou peu pratiques (virages trop serrés, rétrécissements, dénivelés...), ou les largeurs minimales concernant les voies de communication n’ont pas évoluées avec la nature et le gabarit des engins qui les empruntent : les croisements y sont difficiles avec des possibilités de collision, les personnes peuvent être coincées entre le véhicule et des murs, des éléments de structure de stockage, des machines, les espaces sont mal adaptés pour réaliser des manœuvres, des angles morts existent...
- Les encombrements
La circulation sur les voies peut être perturbée par des obstacles permanents (poteaux, piliers, tuyauteries...) ou temporaires (palettes, outils, bidons non rangés...), qui obligent à des contournements délicats ou provoquent des heurts. Fréquemment, les stationnements improvisés sont générateurs d’accidents, les zones d’attente sont mal localisées.
- L’éclairage et la visibilité
La qualité et quantité de lumière, le mode d’allumage, l’amplitude conditionnent grandement la visibilité des conducteurs et caristes. Les sources d’éclairage mal positionnées entrainent des zones d’ombre ou à contre jour.
- Le sol
Une assise peu solide, inégale, glissante (flaque d'huile, dépôt de graisse...) provoquent des embardées et cahots ou augmente les distances de freinage. Un mauvais écoulement des eaux et l’absence de revêtements des sols antidérapants entrainent des phénomènes de glissance. Des plaques de recouvrement des ouvertures ne correspondant pas ou plus aux poids en charge des engins sont aussi des facteurs d’accident.
La présence de verglas causé par l'absence de moyens de lutte (sable, sel de déneigement) ou la négligence est un facteur aggravant de danger dans les aires extérieures exposées.
- La signalisation
Des aires de circulation des piétons et des engins non ou mal matérialisées par marquage au sol des zones de cheminement, l’absence de panneaux indicateurs, de croisement, de limitation de vitesse, de priorité, l’absence de signalisation des zones à risque particulier et d’accès réglementés, génèrent un manque d’information ou de rappel des consignes très préjudiciable à la sécurité. - Les véhicules et engins
Les engins utilisés dans la circulation interne en entreprise sont très variés : véhicules lourds (camions de toute nature), véhicules légers, vélos et motocyclettes, chariots de manutention, transpalettes manuel ou électrique... La diversité de leurs vitesse, poids, gabarit, manœuvrabilité font de leur coexistence un facteur de danger. Le mauvais état de ces véhicules (freins, pneumatiques, direction, feux de signalisation, éclairage, moyens de calage, avertisseurs sonores ou lumineux), par défaut d’entretien et de maintenance, est un facteur d’accident. De même que l’absence ou la dimension insuffisante des rétroviseurs. - L’organisation des flux
La circulation à l’intérieur d’une entreprise est constituée de multiples flux dont la superposition, les interférences et la confusion entre piétons, engins et autres véhicules très différents entrainent des possibilités d’accidents de toute origine, lors des croisements, manœuvres...
On distingue :
- Les flux entrants de matières ou produits semi-finis,
- Les flux sortants de produits finis, de déchets,
- Les flux internes de matières, de pièces détachées, de produits, d’outils, d’emballages...
- Les flux du personnel ou du public (y compris pour se rendre dans des locaux annexes, remises, restaurant d’entreprise...), à pied ou en véhicule motorisé ou à vélo.
Les caractéristiques diverses de ces flux (vitesse, gabarit, manœuvrabilité), des contraintes imposées à ces mouvements (formalités, temps de chargement ou de déchargement, temps d’attente), des densités de circulation en fonction de l’importance du trafic dans un même lieu et à un même moment, entrainent des flux circulatoires complexes : l’absence ou la mauvaise analyse et gestion de ces flux a pour conséquence la majoration de la fréquence et gravité des accidents. De plus, l’évolution des productions (charges plus ou moins pondéreuses ou de plus grandes ou faibles dimensions, augmentation des volumes et des effectifs...) entraine aussi une évolution de ces flux qu’il faut prendre en compte, car cela modifie l’intensité et la nature du trafic. - Les facteurs humains et comportementaux
Le comportement des piétons et des conducteurs d’engins de manutention et de véhicules est fondamental car les dimensions psychologiques ou cognitives modifient leur perception du risque, augmentant la probabilité d’erreurs ou d’omissions humaines de toutes sortes.
- Indiscipline : non-respect des règles et des procédures, de la signalisation, des priorités, des passages piétons, stationnement sauvage, vitesse excessive, cheminement hors des zones prévues...
- Variabilité des critères d’aptitude des individus (morphologie, sexe, handicap, ancienneté dans l’entreprise, fatigue...).
- Organisation du travail générant précipitation, stress.
- Comportements addictifs : alcoolisme, drogues, médicaments psychotropes. Même de faibles alcoolémies, entre 0,25 et 0,5 gramme par litre, entraînent des modifications sensibles des résultats lors de tests psychotechniques et sensoriels. A partir de ce taux d'alcoolémie, le temps de réaction est plus long, la fréquence d'erreurs en réponse aux stimuli visuels ou auditifs plus forte et le champ visuel périphérique est rétréci.
Les effets des drogues sont variables suivant les classes médicamenteuses ou produits stupéfiants, mais il y a systématiquement des phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques récurrents tels la baisse de la vigilance, l’altération des capacités de jugement, les troubles de la mémoire, des capacités motrices, de la vision et des réflexes.
- Mauvaise coopération, notamment avec le personnel des entreprises extérieures. Les risques sont démultipliés lorsque plusieurs intervenants sont amenés à travailler simultanément, si la gestion de la sécurité n’est pas concertée entre les entreprises intervenantes et utilisatrices pour limiter les risques de « co-activité ». La formalisation des relations est complexe lorsque des livraisons ou des expéditions sont effectués par une entreprise extérieure, en particulier lorsqu'elle est nouvelle ou qu'elle intervient occasionnellement (difficultés de transmission des informations, indisponibilité de l'encadrement et du personnel de production ...). Les responsabilités en matière de sécurité peuvent devenir floues.
Les mesures préventives des risques des circulations internes
Pour diminuer les risques liés à la circulation interne en entreprise, il faut prendre une série de mesures préventives, ayant trait à la prévention organisationnelle (plan de circulation, règles et procédures...), technique (aménagement des voies et des locaux, entretien des engins...) et psychologique (sensibilisation, formation...), tant les mesures passives sont insuffisantes dans ce domaine et que les mesures actives portant sur le comportement du personnel sont importantes, à l’instar de ce qui se passe pour la circulation routière. Il faut souligner que le Code du Travail stipule dans l’article R 235-3.1.5 que " Les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre. ", et que des manquements graves à cette obligation peuvent mettre en jeu la responsabilité pénale de l’employeur en cas d'accident majeur.
- Les mesures préventives organisationnelles
- L’établissement d’un plan de circulation permet de déterminer le tracé des trajets effectués dans l’entreprise et leurs itinéraires et de lister les moyens de transport des marchandises et de déplacement des personnes.
Cela permet d’identifier les zones critiques des circulations (croisements multiples, ...), de prévoir des voies de décélération, d’accélération et ronds points giratoire, les zones de stationnement, l’emplacement des aires de chargement/déchargement, les zones interdites ou réservées à certains véhicules etc.
Le plan de circulation est à la fois un outil technique qui permet une vision globale de la circulation dans l’entreprise, mais aussi un outil d’information auprès du personnel, des entreprises extérieures amenées à intervenir à l’intérieur de l’entreprise (sous-traitants, maintenance ...).
- Diminution des déplacements
Diminuer le nombre de déplacements des travailleurs et des marchandises à l’intérieur d'un bâtiment ou d'un bâtiment à l'autre fait partie de ces changements organisationnels qui contribuent automatiquement à diminuer les risques liés au transport interne.
Diminuer les distances entre les points à desservir est également judicieux, en intervenant aussi sur l’emplacement des parkings, des bâtiments annexes, des locaux sociaux, des vestiaires, avec des chemins les plus courts possibles.
- Séparation des flux de circulation
La limitation du nombre de collisions passe par la diminution de leur probabilité : séparation (infrastructure et marquage) entre piétons et véhicules par des cheminements dédiés pour les différents moyens de transport (camions, chariots, cyclistes...), des portes séparées pour les passages piétons et véhicules, des parkings distincts VL, PL, deux-roues, engins de manutention, création de sens uniques, vestiaires se trouvant sur le chemin parking/poste de travail, ...
La séparation physique peut être complétée par une séparation temporelle : horaires d’accès différents à une zone de travail, arrêt momentané de certaines manutentions aux changements d’équipes...
- Protocole de sécurité
Le protocole de sécurité est obligatoire dès qu’une entreprise de transport de marchandises fait pénétrer un véhicule dans une entreprise d’accueil (quelle que soit sa taille) en vue d’une opération de chargement ou de déchargement, quels que soient le type de marchandises, le tonnage et la nature de l’intervention du transporteur.
Le protocole de sécurité comprend toutes les indications et informations utiles à l’évaluation des risques générés par l’opération et les mesures de prévention et de sécurité qui sont mises en place et qui doivent être observées. Il doit être tenu à la disposition des membres du CHSCT et de l’inspecteur du travail.
- Règles de circulation
Les consignes générales de circulation interne doivent être intégrées au règlement intérieur de l’entreprise : règles sur les manœuvres de demi-tours, marches arrière, priorités de passage, limitation de vitesse, distances de sécurité etc. Le règlement intérieur permet aussi de mettre en place un véritable « règlement alcool et produits illicites » de l'entreprise et d’interdire cette consommation dans l’entreprise formellement pour tous les conducteurs et caristes pour leur sécurité et celle d’autrui. Le dépistage d’alcoolémie est autorisé pour autant que la liste des postes de travail concernés, le rythme et les conditions de pratique des contrôles soient incluses dans le règlement intérieur.
- Conditions de travail
Une saine gestion de production rend compatible la pratique avec les règles de circulation interne, qui ne l’est pas ou peu lorsque d’autres priorités apparaissent contraignantes à l’excès : délais impératifs à respecter, aires de stockages saturées, retards de fabrication... - Les mesures préventives techniques
- Dimensionnement des aires de circulation
Les allées de circulation doivent être nettement délimitées et dégagées de tout encombrement et obstacle, et de largeur suffisante.
Préconisations :
|
Largeur minimum des voies de circulation |
Circulation à sens unique |
Circulation à double sens |
|
|
|
|
|
Piéton avec charge |
1,20 m |
2,00 m |
|
Transpalette manuel |
1,50 m |
2,50 m |
|
Transpalette électrique |
2,00 m |
3,30 m |
|
Véhicule léger |
3,00 m |
5,00 m |
|
Poids lourd |
4,00 m |
6,50 m |
|
|
|
|
° de largeur inférieure à 1,30m (charge comprise, soit une capacité petite ou moyenne) ; pour les fortes capacités, adopter des largeurs supérieures
- Equipement et entretien des aires de circulation
• revêtement au sol à la résistance adaptée aux sollicitations, antidérapant, sans trous.
• éclairage approprié des différentes zones, bien positionné
• marquage au sol des zones de cheminement bien clair
• ouvertures recouvertes de plaques encastrées au raz du sol conformes à la norme NF EN 124
• traitement du sol en cas de gel
• équipements d’aide à la visibilité (miroir) pour les zones aveugles
• suppression des obstacles et rectification des virages
- Equipement et entretien des engins
La présence et le bon fonctionnement des équipements de sécurité des véhicules et engins est indispensable : éclairage, avertisseur sonore et/ou lumineux de recul, freins, pneumatiques, direction, moyens de calage, rétroviseurs. Les chariots automoteurs sont soumis à trois types de vérifications :
• les vérifications lors de la mise en service,
• les vérifications lors de la remise en service après réparation ou accident (démontage, remontage ou modification pouvant remettre en cause la sécurité)
• Les chariots automoteurs doivent subir une visite générale périodique (à réaliser tous les 6 mois par un organisme compétent ou une personne qualifiée).
- La signalétique de circulation
Des pictogrammes de signalisation ou panneaux permettent d’aménager des cheminements sécurisés en attirant l'attention ou en signalant un danger spécifique à certains endroits (présence de produits dangereux stockés, repérage des obstacles ...). Ils doivent être identiques au code de la route pour les cas les plus courants, avec un logo spécifique sinon. L’efficacité de la signalisation dépend de son emplacement (endroit bien éclairé, facilement accessible) et doit être visible soit à l’accès à une zone pour un risque général, soit à proximité immédiate d’un risque déterminé ou d’un objet (poteau, tuyauterie...) à signaler.
Une signalétique redondante ou excessive est à proscrire (Ex : nombre excessif de panneaux à proximité immédiate les uns des autres, signal lumineux à proximité d'une autre émission lumineuse,....).
- Les mesures préventives comportementales
La bonne connaissance des engins, des lieux et des flux s’acquiert par des mesures d’information et de formation obligatoire ou complémentaire, mais ce n’est pas suffisant. La maîtrise des risques ne peut pas se concevoir sans prendre en compte la perception que les personnes concernées en ont. En effet, on a pu remarquer que, même si on informe les individus sur les risques auxquels ils peuvent être confrontés et si on leur donne les moyens d’y faire face, ces derniers n'en changent pas forcément leurs comportements.
C’est pourquoi, partir du principe qu'une fois l'information et la formation sont donnés, les comportements de sécurité s'effectueront de manière appropriée n’est pas du tout certain et il est nécessaire de développer aussi une conscientisation des risques liés à la circulation interne au sein de l’entreprise.
- Les mesures d’information
Le manque d’informations concerne en premier lieu les nouveaux embauchés, les intérimaires et le personnel de sous-traitance : il convient d’assurer qu’ils aient une connaissance suffisante du plan de circulation, des zones à risques particuliers, et une information sur les lieux et instructions (consignes de sécurité) à respecter...
- Les mesures de formation
La réglementation relative à l’utilisation des équipements de travail mobiles automoteurs (Code du Travail R.223-13-19) impose une obligation de formation au personnel susceptible de les conduire et une aptitude médicale. Une obligation de délivrer une autorisation de conduite incombe à l’entreprise pour les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté. Des stages de perfectionnement à la conduite permettent de maintenir les aptitudes à bon niveau.
- Les mesures de sensibilisation aux risques
Des techniques d’animation sont utilisées pour amener un groupe d’opérateurs à travailler sur des cas concrets d’accidents de circulation survenus dans l’entreprise et à identifier les bonnes pratiques qui auraient pu les éviter pour permettre à chacun des membres du groupe de travail d’être sensibilisé personnellement à la sécurité, de prendre conscience, exemples à l’appui, des conséquences résultant de l’absence de mesures de prévention adéquates.
On peut utiliser l’arbre des causes qui est une méthode d’analyse a posteriori d’un accident, pour en obtenir une description objective, reconstituer le processus accidentel, en identifiant tous les facteurs et leurs relations ayant concouru à sa survenance, de façon à proposer des mesures de prévention pour qu’il ne se reproduise pas et alimenter ainsi le processus de retour d’expérience. Au-delà de son apport à l’adoption de mesures préventives, la méthode de l’arbre des causes est un outil pédagogique très efficace pour la formation et la sensibilisation à la sécurité.
La formation à cette méthode est courte et, de la sorte, peut être dispensée aisément à de nombreux salariés, dont les membres du CHSCT.
Pour aller plus loin
Publication INRS : ED 975 « Circulation en entreprise », 2010, 88 pages
Mai 2012
Partagez et diffusez ce dossier
Laissez un commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.
Les avis des internautes
02/12/2021