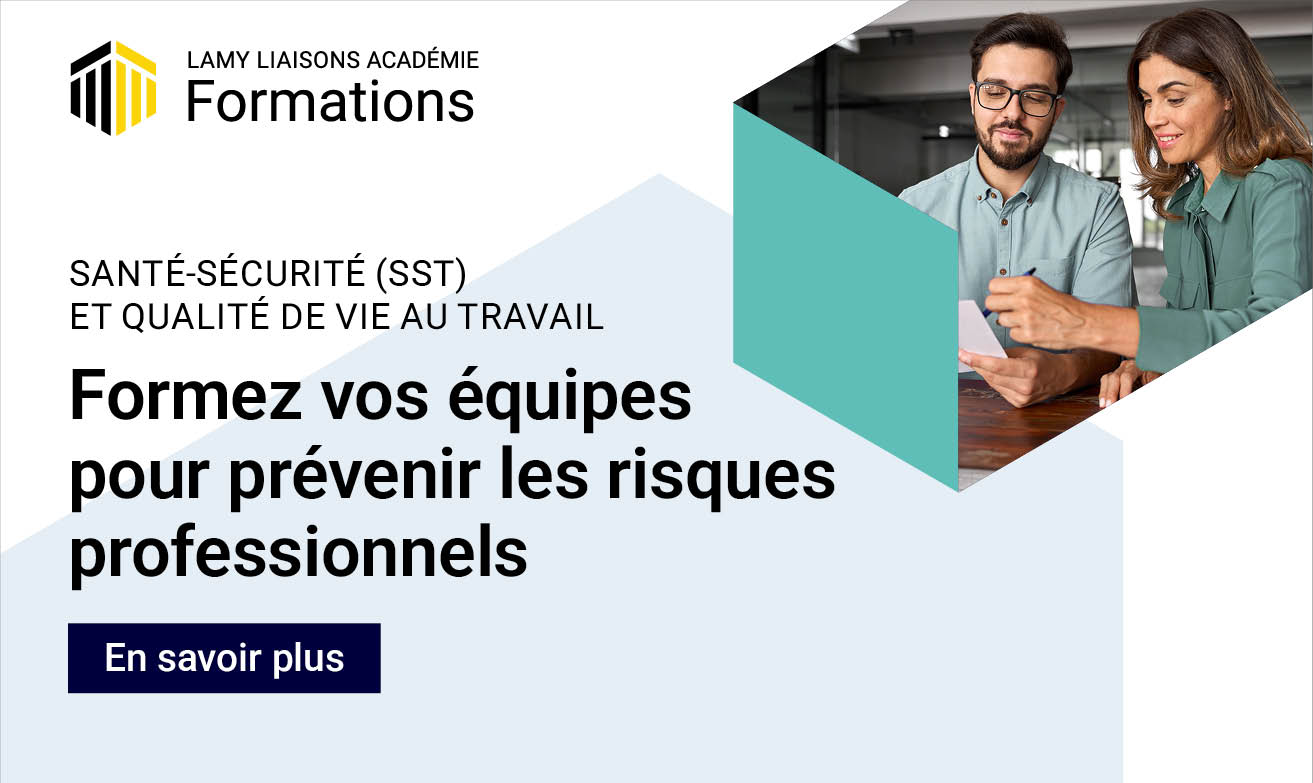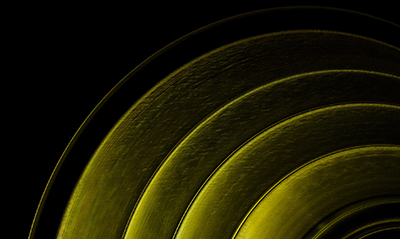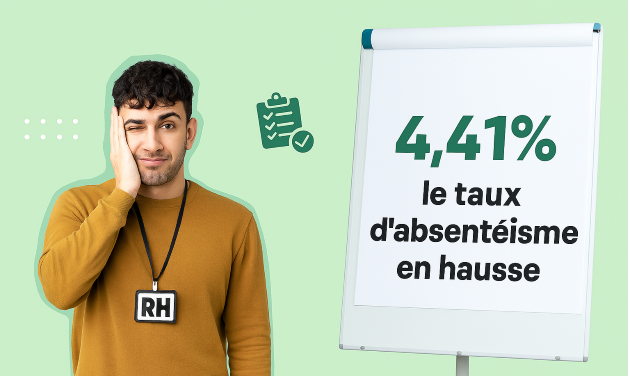- Accueil
- Organisation Ergonomie
- Risque chimique
- La prévention des risques professionnels des produits décapants
Les décapants sont des produits destinés à ôter des peintures et vernis, à nettoyer les façades, dégraisser les fours, grilles, filtres et conduits sont fréquemment utilisés par les peintres, façadiers, métalliers, fumistes... Les décapants ont des formulations variées mais très agressives et susceptibles de provoquer des intoxications par inhalation et de graves brûlures cutanées ou oculaires. Par ailleurs, certains décapants sont très inflammables et susceptibles de provoquer des incendies.
Les décapants sont des produits destinés à ôter des peintures et vernis de leur support en bois ou en métal, à nettoyer les façades, dégraisser les fours, grilles, filtres et conduits : ces produits décapants sont fréquemment utilisés par les peintres, façadiers, métalliers, fumistes... Les décapants ont des formulations variées à base de solvants organiques, ou de bases caustiques ou d’acides corrosifs, substances chimiques très agressives susceptibles de provoquer des intoxications par inhalation et de graves brûlures cutanées ou oculaires. Par ailleurs, certains décapants sont très inflammables et susceptibles de provoquer des incendies.
Compte tenu de leur grande dangerosité, des mesures de prévention sont indispensables pour l’utilisation des produits décapants : choix des produits ou procédés les moins dangereux, ventilation des locaux, port d’équipements de protection individuels (gants, vêtements, lunettes, masque éventuellement en milieu confiné), respect des règles de stockage et d’hygiène, information et formation des travailleurs exposés, surveillance médicale renforcée.
Pour augmenter la sécurité des postes de travail de décapage, des solutions alternatives pour remplacer des substances dangereuses existent, en particulier pour éviter l’utilisation du dichlorométhane ou chlorure de méthylène (DCM) dont le caractère cancérogène est suspecté : soit avec d’autres procédés que le décapage chimique (mécanique, thermique, cryogénique), soit avec des produits de substitution moins toxiques.
Les situations professionnelles d’utilisation des produits décapants
Les produits décapants sont très largement utilisés dans toutes les activités du BTP et de l’industrie :
- Le décapage des menuiseries intérieures ou extérieures (bois, métal) par les peintres avant remise en peinture.
- Le décapage de pierres, briques, béton des bâtiments anciens, pour le nettoyage des murs par les ravaleurs ragréeurs.
- Le décapage des fours industriels, grilles de cuisson pour le nettoyage des graisses souillées et carbonisées.
- Le décapage des conduits et de filtres par les maçons fumistes.
- Le décapage d'éléments métalliques avant soudure par les métalliers, plombiers, couvreurs.
- Les opérations de décapage des bijoux pour les bijoutiers et joaillers.
- Etc.
Sur les chantiers en milieu confiné (sous-sols, galeries souterraines, ...), le risque est considérablement accru et ce risque existe également pour le personnel travaillant à proximité des utilisateurs de produits décapants.
Les différents produits décapants et leurs principaux risques
Les produits décapants ont des principes actifs appartenant à trois classes principales : des solvants organiques, des décapants alcalins ou des acides forts.
Tous ces décapants contiennent des molécules très toxiques et/ou corrosives lors de leur application (par contact cutané ou inhalation), mais aussi lors de transvasement et de déconditionnement, de la manipulation de contenants mal fermés, ou dans les lieux de stockage, ou d’entrepôt de déchets, en dégageant des vapeurs. En cas d’inhalation massive suite à une fuite ou déversement importants en milieu confiné, une intoxication aiguë par les vapeurs de solvants ou de bases ou d’acides peut être redoutée.
- Les solvants décapants
Les solvants sont les plus couramment utilisés pour le décapage de peintures ou de revêtements de matières plastiques, sur tous supports. Ils ont pour objectif de ramollir le film de peinture ou de graisse et de casser les liaisons avec le support en formant des boursouflures permettant ensuite de les éliminer facilement par grattage mécanique.
Les principaux solvants employés dans les préparations de décapage sont le dichlorométhane (ou chlorure de méthylène) DCM, le diméthylsulfoxide DMSO, la N-méthylpyrrolidone NMP, le butanone (ou méthyléthylcétone MEK), des hydrocarbures (toluène, xylène, perchloréthylène...), des esters dibasiques, des alcools (benzylique, butylique...).
Ces solvants peuvent être mélangés dans la formulation du décapant en proportion diverse et associés à d’autres produits, comme des retardateurs d’évaporation (résines) et des tensio-actifs.
La toxicité des solvants organiques est le revers de leurs propriétés remarquables pour le décapage : ils dissolvent le revêtement du support mais ils sont aussi très volatils et donc aisément inhalables et capables de dissoudre les graisses de l'organisme et d’agir sur la conduction des influx nerveux. Lors de l'inhalation des vapeurs de solvants, celles-ci pénètrent dans les poumons et passent directement dans le sang, puis dans le cœur et le cerveau.
Les solvants organiques affectent des organes cibles divers : irritations et brulures (DCM) de la peau, des yeux (toluène ...) et de la gorge, lésions des organes respiratoires (toluène, perchloréthylène ...), et presque tous les solvants organiques provoquent des troubles digestifs (nausées, ...), du système nerveux, des maux de tête, des vertiges. Par leur action liposoluble, tous les solvants peuvent provoquer une dessiccation cutanée avec risque dermatites pour des contacts avec la peau répétés et prolongés.
Le dichlorométhane (DCM) est un agent cancérogène possible (classe 2B du CIRC). De plus, le dichlorométhane (ou chlorure de méthylène) est à l’origine de brûlures cutanées graves et est particulièrement narcotique : la toxicité sur le système nerveux central peut prendre la forme d’une narcose brutale et intense pour une forte exposition, qui empêche toute tentative de retrait de l’exposition sans un secours externe rapide. L’intoxication au DCM est reconnue dans le tableau n°12 du Régime Général des maladies professionnelles (affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés).
La gravité de l’exposition aux risques d’émanations toxiques de ces solvants dépend :
- de la toxicité de la molécule chimique concernée,
- de la concentration, de la fréquence et de la durée d’exposition, en particulier en milieu confiné,
- de la voie d’exposition (respiratoire, cutanée, oculaire, digestive),
- des combinaisons entre les produits,
- de la sensibilité individuelle : l'exposition aux solvants est tout particulièrement dangereuse chez la femme enceinte car ceux-ci peuvent franchir la barrière placentaire.
Les décapants contenant des solvants sont inflammables. Les risques d'incendie et d'explosion dépendent des caractéristiques physico-chimiques de chaque solvant : les solvants ayant un point d’éclair bien inférieur à la température ambiante, en présence d’une flamme nue, d’une étincelle ou d’une source de chaleur importante, s’enflamment instantanément et durablement.
L'atmosphère explosible est rendue possible à des températures voisines de la température d’inflammation des solvants et peut rendre chaque usine, chaque atelier, chaque stock de solvants dangereux, par suite de circonstances accidentelles : incident de fabrication ou de conditions de stockage provoquant fuites et déversements massifs, étincelles, arcs électriques venant de machines ou d’installations électriques défectueuse, charges électrostatiques formées par frottement dans les tuyaux ou par agitation ... C’est ainsi que les transvasements de solvants sont des manipulations dangereuses.
Les principales conséquences dangereuses consécutives à l’explosion ou à l’incendie sont les traumatismes liés au blast, et les brûlures. - Les décapants alcalins
Des bases fortes, par exemple pour le décapage de pierres et de peintures, peuvent être utilisées à froid ou à chaud : ce sont des solutions aqueuses de soude ou de potasse ou sous forme de poudres ou pâtes épaississantes, qui décomposent la peinture en profondeur, ce qui permet le décapage de plusieurs couches de peinture en une seule application ou qui détruisent les micro-organismes déposés sur les revêtements.
La très forte alcalinité de ces préparations les rendent particulièrement caustiques, à l'origine d’irritations et d’ulcérations parfois sévères de la peau ou des muqueuses oculaires ou respiratoires en cas de contact cutané ou d’inhalation ou de projections dans les yeux, avec parfois atteinte de la cornée. - Les décapants acides
On utilise des acides forts, pour le décapage de béton, d’aluminium ou d’acier inoxydable, pour le décapage des fours : acide chlorhydrique, sulfurique pour les métaux ferreux, fluorhydrique, nitrique, phosphorique ... Ces acides décomposent le film du revêtement en créant un déchet supplémentaire dangereux.
Ces préparations sont extrêmement corrosives en exerçant une action destructive sur les tissus vivants au contact : brûlures cutanées immédiates ou retardées parfois profondes et extensives, gêne respiratoire jusqu’à de graves irritations des muqueuses respiratoires avec possibilité d’œdème pulmonaire, lésions oculaires sévères, avec apparition éventuelle d’opacités cornéennes et de cataractes.
Les mesures préventives des risques des produits décapants
La vigilance des dangers chimiques auxquels sont exposés les utilisateurs de décapants est d’autant plus importante que la dangerosité de ces produits a provoqué de nombreux accidents du travail, dont certains mortels, notamment avec le chlorure de méthylène ou dichlorométhane (DCM).
L’évaluation du risque d’exposition pour les personnes manipulant les produits décapants doit tenir compte de plusieurs facteurs, déterminant la gravité du risque :
- la voie d’exposition par contact direct ou par voie aéroportée,
- la forme de présentation du produit : produit concentré ou dilué, forme liquide, gel ou poudre ;
- les caractéristiques physico-chimiques du produit : par exemple la présence de composés organiques volatils, l’acidité ou l’alcalinité...
- les conditions d’utilisation du produit : décapage manuel au pinceau en milieu ouvert ou confiné, utilisation de bacs ouverts de décapage ou de bains de trempage et solutions, émanations de vapeurs, possibilités de projections, déchets imprégnés ...
- les facteurs environnementaux : à l’intérieur ou à l’extérieur, chaleur, vent, ...
Les informations relatives à la toxicité de chaque décapant doivent faire partie des indications répertoriées dans la fiche de données de sécurité (FDS), obligatoirement fournie par le fabricant du produit et figurant sur les étiquettes des emballages sous forme de symboles et d’informations écrites (phrases de risque R et conseils de prudence S).
La prévention passe d’abord par la mise en place de techniques qui permettent la suppression des décapants les plus dangereux et l’emploi de produits de substitution ou de procédés de décapage moins dangereux.
Les moyens de prévention à mettre en œuvre pour pallier les risques professionnels des décapants résident ensuite dans la prévention collective, ventilation efficace de l’atelier, stockage des produits chimiques et installation électrique et de protection incendie conformes aux normes, respect des règles générales d’hygiène...) qui diminue fortement les expositions et la fréquence ces accidents, puis dans la prévention individuelle (équipements de protection) qui en diminue nettement la gravité, enfin dans l’information et la formation à la sécurité des travailleurs et dans leur surveillance médicale.
Une surveillance médicale renforcée est obligatoire pour les salariés exposés aux risques chimiques des produits décapants.
- La suppression / substitution des produits et procédés les plus dangereux
La prévention la plus efficace est la prévention primaire avec la mise en place d’actions sur les produits (suppression ou emploi de produits de substitution de moindre impact potentiel sur l'homme et l’environnement) et/ou des actions sur les procédés.
La première étape consiste à repérer les décapants cancérogènes ou très dangereux dans le cadre de l'évaluation des risques du Document Unique de Sécurité (DUS). Les Fiches de Données de Sécurité (FDS), obligatoires pour tout produit chimique dangereux, comportent les renseignements relatifs à la toxicité des produits, donc notamment leur caractère cancérogène éventuel.
L’utilisation de certains solvants est désormais interdite. La législation évolue en fonction des résultats des études toxicologiques qui peuvent être très longues car, si pour la toxicité aigue, le rapport de causalité est clairement identifié et assez facilement mesurable, il n’en est pas de même pour la toxicité chronique qui est beaucoup plus malaisée à cerner avec précision.
La suppression des solvants organiques et leur remplacement par une technologie propre (nouveaux procédés ou produits) lorsque c’est techniquement et économiquement possible ou leur substitution par des solvants beaucoup moins toxiques apparaissent comme des solutions prioritaires : notamment remplacer le dichlorométhane, utiliser les produits les moins volatils (pression vapeur plus faible), et, pour limiter le risque d’incendie, travailler si possible avec des produits dont le point éclair est supérieur à 40° voire 55°C. Des fiches d’aide à la substitution sont disponibles sur le site de l’INRS.
- Substitution des produits
Le dichlorométhane (chlorure de méthylène DCM), solvant utilisé comme décapant à peinture et vernis, peut être remplacé par des procédés à chaud sans solvant ou d'autres procédés chimiques à cause de ses effets très nocifs. Néanmoins, il faut tenir compte du fait que les produits alternatifs au dichlorométhane ont une action plus lente et ne sont pas non plus dénués d’effets toxiques : esters dibasiques, diméthylsufoxyde (DMSO, syndrome ébrieux), n-méthylpyrrolidone (NMP, irritant cutané), alcool benzylique ...
Depuis 2012, les décapants pour peinture contenant du dichlorométhane à une concentration supérieure ou égale à 0,1 % en masse ne doivent plus être utilisés sur les chantiers du BTP : la poursuite de son utilisation en tant que décapant par des professionnels spécifiquement agréés est possible dans les cas où le remplacement du dichlorométhane est jugé particulièrement difficile ou inapproprié pour certaines utilisations industrielles.
Pour les opérations de dérochage en bijouterie, substituer l’acide sulfurique par des sulfamates.
En règle générale, substituer les décapants contenant de l’acide fluorhydrique (ravalement des façades, trempage en bijouterie ...).
Choisir le mode d’application le moins émissif, par exemple un décapant chimique en gel à la brosse plutôt que liquide utilisé en aérosol.
Choisir des décapants associés avec des retardateurs d'évaporation.
- Substitution du décapage chimique
Le décapage mécanique, thermique, cryogénique sont des solutions alternatives après une analyse de la faisabilité technique, économique et de la prise en compte des exigences sécuritaires nouvelles induites par ces procédés qui ne sont pas eux-aussi exempts de nombreux risques.
Les différentes techniques de décapage mécanique par frottement de la pièce à décaper avec un abrasif (sablage, ponçage, grenaillage ...) exposent à des aérosols de débris du revêtement et aux poussières des agents utilisés : la présence, dans les vapeurs et brouillards générés lors du décapage, de particules toxiques telles que des poussières de revêtements pulvérisés par la projection abrasive contenant de la silice cristalline (grès, granits...), ou du plomb (minium des peintures anticorrosion anciennes) présente un risque respiratoire et de projection oculaire.
Lors des opérations de sablage des façades, pour limiter ce risque, on peut utiliser des matériaux de substitution tels que le corindon, ou les médiaplastiques, ou des media naturels provenant de coquilles ou de noyaux de fruits,
Le décapage thermique, au moyen d’une lance thermique alimentée par des brûleurs au gaz propane ou par immersion dans un four à pyrolyse, expose aux fumées de dégradation thermique du gaz et des revêtements, et aux brulures. C’est un procédé plus couteux et qui n’est pas utilisable pour le bois.
Pour des applications particulières de nettoyage des pièces mécaniques, le décapage cryogénique par pulvérisation, au moyen d’une lance, de particules de glace carbonique, le décapage plasma ou laser permettent de s’affranchir de produits solvantés, mais ce sont des procédés très onéreux. - La prévention collective
La recherche de substituts aux décapants chimiques peut être difficile dans de nombreux cas pour lesquels c’est le procédé le plus efficace et le moins couteux, et alors, la connaissance des risques induits par les produits permet de mettre en œuvre des mesures de prévention collective et individuelle adaptées.
- La limitation des vapeurs de décapants dans l’air
La ventilation du local de travail, et le captage éventuel des vapeurs de décapants à la source et rejet à l’extérieur du local doit assurer un renouvellement d'air en permanence afin de limiter les risques pour la santé. La ventilation et l’aération des lieux de travail jouent un rôle essentiel pour limiter la concentration de l'ensemble des vapeurs dans l'air ambiant et les évacuer des lieux de travail, de façon à respecter les valeurs limites d’exposition.
La limitation de la propagation des vapeurs des décapants et des poussières dans l’air et par suite l’exposition des travailleurs à leur inhalation, passe par les dispositions suivantes :
- Assurer une concentration dans l’atmosphère de l’atelier la plus basse possible par une aération satisfaisante.
- Ouvrir les bidons, pots, de décapants seulement lors de leur utilisation et bien les refermer après.
- Stocker les contenants de décapant hermétiquement fermés en dehors des périodes d’utilisation dans un local ventilé muni d’un extincteur et fermé à clé.
- Maintenir fermées les poubelles étanches contenant les objets souillés par les décapants (chiffons, pinceaux usagés...)
- La manipulation des produits décapants
Des mesures de prévention sont indispensables pour la manipulation des produits décapants. Il convient de respecter les dosages et les modes opératoires et n’effectuer ni transvasement ni déconditionnement, ni mélange de décapants.
- Le stockage des produits décapants
Le stockage des produits doit être effectué dans les locaux prévus à cet effet, correctement ventilé, dans un endroit frais et sec et fermant à clé. Il sera limité aux quantités requises pour une période déterminée. Aucun matériel ou produit ne devra être abandonné en dehors des emplacements autorisés ou laissé sans rangement après chaque intervention.
Des procédures de stockage non adaptées peuvent entraîner une fragilisation des emballages à l'origine de fuites ou de ruptures accidentelles, de pollutions.
Le stockage des bidons et autres conteneurs de décapants, doit se faire sur cuvette de rétention, et les récipients doivent toujours être bien refermés.
L’interdiction de fumer dans les locaux doit être absolument respectée et signalée de manière apparente (de même que toutes les autres consignes de sécurité).
Il convient également de limiter au maximum les quantités stockées et n’entreposer dans les ateliers que les quantités de produits ne dépassant pas celles nécessaires au travail d'une journée.
- Le respect des règles d’hygiène et de sécurité
Des lavabos, postes de rinçage oculaire et des douches de sécurité doivent se trouver à proximité des postes de travail.
Celles-ci permettent les mesures d'hygiène générale : lavage des mains fréquent avec lave-mains à commande non manuelle (au genou, au coude, électronique), douche en fin de poste... En effet, le respect des règles d’hygiène s’étend aux comportements individuels : ne pas avoir les mains sales afin de ne pas ingérer par inadvertance un produit toxique et ne pas manger sur le lieu de travail.
Le personnel doit avoir à sa disposition des vestiaires et des sanitaires correctement équipés et en nombre suffisant. Des vestiaires doubles doivent être mis à la disposition des travailleurs : l’entreposage des tenues de travail doit avoir lieu à l’abri de la poussière et des souillures (le rangement des tenues de ville et des tenues de travail doit être séparé).
Les consignes en cas d'accident (n° d'appel d'urgence, conduite à tenir, identification des services de secours) doivent être visiblement affichées.
Une trousse contenant le matériel de premiers secours non périmé doit être mise à la disposition du personnel, toute blessure cutanée doit immédiatement être désinfectée et pansée. Une projection oculaire de décapant est une urgence ophtalmologique.
- La prévention individuelle
Les équipements de protection individuelle sont nécessaires pour réduire le risque d’exposition non totalement éliminé par les mesures de protection collectives précédentes : gants, vêtements de protection, lunettes de sécurité, différents et adaptés à la tâche effectuée et au produit utilisé.
- La protection des mains
Il s’avère indispensable de porter des gants de protection adaptés au produit : l’étiquetage du produit à manipuler comporte les phrases de risque R27 (très toxique par contact avec la peau), R24 (toxique par contact avec la peau), R21 (nocif par contact avec la peau), R34 (provoque des brûlures) et R35 (provoque de graves brûlures).
Le type de gants conseillé, imperméables, à longues manchettes, pour éviter la pénétration des produits à l’intérieur, doit être adapté aux différents produits manipulés, notamment pour la résistance aux acides, selon leur composition qui figure sur la Fiche de Sécurité (FDS). Les gants en nitrile, polychloroprène, butyle sont les plus utilisés lors de la manipulation des solvants, des acides et autres produits utilisés dans le décapage chimique.
- La protection du corps
La tenue de travail consiste en une combinaison imperméable de protection chimique avec manches longues ajustées au cou, aux poignets et aux chevilles.
- La protection des yeux
Il convient de se munir de lunettes de protection s’il y a un risque d’éclaboussement, lors par exemple de manipulation en force de contenants (ouverture difficile ...) ou lors de travaux en hauteur avec risque de coulure.
- La protection respiratoire
La protection respiratoire pendant l’application de décapant est nécessaire en cas de travaux en local confiné : port d’un masque filtrant à cartouche à adapter selon le décapant.
Les appareils respiratoires autonomes peuvent être utilisés par des personnes formées à cet usage pour porter secours en cas d’émissions massives toxiques et d’incident respiratoire aigu. - Une surveillance médicale renforcée
Pour les travailleurs exposés aux produits chimiques dangereux, il faut effectuer une traçabilité au travers de la rédaction d’une fiche d'exposition et d’une surveillance médicale régulière, à visée de dépistage, réalisées par le médecin du travail. A sa sortie de l’entreprise, le travailleur exposé doit recevoir une attestation d’exposition qui lui permettra de continuer à se faire suivre médicalement.
Les modalités générales de la surveillance des travailleurs exposés à des agents chimiques dangereux sont les suivantes :
- Suivi médical et toxicologique régulier, au moins annuel (exemples : détection des irritations cutanées, tests respiratoires, hématologiques, ...).
- En cas d'anomalie, tout le personnel concerné doit bénéficier d'un examen médical.
- Fiche d'aptitude avec mention de l'absence de contre-indications médicales à l'exposition au risque après étude du poste de travail.
- Le dossier médical doit stipuler la nature du travail effectué, la durée des périodes d'exposition et les résultats des examens médicaux. Ces informations sont indiquées dans l'attestation d'exposition et le dossier médical doit être conservé après la cessation de l'exposition.
Les modalités générales de la surveillance des travailleurs exposés à des agents chimiques cancérogènes, sont précisées dans le Code du travail (décret n°2001-97 du 1er février 2001, décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 et n° 2004-725 du 22 juillet 2004) et (Article R. 4412-40 du Code du Travail) : fiche d’exposition aux produits CMR (Cancérogènes, Mutagènes et Reprotoxiques) et liste des salariés exposés aux produits chimiques dangereux. - La formation et l’information du personnel
La formation, par un organisme agréé, sur les dangers des produits utilisés et sur les moyens de se protéger, est indispensable : par exemple, comprendre les étiquettes du contenant des produits, informer sur le risque potentiel de maladies cutanées et pulmonaires et sur les moyens de les prévenir, connaître l’attitude à adopter en cas de fuite ou de déversement accidentel, savoir utiliser les E.P.I adéquats, règles de sécurité lors des manipulations des produits chimiques dangereux.
De même, la formation aux premiers secours (projections, blessures et incendie) est nécessaire. - Une gestion des rejets et des déchets réglementaire
Les déchets et résidus liquides (diluants usés...) ou solides (chiffons sales, pinceaux usagés ...) doivent être entreposés dans des récipients munis de couvercles étanches maintenus fermés.
Les rejets atmosphériques de vapeurs de solvants sont fortement limités et réglementés dans le cadre de la directive européenne concernant les composés organiques volatils (directive COV 1999/13/CE).
Les déchets souillés de solvants organiques ne doivent pas être rejetés dans le milieu naturel. Ils doivent :
- Soit être recyclés par distillation, que ce soit au sein de l'entreprise ou à l'extérieur par un prestataire, en vue de leur réutilisation dans le même procédé.
- Soit être détruits par incinération dans des centres de traitement spécialisés avec récupération d'énergie. Les Bordereaux de Suivi des Déchets Industriels (B.S.D.I.) attestent de la collecte des déchets par des entreprises autorisées, et de leur élimination conforme.
Juillet 2014
Partagez et diffusez ce dossier
Laissez un commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.
Ces dossiers pourraient vous intéresser
Identification HSE
Créer mon compteNos rubriques
- Salons, Livres et Edition
- Malveillance
- Logiciels & applications de sécurité
- Ergonomie au poste de travail
- Risque électromagnétique
- Psychologie du travail
- Organismes agréés de contrôle
- Rayonnements
- Ventilation, aération, filtrage et appareils de contrôle d'atmosphère
- Sécurité pour appareils à pression
- Materiel de signalisation
- Signalétique
- Outils anti-coupures
- Risque biologique
- Risque chimique
- Risque éléctrique
- Manutentions
- Etiquetage produits dangereux
- Prévention des Chutes
- Document Unique
- Mise en conformité machines - Dispositifs de protection - Equipements de stockage