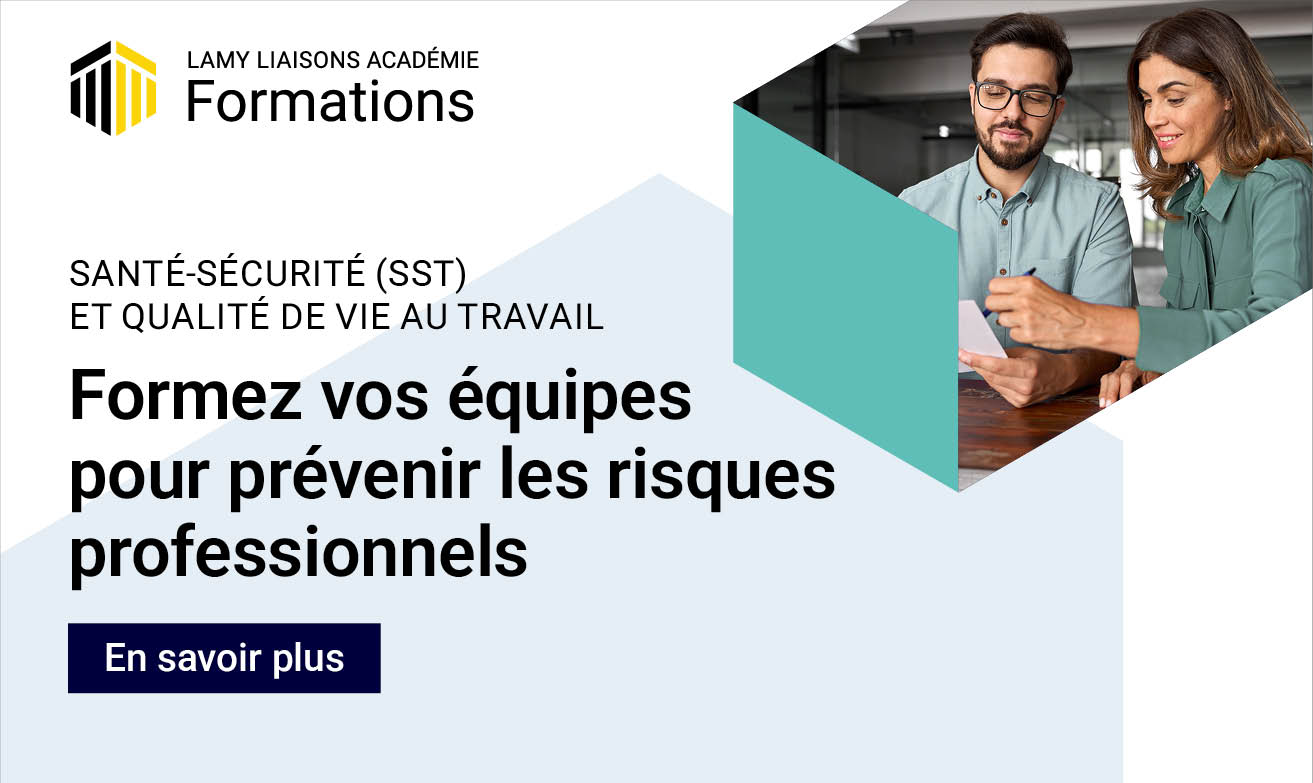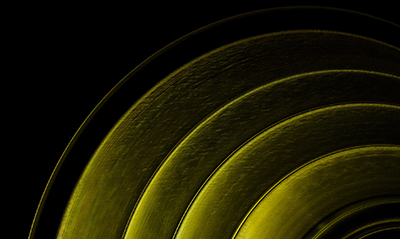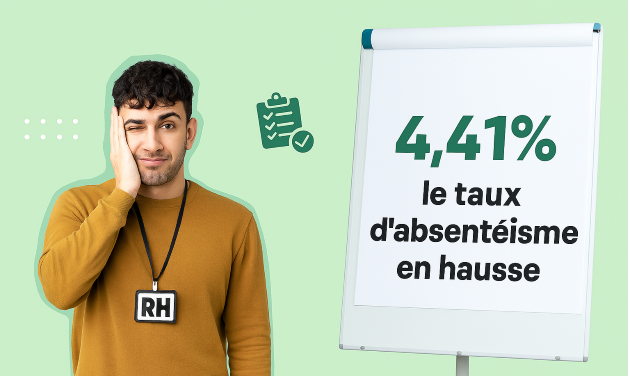Parmi les gaz toxiques, les gaz asphyxiants sont parmi les plus fréquemment rencontrés en milieu professionnel et les plus souvent mortels. L'asphyxie, privation en oxygène de l'organisme, provoque des graves malaises et de sérieuses conséquences respiratoires pouvant aller jusqu'au coma et être mortelles.
Parmi les gaz toxiques, les gaz asphyxiants sont parmi les plus fréquemment rencontrés en milieu professionnel et les plus souvent mortels. L'asphyxie est la privation en oxygène de l'organisme avec perturbation de tous les processus respiratoires entrainant une hypoxie (diminution de la quantité d'oxygène) ou une anoxie (absence d'oxygène) : l'asphyxie par manque d'oxygène provoque des graves malaises et de sérieuses conséquences respiratoires pouvant aller jusqu'au coma et être mortelles. La difficulté ou l'arrêt respiratoire peuvent être induits par un obstacle mécanique (inondation des voies aériennes, compression laryngée ou thoracique…) ou par des produits asphyxiants (gaz ou vapeurs) qui agissent en perturbant l'oxygénation des tissus :
- asphyxiants simples qui ne provoquent pas d'autres effets sur l'organisme que la privation d'oxygène dans des atmosphères présentant une carence en oxygène. C'est le risque typique du travail en espace confiné : le gaz carbonique CO2 (cuves, fosses, silos, galeries souterraines, puits, cales de bateaux, citernes), les hydrocarbures gazeux ou vapeurs de liquides hautement volatils en fortes concentrations (méthane, éthane, propane, essences …), émis par une fuite d'une canalisation dans une fosse ou un réservoir, ou répandus au sol par rupture du contenant ou déversement accidentel.
Le dégagement du dioxyde de carbone (CO2) est dangereux, non seulement du fait du risque d'asphyxie, mais aussi parce que celui-ci est imperceptible (inodore, incolore) et plus lourd que l'air, ce qui lui permet de se concentrer au fond. Le méthane, incolore, inodore, est asphyxiant et de plus inflammable, avec risque d'explosion à des fortes concentrations.
- asphyxiants biochimiques qui empêchent le transport de l'oxygène et la bonne oxygénation du sang ou encore l'oxygénation des tissus. C'est le risque typique des combustions incomplètes et notamment des installations de chauffage et des moteurs à combustion émettant du monoxyde de carbone (CO). Les méthémoglobinisants utilisés dans les industries chimiques (dinitrobenzéne, dérivés du toluène et de l'aniline), les cyanures inhalés lors de fumée d'incendie, de résidus de la combustion (acide cyanhydrique) ou utilisés en électrolyse avec des bains cyanurés, se fixent sur le fer chargé de transporter l'oxygène dans le sang et provoquent l'asphyxie. Le sulfure d'hydrogène (H2S), produit notamment par digestion anaérobie des matières organiques ou par incinération (pyrolyse du charbon …) mais utilisé aussi comme réactif chimique, entraine une hypoxie cellulaire et peut conduire à un arrêt respiratoire mortel. En milieu professionnel, les sources d'exposition sont nombreuses, mais par des mesures de prévention collectives appropriées, notamment la ventilation, les moyens de signalisation et d'évacuation, de contrôle d'atmosphère, et par des moyens de prévention technique individuelle (appareils de protection respiratoire), on peut réduire toutes ces expositions et diminuer fortement les risques professionnels des gaz asphyxiants industriels.
Les différents gaz asphyxiants industriels
L'hypoxémie par l'inhalation de gaz, diminution de la quantité d'oxygène transportée dans le sang, peut résulter de l'action irritante, caustique et corrosive de certains gaz et vapeurs irritant le poumon (SO2, NO2, Cl, NH3 …) ou bien dans le cas des gaz asphyxiants, ceux-ci agissent directement en perturbant l'oxygénation des tissus sans endommager le poumon. Il y a deux types de gaz asphyxiants, les gaz asphyxiants simples et les gaz asphyxiants biochimiques :
- Les gaz asphyxiants simples
Si des gaz remplacent l'oxygène qui se trouve normalement dans l'air, l'inhalation en quantité élevée de ces gaz même biochimiquement inertes, par simple dilution du pourcentage de l'O2 dans l'air inspiré, diminue l'oxygénation des tissus. Ce risque d'asphyxie peut se produire en cas d'émissions de gaz ou de fuite dans une atmosphère confinée ou d'inhalation directe par erreur. Ces gaz sont souvent incolores et inodores et ne présentent aucune caractéristique de détection. Ces gaz, le dioxyde ce carbone (gaz carbonique), l'azote, le méthane, l'éthane et le propane par exemple, sont de simples asphyxiants qui ne provoquent pas d'autres effets sur l'organisme que la privation d'oxygène : ces gaz peuvent être tolérés à de faibles concentrations dans l'air inspiré sans manifestation, mais la concentration en oxygène ne doit jamais être inférieure à 19% environ par volume d'air. L'air respirable contient environ 21 % d'oxygène et en deçà d'une teneur d'environ 17 %, les premiers signes d'asphyxie (perte de connaissance ou de motricité) apparaissent, sans signe précurseur. De faibles teneurs en oxygène peuvent entraîner des symptômes comme une respiration rapide, une fréquence cardiaque élevée, de la maladresse, une panique et de la fatigue. À mesure que la teneur en oxygène s'affaiblit, on peut observer une tachycardie, une arythmie, une hypotension, des nausées et des vomissements, des céphalées et vertiges, des convulsions, le coma et la mort. Une perte de conscience ou la mort peut survenir peu de temps suite à l'exposition d'un simple asphyxiant, très rapidement si le travailleur présente des besoins en oxygène majorés en cas d'effort physique, et/ou si cette diminution de l'O² dans l'air est de plus potentialisée par l'inhalation de poussières dans les voies aériennes qui contribuent fortement à les obstruer et à empêcher les échanges gazeux au niveau des poumons.
Avec la chute de la concentration en oxygène s'installe donc des perturbations neurologiques et des troubles cardio-vasculaires graves, ainsi que des perturbations comportementales aiguës qui nuisent par ailleurs aux conditions de sauvetage.
- Le gaz carbonique ou dioxyde de carbone (CO2)
Des accidents graves, voire mortels, sont dus à l'asphyxie par le CO2 dégagé par exemple lors de la fermentation dans les cuves dans le processus de vinification. Le dégagement du dioxyde de carbone (CO2) est dangereux, non seulement du fait du risque d'asphyxie, mais aussi parce que celui-ci est imperceptible (inodore, incolore) et plus lourd que l'air, ce qui lui permet de se concentrer au fond des cuves, notamment enterrées, ou dans des locaux confinés et non ventilés.
En milieu professionnel, les sources d'exposition sont nombreuses, avec une caractéristique commune à beaucoup de ces sources, celle de se trouver en espace confiné, avec pour conséquence de déplacer ou remplacer l'oxygène de l'air. Ces sources peuvent liées à :- une utilisation professionnelle, livré à l'état gazeux, liquide ou solide, dans l'industrie alimentaire notamment (carbonatation des boissons gazeuses, conservation, réfrigération et surgélation), mais aussi dans les serres, comme agent extincteur, carboglace, sablage … : les bouteilles de CO2, les citernes et les systèmes de gaz sous pression peuvent être à l'origine de ruptures (réservoirs, conduites) avec possibilités de libération de gaz carbonique.
- une production naturelle dans les tunnels, mines, caves, cuves … à cause d'une fermentation de matières organiques en espace clos : stockage des céréales en silos ou cales, cuves de vinification, égouts, fosses et canalisations d'assainissement, fermentation des produits d'ensilage dans les minoteries ou au cours de la fermentation de la bière … Les agents biologiques génèrent des gaz de fermentation des matières organiques et consomment l'oxygène avec un déficit qui peut devenir dangereux dans un espace confiné.
- L'azote (N)
C'est un gaz incolore, inodore, utilisé dans la synthèse de l'ammoniac, l'inertage, l'isolation et la purge par l'azote pour supprimer le pourcentage d'oxygène contenu dans un élément à inerter (emballage, conteneur) dans le but de limiter les phénomènes d'oxydation ou d'explosion. La protection des racines de soudure par inertage, pendant et après le soudage, est une autre application industrielle de l'azote, ainsi que l'évaporation d'azote liquide lors de son utilisation pour refroidissement ou congélation.
Ces utilisations sous forme d'azote liquide est à l'origine d'un nombre croissant d'accidents parfois mortels : le gaz peut être dégagé de façon excessive en cas de non maîtrise de l'inertage.
L'approvisionnement de l'azote liquide se fait en bouteilles pour les applications nécessitant de faibles débits, intermittentes ou ponctuelles ou bien l'approvisionnement en azote liquide est stocké dans des réservoirs cryogéniques pour des utilisations moyennes ou en secours d'un approvisionnement par canalisation.
La diminution du taux d'oxygène, causée par une augmentation du taux d'azote dans l'air, peut avoir lieu en particulier dans la salle cryogénique, lors de certaines manipulations liées aux produits stockés ou à l'utilisation des récipients avec vaporisation de l'azote liquide. L'hélium (He), l'argon (Ar) sont aussi des gaz inertes utilisés dans l'inertage et les opérations de soudure, avec les mêmes risques d'asphyxie que l'azote.
- Les hydrocarbures alcanes
Les alcanes sont des hydrocarbures aliphatiques saturés de formule générale CnH2n+2 : méthane (CH4) principal constituant du gaz naturel, et les composés chimiques surtout obtenus par craquage, distillation et fractionnement du pétrole brut, l'éthane (C2H6), le propane (C3H8), le butane (C4H10), le pentane, hexane, heptane, octane etc.…
On retrouve principalement les alcanes dans les carburants (kérosène, essence, gazole, …) pour le transport automobile, ferré, naval, aérien, combustibles pour le chauffage, la production de vapeur à destination de la production électrique, l'incinération des déchets, …. Les hydrocarbures alcanes à petite molécule sont gazeux à la température ambiante (de C1 à C4). Pour des masses moléculaires plus élevée du pentane à l'octane (de C5 à C8), les hydrocarbures deviennent liquides, mais très volatils : du fait de leur volatilité et de leurs sources d'émission très nombreuses dans l'industrie, le bâtiment et les transports, ces vapeurs d'hydrocarbures se retrouvent en concentration plus ou moins élevée à de nombreux postes de travail, induisant une exposition respiratoire à de très nombreux travailleurs :- Sur les lieux de production d'hydrocarbures
Ce sont essentiellement les lieux d'extraction du pétrole, les raffineries et usines pétrochimiques et de conditionnement de ses produits. - Sur les lieux de stockage d'hydrocarbures
Ce sont essentiellement les installations de chargements et déchargements des navires, des wagons et des citernes routières, les stations de pompage et les dépôts d'hydrocarbures, les réservoirs des usines, chaufferies, centrales électriques, cuves des stations-service et magasins des ateliers utilisant des essences. - Dans les transports d'hydrocarbures
Les hydrocarbures sont transportés par des camions ou wagons-citernes, par des navires pétroliers ou méthaniers, par des oléoducs ou gazoducs, chacun de ces moyens de transport recélant des risques de fuites et d'accidents.
- liquide : carburants (essence, gazole, kérosène).
- ou gazeuse (méthane, propane et butane), pour le transport (GPL) et le chauffage ou la production de vapeur.
- Le méthane CH4, gaz incolore, inodore, insipide, est aussi produit lors de la décomposition de matières organiques d'origine végétale (gaz des marais, grisou dans les mines de charbon) ou animale.
- L'éthane C2H6, gaz incolore, inodore, est également utilisé comme réfrigérant. Parmi quelques professions particulièrement concernées, on peut citer les raffineurs, mécaniciens automobiles, pompistes, citernistes, chauffeurs routiers…
Les gaz et vapeurs d'hydrocarbures alcanes en forte concentration peuvent provoquer l'anoxie ou l'asphyxie par manque d'oxygène, avec des malaises pouvant être mortels : ces situations se rencontrent avec les hydrocarbures gazeux ou vapeurs de liquides hautement volatils en fortes concentrations émis par une fuite dans une conduite ou un réservoir, ou répandus au sol par rupture du contenant ou déversement accidentel, dans des lieux confinés, mal ventilés (fosses, caves, galeries souterraines…), en produisant une atmosphère asphyxiante qui peut induire de sérieuses conséquences respiratoires, pouvant aller jusqu'au coma. Les principaux symptômes associés à l'asphyxie simple par les alcanes sont des maux de tête, des nausées, des vertiges, l'incoordination, des difficultés respiratoires, une perte de connaissance et possiblement la mort par asphyxie.
- Les gaz asphyxiants biochimiques
Les gaz asphyxiants biochimiques altèrent la fonction de l'hémoglobine : l'hypoxie est due à des anomalies tissulaires ou sanguines. A la différence des gaz asphyxiants simples, ils sont pourvus d'action physiologique, ils provoquent l'asphyxie même pour d'assez faibles concentrations dans l'air inspiré.
L'asphyxie biochimique est une hypoxie concernant l'atteinte de l'hémoglobine, qui peut être affectée de différentes façons,
- par perturbation du transport de l'oxygène, du fait de la liaison avec le fer de l'hémoglobine (cas du monoxyde de carbone CO),
- par perturbation du transport de l'oxygène, du fait de l'oxydation du fer de l'hémoglobine (cas des gaz methémoglobinisants).
- par l'asphyxie tissulaire, du fait de la diffusion du sang vers les tissus où il y a fixation sur le fer chargé de transporter l'oxygène dans le sang, avec arrêt de la consommation d'oxygène par la cellule (cas des agents cyanurés).
- Le gaz monoxyde de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone (CO) est le gaz asphyxiant le plus fréquemment rencontré ; il est incolore, inodore et très toxique. Le CO est issu de toutes les combustions incomplètes et notamment celles des installations de chauffage mal entretenues, des moteurs à combustion (par exemple gaz d'échappement dans un garage), et des fours. Le CO est aussi une cause majeure de la toxicité des fumées d'incendies. Les activités professionnelles utilisant le CO sous forme de gaz industriel, exposent aussi les travailleurs avec les fuites de CO. Les fermentations de produits agricoles produisent également du CO. Le monoxyde de carbone peut ainsi se dégager à la fois lors de nombreuses activités industrielles, dans les incendies, et être utilisé comme gaz dans les processus industriels, par exemple en métallurgie et dans des synthèses chimiques.
Une exposition faible (jusqu'à 100 ppm) entraine une baisse des performances physiques et intellectuelles (évaluation des distances, troubles visuels), une baisse de vigilance, alors qu'une exposition aigue génère de plus une dyspnée, des céphalées, nausées, vomissements puis une perte de connaissance et la mort par exposition prolongée.
Le monoxyde de carbone est aisément absorbé par les poumons et traverse facilement la barrière hémato-méningée et la barrière placentaire et est donc particulièrement dangereux pour les femmes enceintes à cause de ses propriétés toxiques chez le fœtus. Les molécules de CO se fixent en majorité sur l'hémoglobine du sang où elle forme la carboxyhémoglobine qui diminue les capacités de transports en oxygène du sang entraînant une hypoxémie, mais aussi minoritairement se fixent sur la myoglobine des muscles en leur conférant une couleur framboisée et entrainant une coloration cutanée rougeâtre.
- Les gaz ou vapeurs méthémoglobinisants
L'inhalation de ces gaz ou vapeurs provoque l'oxydation excessive de l'hémoglobine, dans le globule rouge ou dans le plasma, en formant la méthémoglobine qui est à l'origine d'une diminution du transport de l'oxygène et peut aboutir à des méthémoglobinémies : le tableau clinique est variable selon le degré d'intoxication, débutant par une cyanose (doigts, lèvres, joues), puis dyspnée, céphalées, vertiges, tachycardie, enfin collapsus, arrêt cardiaque, décès.
Les gaz ou vapeurs méthémoglobinisants à usage industriel sont des dérivés nitrés du benzène (par exemple le dinitrobenzène utilisé dans production des peintures, vernis, colorants, explosifs), les dérivés nitrés du toluéne (par exemple le nitrotoluène dans l'industrie des explosifs et des teintures), des dérivés nitrés de l'aniline (par exemple la nitroaniline dans la fabrication de divers produits organiques et de colorants).
- Les composés cyanurés
L'ion cyanure (CN-) est un puissant poison cellulaire qui diffuse du sang vers les tissus où il se fixe sur des macromolécules contenant du fer chargé de transporter l'oxygène dans le sang, avec un arrêt de la consommation d'oxygène par la cellule . Les cyanures possèdent une grande affinité vis à vis des pigments respiratoires voisins et l'hémoglobine.
Les produits cyanogènes comprennent l'acide cyanhydrique (ou prussique HCN) et ses sels (NaCN , KCN , CaCN…), des dérivés halogénés de l'acide cyanhydrique (ClCN, BrCN …) et nitriles qui peuvent se présenter sous forme solide, liquide, gazeuse ou de vapeurs, si bien que l'exposition peut être orale par déglutition de particules, cutanée par projection de liquide ou respiratoire par inhalation notamment de fumées, en particulier lors d'incendies : les polymères naturels comme la soie ou la laine ou synthétiques comme les matières plastiques polyamide, polyuréthane, polystyrène sont générateurs de cyanures de décomposition à haute température (revêtements de sol synthétiques, produits isolants, capotage des appareils …).
L'acide cyanhydrique est un liquide très volatil à l'odeur d'amande amère générant un gaz asphyxiant à absorption très rapide (quelques secondes) par les voies respiratoires : il est utilisé dans la fabrication de nombreux produits tels que les insecticides, l'acrylonitrile et dérivés acryliques (acrylates et méthacrylates), les cyanures métalliques et ferrocyanures, les bains cyanurés des procédés électrolytiques de cadmiage, argentage et cuivrage des ateliers de traitements de surface). Il est utilisé aussi pour ses propriétés biocides dans la fumigation des avions en particulier. Les cyanures sont également utilisés dans l'extraction et dans la concentration des minerais.
Les cyanures sont des poisons cellulaires très puissants, dont la toxicité dépend néanmoins du produit cyanuré considéré et de la dose d'exposition : symptômes très rapides (troubles cardiaques, syndromes coronariens, convulsions, décès en quelques minutes) ou intoxication chronique (céphalées, asthénie, troubles du sens olfactif et gustatif, vomissements et dyspnée à l'effort).
- L'hydrogène sulfuré (H2S)
L'hydrogène sulfuré est un gaz inflammable, incolore, à l'odeur nauséabonde d'œuf pourri, très toxique à faible dose par inhalation. Il se dégage des matières organiques en décomposition par fermentation (lisier dans les porcheries industrielles, algues vertes sur les plages, boues des stations d'épuration …) ou lors de l'utilisation du soufre et des sulfures dans l'industrie chimique. Étant plus lourd que l'air, il s'accumule dans les parties basses non ventilées ou il représente un risque majeur …
Le sulfure d'hydrogène est naturellement présent dans le pétrole, le gaz naturel, les réseaux d'assainissement des eaux usées ... Le sulfure d'hydrogène peut également provenir ou être utilisé par de nombreuses activités industrielles :
- Le sulfure d'hydrogène peut être émis au cours d'opérations industrielles telles que le raffinage et le craquage des pétroles riches en soufre, la désulfuration du pétrole et du charbon, la captation et l'épuration du gaz naturel, les hauts fourneaux et cokeries.
- Les activités de la papeterie, tannerie, vulcanisation du caoutchouc, fabrication de la viscose.
- Les industries chimiques pour produire des composés organosulfurés tels que des thiols (méthanethiol, éthanethiol ) et des additifs pour lubrifiants.
- La purification de minerais métalliques par flottation, le traitement de séparation des poudres minérales.
- Etc.
Le sulfure d'hydrogène provoque une asphyxie tissulaire par hypoxie due à des anomalies cellulaires, liées à une interruption de la chaine respiratoire mitochondriale : le sulfure d'hydrogène est rapidement mortel avec perte subite de conscience (« coup de plomb du vidangeur ») à une concentration de 800 à 1000 ppm, ce qui peut s'atteindre aisément en espace confiné (cuves, fosses, réservoirs, puits, égouts …) L'exposition à des concentrations inférieures a comme conséquences des irritations des yeux, de la gorge, une toux douloureuse, une dyspnée et irritation pulmonaire.
L'inhalation prolongée de sulfure d'hydrogène peut causer la dégénérescence du nerf olfactif (rendant la détection individuelle du gaz impossible).
Les mesures de prévention des risques professionnels des gaz asphyxiants industriels
Les gaz asphyxiants constituent un des risques chimiques professionnels à la toxicité aigue la plus critique : la dangerosité très élevée du travail en présence de gaz asphyxiants industriels, notamment en milieu confiné, nécessite que l'employeur élabore un recensement des espaces et postes de travail concernés et un programme qui définit l'ensemble des mesures à prendre pour effectuer un travail dans un tel lieu, avant et pendant l'intervention, ainsi que les procédures d'évacuation en cas d'accident.
Il convient également de s'assurer que les travailleurs sont habilités à pénétrer dans ces espaces, sont formés pour y travailler de façon sécuritaire et qu'ils ont à leur disposition les équipements de protection et de communication adéquats : l'information et la formation régulières des salariés (particulièrement les intérimaires et les nouveaux embauchés) sur les risques encourus, notamment sur les conditions d'exposition accidentelle, et sur les moyens de s'en prémunir, sont indispensables.
Les installations utilisant des gaz asphyxiants industriels doivent faire l'objet d'une analyse de risques stricte et minutieuse : ces analyses de risques sont confiées à des spécialistes de la sécurité au travail (hygiéniste, ingénieur sécurité). Les rapports d'analyses de risques, d'intervention et de maintenance seront intégrés à la documentation de sécurité au travail de l'entreprise (Document Unique de Sécurité DUS) et communiquées au médecin du travail et au CHSCT.
Les risques professionnels des gaz asphyxiants industriels offre un large champ d'application à la prévention : si la vulnérabilité et la létalité est importante, les diverses mesures de prévention techniques et organisationnelles sont efficaces et permettent de fortement réduire la fréquence et la gravité des dangers.
- la prévention technique collective, qui permet la suppression ou la réduction de l'exposition à des niveaux aussi bas que possible, est primordiale, là ou elle est envisageable : diminuer les émissions de vapeurs, de gaz ou de fumées, favoriser leur évacuation et développer l'automatisation des tâches, ce qui permet de limiter le contact avec l'ambiance polluée, choix de produits et de modes opératoires les moins dangereux. La prévention collective implique l'utilisation de dispositifs mécaniques comme la ventilation, ainsi que la présence d'installations et de matériel de premier secours.
- la prévention technique individuelle, qui consiste à utiliser des appareils de protection respiratoire, ne doit être qu'un complément des mesures de protections collectives ou pour pallier une situation exceptionnelle pour laquelle il n'est pas possible de mettre en œuvre des mesures de protection collective. Le détecteur de gaz peut se révéler nécessaire en tant que protection individuelle pour les activités exposées : il s'agit alors de détecteurs de gaz portables pour répondre à des besoins professionnels ponctuels ou hors d'une usine, mais, dans beaucoup d'applications industrielles, la sécurité doit être assurée continuellement par un système de détection de gaz à poste fixe.
- La dangerosité du travail en milieu confiné potentiellement asphyxiant nécessite que l'employeur élabore un recensement des espaces clos concernés et un programme qui définit l'ensemble des mesures à prendre pour effectuer un travail dans un tel lieu, avant et pendant l'intervention, ainsi que les procédures d'évacuation en cas d'accident. Il convient également de s'assurer que les travailleurs sont habilités à pénétrer dans les espaces confinés, sont formés pour y travailler de façon sécuritaire et qu'ils ont à leur disposition les équipements de protection et de communication adéquats.
Répertorier, localiser, signaler les espaces confinés du milieu de travail, puis décrire et évaluer leurs dangers est un préalable indispensable : l'évaluation doit se faire en considérant à la fois les risques intrinsèques à l'espace clos (présence de gaz et poussières ...), mais aussi ceux générés par l'activité qui peut y être effectuée (soudure, purge, nettoyage...).
La meilleure méthode de prévention est alors de supprimer le risque en rendant les interventions à l'intérieur des espaces confinés inutiles ou rarissimes : éviter d'y pénétrer est possible en mettant en œuvre des moyens d'intervention comme par exemple pour les cuves, des manœuvres de vannes depuis le bas ou l'extérieur, une vidange ou nettoyage par aspiration ou pompage, une possibilité de nettoyage extérieur pour les puits ou les fosses, l'utilisation de caméras, de panneaux de contrôle à distance, ...
- Une ventilation des lieux de travail adéquate
La ventilation et l'aération des lieux de travail jouent un rôle essentiel pour limiter la concentration de l'ensemble des gaz toxiques dans l'air ambiant et les évacuer des lieux de travail, de façon à respecter les valeurs limites fixées par les réglementations et éviter ainsi les conséquences sur la santé des travailleurs.
La valeur limite correspond à sa concentration dans l'atmosphère dans laquelle une personne peut travailler pendant un temps donné sans risque d'altération pour sa santé.
La Valeur Limite d'Exposition (VLCT pour Valeur Limite d'Exposition à Court Terme ou anciennement VLE) est la concentration maximum à laquelle un travailleur peut être exposée au plus pendant 15 mn sans altérations physiologiques : ce critère a pour but d'éviter les effets immédiats sur l'organisme.
La Valeur Limite Moyenne d'exposition (VME) est la limite d'exposition d'un travailleur pour une exposition régulière de 8h par jour et de 40h par semaine : ce critère a pour objectif d'éviter les effets à long terme sur l'organisme.
Ces valeurs limite s'expriment en "ppm" (partie par million) ou en mg par m3
Une concentration maximale admissible de CO2 est de l'ordre de 1000 ppm (pas de VLCT professionnelle indicative ou réglementaire pour le CO2). Pour le Monoxyde de carbone, la VME est de 50 ppm soit 55 mg/m³ : La valeur IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health), qui représente la concentration de CO susceptible d'entraîner immédiatement des effets irréversibles pour la santé voire la mort, est fixée à 1200 ppm.
Pour le Sulfure d'hydrogène : VME : 5 ppm soit 7 mg/m³, VLCT : 10 ppm soit 14 mg/m³.
Pour le Dinitrobenzène (tous isomères) : VME : 0,15 ppm soit 1 mg/m³.
Pour le Cyanure d'hydrogène : VME : 2 ppm soit 2 mg/m³, VLCT : 10 ppm soit 10 mg/m³.
Les mesures et analyses peuvent être faites par l'employeur ou par un laboratoire agréé et le respect des valeurs limites doit être vérifié au moins annuellement.
Si la valeur limite d'exposition est dépassée, cela permet d'imposer un arrêt temporaire d'activité pour remédier à la situation. Il existe deux techniques de ventilation : la ventilation locale par aspiration à la source et la ventilation générale ou la ventilation par dilution.
- Ventilation locale : on opère par le moyen de hottes et autres systèmes locaux de déplacement de l'air.- Des systèmes d'extraction de l'air comme des hottes et des tables aspirantes sont utilisées pour aspirer les contaminants près de la source d'émanation et filtrer l'air, ce qui prévient la contamination de l'air ambiant ; en particulier, c'est le cas des manipulations manuelles inévitables qui doivent être effectuées à un poste de travail muni d'un dispositif d'aspiration des vapeurs à leur source d'émission.
- Le matériel doit éviter notamment la formation d'étincelles. Les hottes ou plafonds filtrants et autres composants aérauliques comme les ventilateurs, les conduits entre autres doivent être accessibles et faciles d'entretien et de nettoyage. En particulier, les réseaux s'encrassent rapidement avec de filtres hors d'usage, une évacuation des condensats obstruée…
- Détection des gaz asphyxiants
L'odorisation du gaz naturel distribué est un facteur essentiel de sécurité : en effet, le gaz naturel (méthane, ethane) n'a pas d'odeur mais des molécules odorantes de composés soufrés sont ajoutées (mercaptans : méthylmercaptan méthanéthiol ou éthylmercaptan éthanéthiol ; tétrahydrothiophène : thiolane THT) pour faciliter une première détection à l'odorat. Pour les gaz propane et butane, l'odeur permet également de détecter une éventuelle fuite : ces gaz contiennent naturellement des substances odorantes qui peuvent être intensifiées en ajoutant aussi ces additifs.
Dans beaucoup d'applications industrielles, la sécurité vis-à-vis des gaz asphyxiants doit être assurée continuellement par un système de détection de gaz à poste fixe.
Le besoin de mesurer en même temps et en continu la concentration de plusieurs gaz est de plus en plus fréquent dans les applications industrielles (industries chimiques et agro-alimentaires mais aussi chaufferies, mines, tunnels …).
Détecté de manière précoce, une action peut être déclenchée pour protéger le personnel, les lieux et les équipements.
Tout détecteur de gaz fixe comporte un capteur et un circuit électronique qui transforme le signal délivré par l'élément sensible (le capteur) en un signal électrique utilisable. Ce signal permet de déclencher une alarme, visuelle et/ou sonore (buzzer, flash …) et peut également dans certains cas générer une action, comme l'arrêt d'un procédé, la fermeture d'une vanne...
De plus, les appareils peuvent comporter un afficheur et des signaux visuels qui indiquent le bon fonctionnement ou un défaut de l'appareil et de l'alarme.
Le fonctionnement des détecteurs fixes est continu (par exemple, dans l'industrie chimique, les détecteurs fixes de gaz CO). Compte tenu de l'extrême dangerosité qui peut résulter d'une fuite de gaz, la réglementation, de plus en plus stricte, impose la connaissance et la prise en compte de directives et normes très précises.
Savoir si l'atmosphère ambiante est toxique ou non est fondamental aussi pour la sécurité des premiers intervenants sur un sinistre chimique ou un incendie : le danger provoqué par tel ou tel gaz est bien souvent sous-estimé et le sauveteur ou le sapeur-pompier doit compter sur un appareillage de détection et de mesure, portable, peu encombrant, fiable, et de mise en œuvre facile.
Il existe toute une gamme de détecteurs de gaz portatifs et automatiques (CO, H2S, HCN, …)
Les détecteurs portables de gaz et d'oxygène (oxygénomètre) mesurent le risque, et combinés à un vibreur, une alarme sonore et optique réagit immédiatement lorsque la concentration de gaz dépasse les seuils d'alarme préréglés (ou est trop basse dans le cas de l'O2). Les badges colorimétriques de prélèvement, grâce à un système de fixation sur le vêtement, permettent d'évaluer l'exposition respiratoire aux substances chimiques toxiques sur les postes de travail (CO …)
Les tubes colorimétriques (avec pompes de prélèvement) sont les détecteurs les plus simples pour la mesure de très nombreuses substances différentes : ils sont constitués d'un tube en verre avec extrémités à briser et sont remplis de granules imprégnés spécifiquement afin de déterminer divers types de substances polluantes. Une fois aspiré l'air ambiant par la pompe dans le tube réactif, la couche indicatrice change de couleur si le polluant recherché est présent. La longueur de la zone colorée indique la concentration du gaz (ou vapeur) dans l'atmosphère. Une graduation spécifique est imprimée sur chaque tube réactif. Leur longue durée de stockage convient parfaitement à des mesures occasionnelles.
- Détection et mesure du CO2 : nombreuses méthodes de mesures physiques ou chimiques pour vérifier la teneur en CO2 dans l'atmosphère de travail : le test à la bougie est à proscrire, une mesure du taux d'O2 est insuffisante.
- Détection et dosage du CO : trois méthodes sont possibles pour la détection du CO : réaction chimique colorimétrique avec le CO dans des tubes réactifs (mesure pas instantanée ni permanente) ou badges sensibles portables, capteurs électroniques des avertisseurs de CO dans un local par absorption du CO dans l'infrarouge qui permettent l'affichage en continu de la concentration instantanée du CO et permettent de calculer les valeurs correspondant aux normes (VME et VLE).
- Contrôler régulièrement le bon fonctionnement de ces appareils à l'aide de gaz étalon : une calibration des détecteurs peut être nécessaire ; l'installation de détecteurs doit toujours être accompagnée d'une procédure de contrôle périodique. - Un stockage des gaz rigoureux
Le stockage des gaz liquides (centrale de bouteilles de gaz de dioxyde de carbone ou d'azote, par exemple) présente des risques tels que l'incendie, l'explosion, le risque de chute ou de renversement d'emballage … Toutes ces caractéristiques rendent nécessaire, outre les précautions lors de leur emploi, transport et transvasement, l'aménagement de locaux de stockage. La réduction des risques existants passe par une réflexion sur la structure du local, sur les modalités de rangement et sur les incompatibilités entre les produits. Des procédures de stockage non adaptées peuvent entraîner une fragilisation des emballages à l'origine de fuites ou de ruptures accidentelles, de pollution, de réactions dangereuses ou d'accidents ou induire une modification ou une dégradation du produit qui le rend plus dangereux. Le stockage des bidons et autres conteneurs, doit se faire dans un local ventilé et sur cuvette de rétention, et toujours bien refermés. L'interdiction de fumer dans les locaux doit être absolument respectée et signalée de manière apparente (de même que toutes les autres consignes de sécurité).
Il faut stocker les plus faibles quantités de produits possibles car le risque d'incident ou d'accident croît avec la durée et le volume de stockage.
Les stockages de volumes importants doivent être traités selon les règles applicables aux stockages industriels, en se référant, s'il y a lieu, à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement : les réservoirs doivent alors posséder un toit ou un écran pour éviter toute émission dans l'atmosphère.
Il convient d'Inspecter régulièrement les contenants et les aires d'entreposage afin de déceler tout indice de fuite ou de dommage. - La prévention individuelle des gaz asphyxiants
Il existe de très nombreux types d'appareils de protection respiratoire qui ont été conçus par les fabricants pour s'adapter chacun à un domaine précis et restreint de situations d'utilisation, notamment en cas de fuite, incendie …
Un utilisateur pourrait se trouver en situation de grave danger si le type d'appareil sélectionné n'est pas adapté, ou encore si l'appareil est utilisé en dehors des limites prévues par le fabricant.
On distingue deux grandes familles d'appareils de protection respiratoire : les appareils filtrants, qui sont à ventilation libre ou à ventilation assistée, et les appareils isolants.
Les appareils filtrants
L'élément actif des filtres est constitué généralement d'un charbon actif, traité de manière spécifique en fonction de la nature du gaz contre lequel il est destiné à protéger. Le piégeage des gaz est une réaction d'adsorption de surface sur le charbon actif, limité dans le temps au cours de l'utilisation du filtre, jusqu'à sa saturation complète.
Les filtres sont répertoriés selon leur degré d'efficacité et par couleur pour indiquer la nature des gaz contre lesquels ils protègent.
- Le demi-masque ou masque complet filtrant à cartouche
Ils possèdent une cartouche qui absorbe les vapeurs nocives ou toxiques. Cette cartouche est spécifique à des familles de produits et seulement efficace pour des concentrations ne dépassant pas une valeur donnée par le constructeur.
C'est une pièce faciale qui recouvre le nez, la bouche et le menton et les yeux dans le cas du masque complet et qui est réalisée entièrement ou dans la plus grande partie de sa surface en matériau filtrant. Elle comporte des brides de fixation et dans certains cas une ou plusieurs soupapes expiratoires.
- Les appareils à ventilation assistée (A.R.V.A.)
À utiliser dans des conditions de travail difficile : chaleur, longue durée, efforts physiques importants…
Ces appareils encombrants mais très efficaces sont constitués d'une protection faciale (coiffe, cagoule, pare-visage, écran de soudage, casque ou casquette) ainsi que d'une unité filtrante montée à la ceinture, d'un moteur-ventilateur et d'une batterie.
Les appareils isolants (A.R.I.)
Ils sont destinés aux travaux en milieux confinés quand l'ambiance de travail est appauvrie en oxygène. L'appareil respiratoire isolant s'utilise essentiellement sur des interventions (incendies…) ou dans des atmosphères douteuses (égouts…).
Ils sont alimentés en air ou en oxygène depuis une source non contaminée. Ils sont constitués d'une pièce faciale et d'un dispositif d'apport d'air respirable.
Dans des cas particuliers de travail en milieu confiné, descentes dans ces cuves, puits, …, on peut sécuriser le travailleur par un harnais relié à une corde ou autre système anti-chute et surveillance de l'extérieur. - La signalisation des gaz asphyxiants
L'identification des locaux à risques d'asphyxie avec la signalétique de prévention appropriée, l'affichage de consignes de prévention répondent à des normes et obéit à des exigences réglementaires.
Des pictogrammes de sécurité par leur langage graphique universel permettent d'informer les utilisateurs et le public des règles en vigueur et de l'orienter dans ses déplacements, sur les dispositions existantes en matière de prévention des risques mais également par exemple de la présence de produits dangereux éventuellement stockés, des moyens de lutte contre l'incendie, des chemins à suivre pour une évacuation efficace en cas de sinistre …
Tous les espaces confinés à risque d'asphyxie doivent être l'objet d'une signalisation explicite (affiches et pictogrammes) afin de souligner la présence d'un danger et de préciser que seulement une personne qualifiée et autorisée peut y accéder.
Le Panneau de danger " Risque d'asphyxie" symbolise une personne asphyxiée, afin d'indiquer qu'un espace confiné précis (puits, citerne, conduits, cuves, réacteurs,...) peut entraîner ce type de conséquences, de manière à ce que toute personne exposée prenne ses précautions : ce qui nécessite au préalable, des instructions adéquates aux employés sur la nature exacte du risque et la manière de s'en prémunir. - Les premiers secours en cas d'asphyxie
- Des précautions sont à prendre pour éviter les asphyxies en série : ce type d'accidents est en effet malheureusement parfois suivi d'autres accidents en chaîne du fait de l'intervention malencontreuse, sans équipement préalable, de témoins ou de secouristes non avertis. Les secours extérieurs doivent pouvoir identifier immédiatement le risque en cas d'accident : tout travailleur qui alerte les secours doit être en mesure de signaler le risque d'asphyxie aux secours. Avant d'entrer, surtout dans des espaces clos, vérifier que l'atmosphère est suffisamment oxygénée avec un détecteur adapté au gaz, mesurer la concentration et la nature du toxique, pénétrer dans les lieux en s'équipant au préalable d'un appareil de protection respiratoire au besoin.
- Evacuer immédiatement la victime de l'atmosphère toxique vers une zone respirable après avoir pénétré en sécurité dans le lieu, pratiquer les premiers secours de réanimation, ouvrir les fenêtres pour aérer la pièce.
- Le cas échéant, fermer le robinet ou la vanne d'alimentation à l'origine de l'accident ou enlever la source d'exposition, arrêter tout appareil suspect en fonctionnement.
- Appeler immédiatement les centres de secours. Un traitement précis et lourd en cas d'intoxication grave est nécessaire : prise en charge non spécifique, qui implique le maintien des fonctions vitales par l'utilisation des moyens intensifs de réanimation cardio-circulatoire et oxygénothérapie, soit aussi traitement spécifique, par l'utilisation des antidotes anti-cyanures par exemple (Hydroxocobalamine).
Pour aller plus loin :
- OFFICIEL PREVENTION : Protections collectives - Organisation – Ergonomie > Ventilation, aération, filtrage et appareils de contrôle d'atmosphère : La prévention des risques des travaux en milieu confiné
Juillet 2018
Partagez et diffusez ce dossier
Laissez un commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.