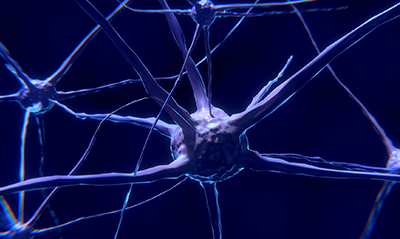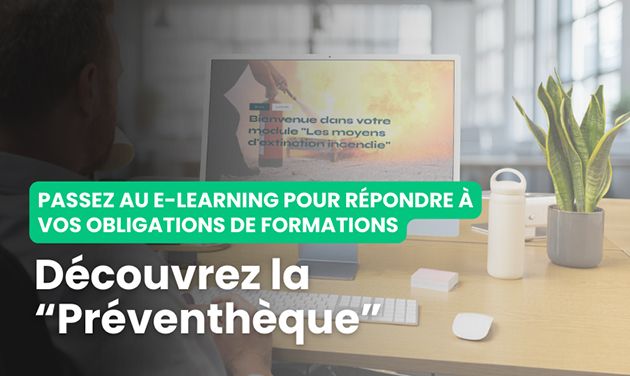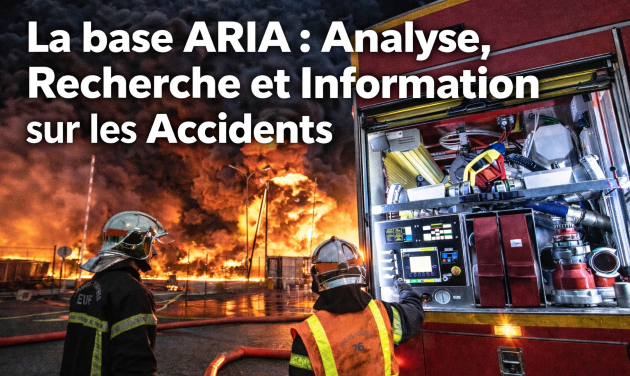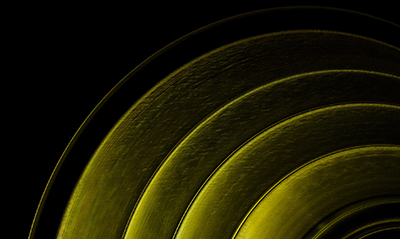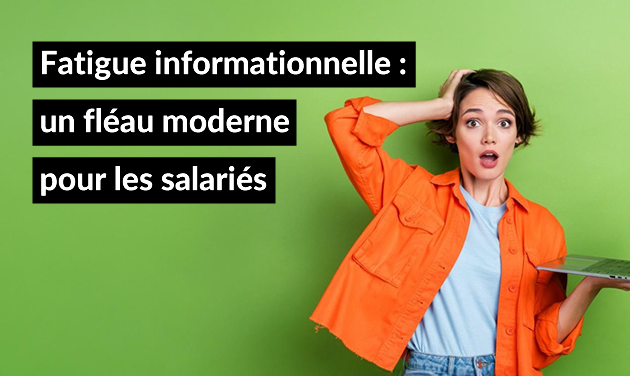
Quelques mythes de la sécurité industrielle
Denis Besnard, chercheur de Mines ParisTech, démystifie les croyances parfois les plus communément admises en matière de sécurité industrielle.
Lorsque l’on étudie la sécurité industrielle et que l’on travaille en étroite collaboration avec l’industrie, on se rend compte que la gestion classique de la sécurité repose en partie sur un ensemble de croyances partagées par un grand nombre d’entreprises. Pour autant, ces croyances sont-elles scientifiquement fondées ? Par exemple, doit-on parler d’erreur humaine ou de conditions défavorables ? Les protections augmentent- elles la sécurité ou invitent-elles à prendre plus de risques ?
Questionnons-nous sur quelques-unes de nos croyances, démontons-les et soumettons quelquesuns de nos présupposés à l’analyse. Voyage au coeur des mythes de la sécurité industrielle...
Les mythes... quel intérêt ?
Une des définitions du mythe renvoie à une idée ou une histoire que beaucoup de gens croient mais qui n’est pas vraie. Au-delà de l’idée plutôt anodine que nous ne savons pas que des vérités, il existe au moins deux implications intéressantes : les mythes conditionnent pour partie ce que nous faisons et ils sont extrêmement répandus. Vus sous cet angle, les mythes revêtent un grand intérêt puisqu’ils permettent de se poser la question suivante : qu’y a-t-il dans le monde de la sécurité industrielle que les gens croient, qui pourrait n’être que partiellement vrai, et qui cependant conditionne les décisions de management ? Prenons quelques exemples.
Mythe n° 1 : l’erreur humaine
Avez-vous déjà entendu ou lu la phrase suivante : « Les humains sont responsables de 70 % des accidents » ?
Imaginez maintenant le scénario suivant : on demande à un opérateur d’une chaîne d’assemblage de monter un nombre donné de machines par jour. Il atteint un rendement élevé au fil de son expérience puis on lui impose de travailler sans pauses. Qui s’attendrait à ce que la qualité du travail de cet opérateur soit maintenue ? Intuitivement, il fait sens d’attribuer la baisse possible de rendement et/ou de qualité à la fatigue.
Dans les deux cas (avant et après la suppression des pauses), l’opérateur est le même ; ce sont donc les conditions dans lesquelles on a placé cet opérateur qui agissent sur son travail. Dès lors, la notion d’erreur humaine devient inutile car elle ne rend pas compte des causes. À présent, remplacez qualité du travail par sécurité et vous parviendrez à l’idée que ce sont les conditions matérielles et organisationnelles (adaptation des outils, formation, niveau de fatigue, stress, communication, etc.) dans lesquelles on place les opérateurs qui sont les déterminants majeurs de leurs accidents.
Comme Erik Hollnagel le souligne dans son article intitulé « Que peut-on apprendre lorsqu’il n’y a pas d’accident ? » (voir page 36), la soi-disant erreur humaine et les accidents attirent plus l’attention que les cas de succès. Faites vous-même le constat : combien commettez-vous de soi-disant « erreurs » dans une de vos journées ? Rapportez ce chiffre au nombre d’actions que vous réalisez correctement et vous serez convaincu que l’humain est plutôt fiable ; il récupère beaucoup de ses maladresses, il anticipe et s’adapte, et invente des solutions. Malgré tout, on continue à analyser ses erreurs, et parfois uniquement ses erreurs.
Changeons de vocabulaire : l’erreur humaine est un jugement souvent hâtif qui néglige à la fois les conditions de l’action et le fait que les humains sont en réalité plutôt fiables.
Mythe n° 2 : les écarts de procédure menacent la sécurité
Sanctionner les écarts, c’est sanctionner la raison même pour laquelle il y a des humains dans les systèmes sociotechniques : le besoin d’adaptation. En effet, pouvoir répondre aux constantes variations des conditions de travail et aux situations inattendues est un rouage élémentaire dans le fonctionnement des systèmes sociotechniques. C’est aussi une des qualités premières des opérateurs humains, et qui souligne leurs atouts face à l’automatisation.
Les écarts de procédure sont constants dans le travail humain.
Cependant, ceux qui sont liés à un accident sont plus visibles que les autres, du simple fait qu’ils sont analysés. Il s’ensuit que par amalgame, tous les écarts peuvent être perçus comme synonymes de non-fiabilité. La réalité est que le travail humain contribue à la fiabilité des systèmes par la compensation des effets des situations non prévues. Supprimer la tolérance à l’écart est donc une garantie de difficultés opérationnelles, voire une possible cause de baisse de la performance de sécurité.
Sur le plan du management, sanctionner un écart, ce n’est pas la même chose qu’agir sur les raisons qui ont poussé l’opérateur à le commettre. En d’autres termes, trouver les raisons de l’existence d’un écart de procédure contribue à comprendre le travail humain. Le sanctionner, c’est interdire les adaptations, et du coup, se priver de la possibilité de réagir aux imprévus.
Mythe n° 3 : augmenter le niveau de protection diminue les risques
En 1994, deux chercheurs allemands, Aschenbrenner et Biehl, montent une expérience de grande envergure. Ils font équiper la moitié d’une flotte de taxis du système de freinage ABS. L’autre moitié de la flotte est laissée telle quelle. Puis ils font estimer par de faux passagers (en réalité des collaborateurs des chercheurs) les vitesses en courbe et les distances de sécurité des chauffeurs du groupe ABS. Les résultats sont étonnants : les chauffeurs des taxis équipés d’ABS conduisent de manière plus agressive et ont plus d’accidents que leurs collègues. Comment est-ce possible ?
L’explication tient en un concept : celui d’homéostasie du risque. Le comportement humain élève son niveau d’exposition au danger en réponse à l’augmentation du niveau de protection. Le résultat net est que le niveau de risque est maintenu constant.
Bien sûr, les protections sont nécessaires et évitent beaucoup d’accidents. Cependant, en attendre systématiquement une augmentation de la performance de sécurité ne va pas de soi.
Mythe n° 4 : l’investigation accidentelle est un processus rationnel
En décembre 2007, un Rafale de l’armée française s’écrasait lors d’une mission d’entraînement. Peu après, un responsable des forces armées déclarait sur une radio nationale que toutes les responsabilités seraient établies. Est-ce l’unique façon d’aborder les faits ? Ne pourrait-on se questionner en priorité sur les causes de l’événement ? En d’autres termes, plutôt que de rechercher des personnes responsables, qu’y a-t-il à apprendre de l’événement pour éviter qu’il ne se reproduise ?
D’autre part, l’investigation accidentelle est sous l’influence de la compétence et la culture de ses acteurs. Il existe ainsi une tendance à universaliser l’usage d’une méthode. Un exemple est l’utilisation de l’arbre des causes (un outil d’analyse des défaillances techniques) pour analyser des accidents dans lesquels des humains sont impliqués. En fait, une fois que l’on aura étiqueté une branche de l’arbre « Erreur humaine », qu’aura-t-on appris sur les causes de cette erreur ? Sera-t-on réellement en mesure d’éviter sa récurrence ? Qu’aura-t-on compris des conditions dans lesquelles la soi-disant erreur s’est produite ?
Enfin, il existe une tendance à catégoriser certains événements de façon hâtive. Par exemple, avant même d’être pleinement analysés, certains incidents ou accidents sont déjà orientés vers une catégorie d’événements. Ce peut être le cas d’un opérateur qui, faute de gants, s’est cogné la main dans une opération de serrage d’une bride. Pour un tel événement, la catégorie « Hygiène et sécurité » peut être rapidement évoquée.
Cependant, les conséquences d’une telle association ne sont pas anodines : elles dictent la profondeur d’analyse et les enseignements qui en seront tirés. Au travers d’une analyse centrée sur l’hygiène et la sécurité, sera-t-on en mesure de comprendre toutes les raisons pour lesquelles cet opérateur ne portait pas ses gants ? Essayait-il de gagner du temps ?
Pourquoi ? Quelle était sa charge de travail ? Ses objectifs opérationnels pouvaient-ils être atteints en sécurité ?
L’investigation accidentelle n’est pas un processus purement rationnel. Elle est soumise, entre autres, à des biais de responsabilisation, des effets non voulus induits par la culture, ou encore des catégorisations hâtives. Ce positionnement, cette culture et ce jugement intuitif sont difficiles à combattre : ils sont des traits typiquement humains. En revanche, prendre conscience des limites qu’ils imposent à l’investigation est un premier pas vers des enseignements plus riches dans l’exercice de l’analyse d’accident.
Conclusion
La sécurité, au-delà de la vision réductrice qu’en donnent ses indicateurs classiques (par exemple, le nombre d’accidents avec arrêt) est un processus de fabrication en soi. À cet égard, le rôle que tiennent les mythes est important. Ils agissent sur la manière dont sont perçues les actions humaines, conditionnent la manière dont les accidents sont analysés, sanctionnent les écarts en oubliant leur intérêt, etc. Élever significativement sa performance de sécurité passe par un changement des pratiques. Et comment changer ses pratiques sans changer ses idées ?
En filigrane de l’article introductif d’Erik Hollnagel sur la chaire de sécurité industrielle (voir page 30), on trouve la promotion de nouvelles façons de penser la sécurité – par exemple, au travers de concepts tels que la résilience (voir l’article d’Éric Rigaud) où la contribution humaine à la performance de sécurité. C’est notamment sous ces angles que la chaire tente d’influer positivement sur les pratiques industrielles de gestion de la sécurité.
Pour aller plus loin
Aschenbrenner, M. et Biehl, B. (1994). Improved safety through improved technical measures ?
Empirical studies regarding risk compensation processes in relation to anti-lock braking systems. In : R.M. Trimpop and G.J.S. Wilde: Challenges to accident prevention: The issue of risk compensation behaviour. Groningen, The Netherlands: Styx Publications.
Partagez et diffusez ce dossier
Laissez un commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.