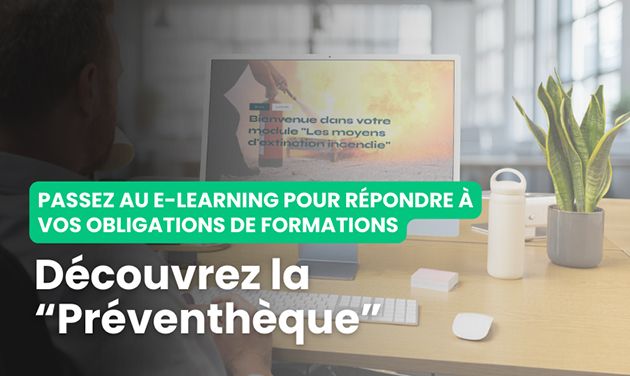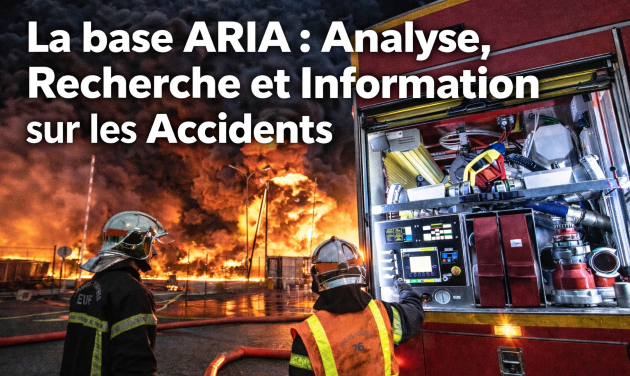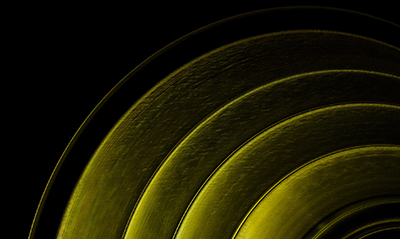Les ateliers des bijoutiers et des joailliers recèlent des risques nombreux, physiques, thermiques et chimiques. Dans les magasins de bijouterie, les risques principaux sont les atteintes psychologiques liées aux violences prédation (cambriolages, agressions physiques...) associées à des produits de forte valeur marchande.
Les ateliers des bijoutiers et des joailliers recèlent des risques nombreux, physiques, thermiques et chimiques : la fabrication ou la réparation des bijoux sont constituées d'opérations mécaniques, chimiques, électrolytiques destinées à modifier leur aspect ou leurs propriétés : fonte des métaux, taille et insertion de pierres précieuses, soudure, sertissage et polissage, électrodéposition, dérochage et décapage ...
La bijouterie et la joaillerie utilisent des outils tranchants occasionnant des blessures, des procédés bruyants (estampage, emboutissage) , nécessite des gestes précis et répétitifs avec une forte exigence visuelle et manipule de nombreux produits chimiques toxiques, allergènes, corrosifs et cancérogènes : des contacts cutanés et surtout l'exposition des travailleurs aux poussières métalliques nocives et aux émanations de solvants et vapeurs provenant des bains acides ou basiques dans l'air ambiant constituent des risques élevés pour la santé des bijoutiers.
Par ailleurs, la nature même des procédés de fonte de métal en fusion exposent évidemment à un risque de brûlure thermique par projection de métal ou exposition aux rayons infrarouges.
Dans les magasins de bijouterie, les risques principaux sont les atteintes psychologiques liées aux violences prédation (cambriolages, agressions physiques...) associées à des produits de forte valeur marchande.
Des mesures de prévention collective et individuelle sont ainsi indispensables pour permettre de réduire fortement la fréquence et la gravité des accidents du travail des bijoutiers et joaillers :
- locaux disposant d'une bonne extraction d'air et d'un bon système d'aspiration,
- postes de travail ergonomiques et éclairage adéquat,
- limitation de l'utilisation des produits les plus nocifs et substitution par d'autres qui le sont moins,
- respect des règles de stockage des produits chimiques,
- port de vêtements, de chaussures et lunettes de protection, de gants adaptés à la tâche effectuée et au produit concerné, de masque de protection respiratoire en cas d'urgence ou pour des travaux exceptionnels de courte durée, de protections auditives.
- mise en place de contrôle d'accès aux locaux, de sas d'entrée/sortie, de systèmes de vidéo- surveillance, de dispositifs d'alarme et d'alerte.
L'information des bijoutiers et joaillers exposés sur les risques des produits chimiques utilisés dans leur métier, leur formation aux mesures de prévention adéquates, un suivi médical renforcé et une traçabilité de leur exposition professionnelle complètent le dispositif de sécurité au travail.
Les principaux risques professionnels des bijoutiers et joailliers
La fabrication d'un bijou regroupe plusieurs étapes allant du travail du lapidaire qui taille les pierres précieuses (diamants ou autres gemmes, rubis, saphirs, émeraudes...), à celui effectué dans les ateliers du bijoutier et du joailler ou se déroule la fonte des alliages (or, argent, ...), la soudure par brasure, le sertissage, le polissage, des électrodépositions pour dorure ou argenture, le décapage et nettoyage des bijoux avec des acides ou dans des bains à ultrasons.
- Les risques physiques dans les bijouteries
Un travail minutieux avec des postures contraignantes, gestes répétitifs, contraintes visuelles, l'utilisation de machines vibrantes, coupantes ...exposent les bijoutiers à de nombreuses blessures et traumatismes.
- Les risques de troubles musculo-squelettiques et angioneurotiques
Le travail précis, rapide et monotone sur l'établi peut générer des troubles musculo-squelettiques dus aux gestes répétitifs de taille, polissage, sertissage, décapage, ... associés à une position penchée (attitude cyphotique) pour assurer une vision rapprochée et les bras tendus, coudes surélevés, appuyés sur la table : il s'ensuit l'apparition fréquente de dorso-lombalgies et de cervicalgies, de tendinopathies des membres supérieurs, et des syndromes du canal carpien.
De plus, les vibrations des machines portatives utilisées intensivement par le lapidaire ou le polisseur entrainent des risques ostéoarticulaires des membres supérieurs qui concernent d'abord les tendinites du coude (épicondylite et épitrochléite), des poignets, puis les tendinopathies de l'épaule. L'anesthésie vibratoire temporaire qui diminue provisoirement la sensation douloureuse, conduit souvent à continuer le travail en aggravant la pathologie. Les risques de neuropathies des vibrations se manifestent par la perte de dextérité manuelle, la diminution tactile des doigts, des fourmillements dans les mains intermittentes ou persistantes.
- Les risques de blessures
De nombreux outils manuels piquants et tranchants (limes-aiguilles, cisailles...) et machines sont utilisés pour laminer, étirer, découper, estamper, percer, polir... qui occasionnent des risques importants de blessures notamment aux mains et aux doigts par coupures ou écrasements avec possible inclusion de fragments métalliques et aux yeux par projection.
En particulier le laminoir avec ses éléments mobiles, la perceuse électrique pour le perçage des pierres, le polissage au tour électrique avec des brosses ou des roues en feutre ou en cuir tournant à grande vitesse, les bancs à étirer, les machines à estamper ... sont sources de dangers. - Les risques thermiques dans les bijouteries
Du fait des procédés utilisés en bijouterie, les locaux des ateliers sont donc particulièrement exposés à l'énergie rayonnante des infrarouges, aux températures élevées et aux risques de brûlures thermiques :
- coulage du métal en lingot dans un creuset en terre réfractaire à une température de fusion pour l'or de 900 °C, et pour celle de l'argent de 1 000°C,
- élaboration d'alliages,
- soudo-brasure réalisée par utilisation du chalumeau dont la chaleur est obtenue grâce au gaz de ville ou au butane et oxygène, alimenté souvent par l'intermédiaire d'une pompe à pied,
- travail à la chaleur au décapage et à l'électrolyse,
- vulcanisation à 150°C du moule de caoutchouc servant à couler les cires...
Le suivi de la fusion, la proximité du métal en fusion, la manipulation des éléments sortant du four, le contact avec des machines ou outillages chauds, sont des sources de risque thermique.
Le contact direct de la peau avec des surfaces chaudes ou des métaux en fusion peut bien entendu d'abord provoquer de très graves brûlures cutanées, lors du transport du métal fondu ou par flammèches et coulures.
Mais la proximité d'une source de chaleur radiante peut aussi entrainer des céphalées, hypersudation, tachycardie, hypotension et, conjuguée à des températures de l'air élevée, provoquer des malaises dus à la déshydratation et des troubles circulatoires.
Au-delà de 25oC, l'inconfort se fait ressentir avec, de plus, toutes les conséquences psychologiques que cela peut avoir sur la précision des gestes, la vigilance et donc la sécurité (diminution des capacités de réaction, irritabilité, agressivité).
Les expositions au rayonnement infrarouge provenant du métal en fusion, dont la densité de puissance transférable est beaucoup plus forte qu'en convection, peuvent augmenter le risque de cataracte et d'altération rétinienne et cornéenne ou de brûlures ou d'irritations cutanées. Les risques oculaires sont fortement aggravés par les rayons directs lorsque le travailleur fixe la source IR de manière prolongée, en restant immobile dans son axe, mais il faut aussi tenir compte des rayons indirects par réflexion sur des surfaces réfléchissantes. - Les risques auditifs et visuels dans les bijouteries
Les fortes contraintes visuelles et l'exposition au bruit exposent les bijoutiers à des risques visuels et auditifs.
- La fatigue visuelle par éblouissement, par travail en vision de près est fréquente chez les bijoutiers, surtout chez ceux qui ont des défauts de l'œil (myopie, hypermétropie, astigmatisme, troubles de la convergence, presbytie) qui rendent l'effort oculaire plus important pour un résultat médiocre lorsqu'ils sont mal ou pas corrigés. Le travail se fait constamment en vision rapprochée et avec utilisation de loupes pour les travaux très fins. L'œil n'est pas adapté pour cette accommodation permanente et les muscles oculaires se fatiguent après des efforts prolongés. Par ailleurs, la fatigue visuelle sera d'autant plus intense que le poste est peu ergonomique. Cette fatigue des muscles oculaires se traduit par une vue de plus en plus trouble au fur et à mesure de l'effort, des picotements et rougeurs oculaires, des larmoiements, des clignements intempestifs des paupières, des maux de tête...
- La technique du laser peut être utilisée pour les fines soudures avec exposition des yeux aux rayons laser et risques des dommages oculaires.
- Le martelage transformant le métal par le choc, les opérations d'estampage et d'emboutissage, l'utilisation de soufflettes, de meules... génèrent des bruits souvent supérieurs à 90dB, à l'origine de troubles auditifs, pouvant entrainer à la longue un début de surdité professionnelle (hypoacousie et presbyacousie pour les travailleurs âgés), d'installation insidieuse car le déficit auditif initial est non perçu par le travailleur. D'autres effets sont possibles, tels que acouphènes, sifflements, bourdonnements d'oreille, vertiges, otalgies et des manifestations extra-auditives (céphalées).
- L'utilisation des bains à ultrasons pour le dégraissage des bijoux, provoque des effets nocifs si ces ultrasons, inaudibles ou quasi-inaudibles, se transmettent à des niveaux suffisamment élevés et prolongés. Des migraines, nausées, vertiges peuvent survenir particulièrement pour les personnes à l'ouïe très fine, notamment chez les jeunes travailleurs. La main peut être est soumise à une forte vibration lors d'un contact avec la source d'ultrasons (sonotrode ou pénétration de la main dans le bain). - Les risques chimiques dans les bijouteries
De multiples produits chimiques à toxicité chronique ou aiguë, susceptibles de réactions d'irritations ou d'hypersensibilisation, sont utilisés dans les ateliers des bijouteries à tous les postes du travail.
Les effets aigus s'observent surtout lors de fuites ou de déversements importants, éclaboussures ou immersions suite à des rejets accidentels.
La multitude des produits utilisés nécessite de consulter et d'analyser les Fiches de Données de Sécurité (FDS) pour connaître les informations relatives à la toxicité de chacun d'entre eux, obligatoirement fournies par le fabricant du produit et figurant sur les étiquettes des emballages sous forme de symboles et d'informations écrites (phrases de risque R et conseils de prudence S).
On distingue les effets aigus (dus à des concentrations élevées) et chroniques (dus à de faibles concentrations, mais à des expositions répétées).
- Les fumées d'alliages métalliques liquides et poussières de métal
Toutes les poussières de métaux peuvent entrainer des pathologies respiratoires (toux, expectoration, essoufflement), particulièrement pour certains alliages avec des oxydes de métaux dangereux pour la santé (plomb, nickel, chrome, mercure, cadmium, amalgame mercure/or...) qui peuvent également être présents dans les fumées.
Les fumées d'oxydes métalliques sont par ailleurs allergisantes et peuvent être à l'origine de véritables asthmes professionnels.
Les effets majeurs se font par voie respiratoire principalement mais aussi cutanée : les effets cutanés allergiques du nickel sont très fréquents, en particulier dans la bijouterie de fantaisie.
Les revêtements de décoration s'opérant par voie chimique par utilisation de solutions métalliques par voie électrolytique par réactions de réduction d'un cation métallique (argenture, dorure, déverdi..) mettent en œuvre des produits très dangereux : bains de cyanures d'or, d'argent, de potassium : il existe un risque de dégagement gazeux très toxique de cyanure d'hydrogène en cas de contact avec un acide dans les cuves d'électrodéposition. Tous les bains émettent des aérosols.
Les composés du nickel, du cadmium et du chrome hexavalent sont des molécules dont le caractère cancérogène est avéré.
- Les colles et les solvants
Le bijoutier utilise des colles cyanoacrylate et époxydique responsables d'eczéma de contact et autres dermatoses, d'irritations respiratoires et oculaires.
Les vapeurs très volatiles des solvants (trichloréthylène, acétone), utilisés lors du nettoyage des bijoux après soudure, du dérochage afin d'enlever la couche d'oxyde, de l'élimination des pates ou ciments, sont toxiques par inhalation pour le système nerveux, et irritantes pulmonaires.
- Les acides et les bases
Les opérations de décapage et de nettoyage et de rhodiage par l'acide sulfurique, le nettoyage par trempage dans un bain d'acide fluorhydrique, la rongerie du bijou en or avec de l'acide nitrique, le déverdi par l'acide chlorhydrique, le nickelage avec de l'acide borique, la récupération des poussières d'or et l'affinage de l'or pour la fonte avec de l'eau régale (mélange d'acide nitrique et chlorhydrique), sont des opérations exposant les bijoutiers à des produits très corrosifs pour la peau et irritants respiratoires (vapeurs sulfureuses et nitreuses). Ces acides peuvent engendrer des ulcérations cutanéo-dermiques profondes et douloureuses, mais aussi des lésions aux yeux par projection.
Le dégraissage des bijoux par trempage dans différents bains de soude, d'ammoniaque engendre des risques d'exposition à des produits très caustiques.
En cas d'inhalation massive suite à une fuite ou déversement importants, une intoxication aiguë par les vapeurs des bains acides ou basiques peut être redoutée.
- Les poussières de silice
L'exposition à la silice cristalline due au plâtre réfractaire et au meulage, lorsque le moule est brossé, au polissage compte tenu de la pâte abrasive utilisée (émeri, tripoli), au démoulage avec du talc, peut provoquer une silicose et est classée comme cancérogène.
Les particules de poussières de silice cristalline peuvent être très fines (d'un diamètre inférieur à 5 microns) et sont donc invisibles à l'œil nu, et restent longtemps en suspension dans l'air ambiant.
En étant inhalées et en séjournant longtemps dans le tissu pulmonaire, les très fines poussières de silice provoquent une inflammation chronique des muqueuses pulmonaires, la formation d'un tissu pulmonaire fibreux, la constitution de nodules, entrainant une maladie respiratoire, une pneumoconiose fibrosante nommée silicose, se traduisant par un essoufflement à l'effort (dyspnée) et de la toux au début, jusqu'à une déficience respiratoire très grave et une insuffisance cardiaque.
Par ailleurs, les poussières de silice cristalline peuvent induire une irritation des yeux et provoquer l'apparition de bronchites chroniques. - Les risques psychologiques dans les bijouteries
Les risques psychologiques sont liés aux contraintes de charge mentale de la haute qualité et de la grande précision du travail de pierres et métaux précieux et de sécurité face aux possibles violences de prédation (cambriolages, agressions, ...) dues à la détention, la manipulation de matières de très forte valeur.
L'augmentation permanente de stress qui en résulte peut avoir des répercussions sur la santé physique ou psychique du bijoutier et du joailler avec de nombreuses conséquences psychosomatiques : maladies cardio-vasculaires, troubles gastro-intestinaux, états d'anxiété et dépressifs... ainsi que les pathologies post-traumatiques consécutives à l'augmentation des agressions. - Autres risques
- Chutes de plain pied sur sol inégal ou encombré, dans un local exigu avec difficultés de circulation.
- Incendies en raison de l'utilisation de fours, d'opérations de soudage avec des brûleurs à gaz.
- Electrisation/électrocution par contact avec un conducteur sous tension (rallonge ...) ou par utilisation d'outillage mal entretenu ou de prises défectueuses. Les étincelles, arcs et échauffements provoqués par les moteurs et appareillages électriques en fonctionnement peuvent aussi déclencher un incendie, compte tenu de la présence de nombreux produits inflammables et de gaz.
- La présence de l'amiante est devenue rare, mais elle peut se retrouver parfois dans le support des bijoux et les gants.
Les mesures de prévention des risques des bijoutiers et joailliers
Les ateliers des bijouteries doivent faire l'objet d'une analyse poussée des risques pour permettre la rédaction du Document Unique de Sécurité (Décret du 5 novembre 2001) en appréciant à la fois l'environnement matériel et technique (outils, machines, produits utilisés) et l'efficacité des moyens de protection existants et de leur utilisation selon les postes de travail.
La prévention la plus efficace est la prévention primaire avec la mise en place de technologies qui permettent des actions sur les produits (suppression ou emploi de produits de substitution de moindre impact potentiel sur l'homme) et/ou des actions sur les procédés (emploi de matériels ou de machines supprimant ou limitant au maximum les impacts, par de très faibles rejets atmosphériques, par de bas niveaux sonores...).
La prévention collective implique l'utilisation d'enceintes étanches et de dispositifs mécaniques comme l'extraction de poussières et de vapeurs qui permettent de réduire l'exposition des travailleurs, en particulier lorsque l'on ne peut pas remplacer des produits chimiques dangereux par d'autres pour des raisons techniques.
Enfin, le port d'équipement de protection individuel (combinaison, gants, chaussures et lunettes de protection, masques...) est obligatoire pour réduire le risque d'exposition non totalement éliminé par les mesures de protection collectives, ainsi que la présence d'installations et de matériel de premier secours.
- La suppression / substitution des produits les plus dangereux
La suppression des produits les plus toxiques et leur remplacement par d'autres qui le sont beaucoup moins apparaissent comme des solutions prioritaires. Par exemple, pour un certain nombre d'applications :
- Substituer l'acide sulfurique par des sulfamates pour les opérations de dérochage,
- Eliminer les supports et les gants en amiante, recouvrir l'établi par du cartoplane,
- Remplacer les pates à polir à base de plomb ou de fer par potée étain ou potée rouge, le chrome par du vert de chrome,
- Substituer les abrasifs à base de silice par ceux à base d'alumine,
- Supprimer le trempage dans l'acide fluorhydrique,
- Adopter les nouveaux alliages sans nickel non allergéniques,
- Supprimer l'utilisation du trichloroéthylène pour les opérations de dégraissage, décapage
- Remplacer le talc par de la silicone. - Une ventilation des lieux de travail adéquate
La ventilation générale et l'aération des lieux de travail jouent un rôle essentiel pour limiter la concentration de l'ensemble des fumées et vapeurs dans l'air ambiant et les évacuer des lieux de travail, de façon à respecter les valeurs limites fixées par les réglementations et éviter ainsi les conséquences sur la santé des travailleurs. De plus, en matière de prévention, les équipements qui consistent à installer localement des capteurs de poussières et de fumées à la sortie des appareils, complètent une protection collective efficace par une aspiration à la source.
- La ventilation générale repose sur une extraction et soufflage de l'air avec un système de collecte par des ventilateurs, avant son rejet à l'atmosphère après épuration dans des filtres : l'air est transporté dans le local par un ventilateur de soufflage et extrait du local par un ventilateur d'évacuation. L'extraction de l'air se fait grâce à un système de collecte par ces ventilateurs, des gaines de diffusion, et un réseau de conduits qui captent et concentrent les poussières et vapeurs jusqu'aux filtres et aux épurateurs qui permettent de nettoyer l'air, puis de l'évacuer à l'extérieur. Les composants aérauliques comme les ventilateurs, les conduits entre autres doivent être accessibles et faciles d'entretien et de nettoyage. En particulier, les réseaux s'encrassent rapidement avec de filtres hors d'usage, une évacuation des condensats obstruée... L'entretien régulier du système de ventilation (nettoyage des conduits d'extraction, changement des filtres) est une condition indispensable de bon fonctionnement.
- La ventilation locale repose sur des systèmes de captage des gaz et poussières au plus près de leur point d'émission, avant leur dispersion dans le local : hottes ou buses d'aspiration ou bains à fentes aspirantes au dessus des creusets de fonte, des cuves d'électrodéposition, des équipements de polissage, dérochage, dégraissage, rongerie, brasure, titrage de l'or.
La ventilation générale des ateliers doit être déterminée en fonction des aspirations locales pour ne pas perturber l'efficacité des captages à la source.
- avec surveillance régulière de l'atmosphère, pour vérifier l'efficacité des mesures d'aspiration par dosages atmosphériques. Ces analyses métrologiques sont confiées à des spécialistes de la sécurité au travail. Les rapports d'analyses, d'intervention et de maintenance sont intégrés à la documentation de sécurité au travail de l'entreprise (Document Unique de Sécurité). Il convient de contrôler que l'exposition des travailleurs n'atteigne pas une concentration supérieure à celle des limites de sécurité (valeurs limites et moyennes d'exposition VLE et VME) déterminées selon les produits. - L'utilisation de machines et équipements adaptés
- La protection contre les risques thermiques nécessite une bonne isolation thermique et l'inaccessibilité des parties chaudes des installations en installant des écrans thermiques, le confinement et l'encoffrement des machines. L'aération participe aussi à la lutte contre la chaleur.
- Par le choix ou l'achat de machines et par l'utilisation de procédés silencieux, les émissions sonores peuvent être maintenues à un bas niveau.
Les machines et équipements doivent être conçues et fabriquées de façon à ce que les émissions sonores soient réduites au niveau le plus bas possible en application d'une directive européenne 2003/10/CE du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques liés au bruit.
Les machines bruyantes doivent être munies de capots insonorisants et pour réduire les bruits transmis par les sols et les structures, des blocs anti-vibrations peuvent être placés entre la machine et la surface d'appui (par exemple socle en caoutchouc sous le tour électrique de taille).
En ce qui concerne les locaux, les réflexions sur les murs entraînent une augmentation du niveau sonore dans le local et des mesures préventives de correction acoustique comme la mise en place d'un plafond ou faux-plafond absorbant, de cloisons amovibles recouvertes de produit anti-réverbérant à proximité des installations, réduisent à la fois le niveau sonore et protègent les postes de travail avoisinants.
La réduction du bruit consiste aussi à modifier les procédés de travail (ex : supprimer l'utilisation des soufflettes).
L'intensité ultrasonore diminue progressivement quand on s'éloigne de la source, et de ce fait, les ultrasons sont très facilement absorbés par les murs ou autres obstacles et se propagent très difficilement d'un local à l'autre séparé par une cloison. Ces caractéristiques permettent d'envisager des mesures de prévention aisées à mettre en œuvre. La réduction de l'émission ultrasonore à la source (insonorisation spécifique à la machine, capotage, écran acoustique...) est la prévention primaire à privilégier : la mesure préventive prioritaire consiste à choisir une machine ou un équipement le moins émetteur possible et disposant de moyens de protection intégrés : par exemple, augmentation de la fréquence en adoptant des sonotrodes adaptées, bâti de la cuve à ultrasons indépendant de la cuve elle-même, couvercle avec joints parfaitement adhérents et dispositif de verrouillage électrique afin d'empêcher le fonctionnement du bain avec le couvercle ouvert, revêtement acoustique interne absorbant...
- Les machines dangereuses (laminoir, découpe, estampage..) doivent disposer de dispositifs de sécurité des machines : toute machine doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs afin de supprimer ou réduire au minimum les risques de coupure, d'entraînement, d'écrasement, de cisaillement causés par les éléments exerçant une action directe sur la matière. Cette identification doit être réalisées par des pictogrammes et couleurs normalisées. Les éléments de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
Chaque machine doit être munie d'un ou plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence clairement identifiables accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter les situations dangereuses en train de se produire.
Les machines entrainant des projections de matière (tour...) doivent être munies d'écrans translucides protégeant les yeux de l'opérateur et les meuleuses et polisseuses doivent comporter un capot de protection.
Le respect des recommandations des constructeurs et un entretien régulier sont des éléments essentiels pour limiter les risques accidentels. Ainsi, l'utilisation et l'entretien des machines doivent être effectués par un personnel qualifié, spécifiquement formé.
Des machines utilisées de manière non conforme ou mal entretenues et non vérifiées périodiquement créent un risque mécanique et chimique supplémentaire.
- Des bacs de rétention spécifiques, pour le stockage des produits et pour les cuves et bains, doivent être mises en place pour recueillir les fuites et déversements accidentels.
- L'électrolyse avec bains cyanurés doit être éloignée des postes comportant la manipulation d'acides. - Des équipements et outils ergonomiques
Des équipements ergonomiques permettent de gagner à la fois en productivité, en confort et en sécurité pour les bijoutiers : poste de travail muni d'un siège réglable en hauteur avec dossier, ergonomie de l'établi indépendant et réglable ...
- Des sols régulièrement nettoyés et non encombrés, avec revêtement antidérapant, et des couloirs de circulation laissant une place suffisante évitent les chutes.
Une bonne tenue des locaux est essentielle pour éviter l'accumulation de déversements sous ou autour des machines qui peuvent créer un danger de glissement : les sols doivent être nettoyés régulièrement et tout produit accidentellement répandu, lors d'une fuite ou déversement, immédiatement épongé pour éviter les glissades et chutes de plain-pied.
- Il faut veiller à maintenir l'atelier rangé. Les voies de circulation doivent être débarrassées de tout obstacle. Il faut éviter les zones d'ombre en optimisant l'éclairage (luminaires avec grille de défilement) et signaler les escaliers, les dénivelés, les encombrements temporaires, et prévoir des aires de rangement.
La qualité de l'éclairage adaptée à la nature et à la précision des travaux à exécuter : pour les postes de travail où sont effectuées des tâches de précision, des renforts d'éclairage doivent être installés de manière ce que l'éclairement minimal soit de 600 Lux. - Un stockage des produits chimiques rigoureux
Le stockage des produits chimiques présente des risques tels que l'incendie, l'explosion, le risque de chute ou de renversement d'emballage ... Toutes ces caractéristiques rendent nécessaire, outre les précautions lors de leur emploi, transport et transvasement, l'aménagement de locaux de stockage avec des rayonnages métalliques, des armoires de sécurité pour petites quantités pour le stockage de produits inflammables, armoires avec étagères de rétention, matériels de stockage avec bacs rétention pour prévenir et maîtriser les fuites accidentelles de liquides polluants.
La réduction des risques existants passe par une réflexion sur la structure du local, sur les modalités de rangement et sur les incompatibilités entre les produits. Dans le domaine de la bijouterie, plusieurs produits sont incompatibles les uns avec les autres ou correspondent à des situations d'entreposage dangereuses. Des procédures de stockage non adaptées peuvent entraîner une fragilisation des emballages à l'origine de fuites ou de ruptures accidentelles, de pollution, de réactions dangereuses ou d'accidents ou induire une modification ou une dégradation du produit qui le rend plus dangereux.
Toutes ces caractéristiques rendent nécessaire, outre les précautions lors de leur emploi, l'aménagement de locaux de stockage, avec des rayonnages métalliques, des planchers et des palettes normalisées, des armoires de sécurité pour petites quantités pour le stockage de produits inflammables, armoires avec étagères de rétention, matériels de stockage avec bacs rétention pour prévenir et maîtriser les fuites accidentelles de liquides polluants.
Le stockage des bidons de solvants et autres produits volatils doit se faire dans un local ventilé et sur cuvette de rétention, et doivent être toujours bien refermés, loin de toute source de chaleur.
L'interdiction de fumer dans les locaux doit être absolument respectée et signalée de manière apparente, de même que toutes les autres consignes de sécurité.
Le lieu de stockage doit être fermé à clef et son accès réservé au personnel autorisé. Il faut stocker les plus faibles quantités de produits possibles car le risque d'incident ou d'accident croît avec la durée et le volume de stockage. Ces dispositions sont impératives notamment dans le cas du cyanure.
Le sol doit être en matière ininflammable, imperméable, résistant aux produits chimiques et en légère pente vers un caniveau d'évacuation relié à une fosse de récupération.
Les produits chimiques doivent être isolés du sol. Pour cela, il est possible d'utiliser des caillebotis. Tout stockage doit être muni d'une cuvette de rétention ayant la capacité de contenir au moins le contenu du plus grand réservoir ou la moitié de la totalité des réservoirs stockés.
Il faut prévoir une réserve de matière absorbante à proximité du local : il existe des kits de dépollution à disposer dans des armoires près des zones de stockage.
Le local doit posséder un système d'extinction incendie, et une douche oculaire et un lave-œil de sécurité doivent être installés à proximité.
Les parois du local doivent être en matériaux ininflammables.
Il faut régulièrement vérifier les zones de stockage des produits chimiques afin de repérer les fuites éventuelles.
L'interdiction de fumer doit être absolument respectée et signalée de manière apparente (de même que toutes les autres consignes de sécurité). - Une installation électrique conforme
L'incendie et/ou l'explosion peuvent provenir des équipements électriques, et en particulier, l'équipotentialité et la bonne mise à la terre de toutes les installations métalliques doivent être contrôlées, les prises défectueuses remplacées, et il faut éviter toute accumulation d'électricité statique. Les installations électriques doivent être étanches aux vapeurs acides - La prévention du risque incendie
Il s'agit de la mise en œuvre des dispositifs de prévention et de protection (alarme, détecteur d'incendie, désenfumage, extincteurs en nombre suffisant, accessibles et vérifiés régulièrement...). La prévention de la propagation d'incendie nécessite des caractéristiques minimales de résistance au feu des parois des locaux. - Des mesures d'hygiène
- Un nettoyage régulier permet de réduire les niveaux de poussières. Il convient de réaliser un nettoyage des lieux de travail avec les outils appropriés, avec des précautions pour éviter la dispersion des poussières lors du vidage des aspirateurs ou des conteneurs à déchets, du changement des filtres des dépoussiéreurs.
Les zones de travail doivent être nettoyées avec un chiffon humide ou un aspirateur à filtre absolu, jamais avec une soufflette ou un balai à sec, ni avec de l'air comprimé pour éliminer les poussières adhérentes.
Ces mesures d'hygiène concernent les sols et les plans de travail, mais aussi les murs et les plafonds.
- Des installations sanitaires (WC, lavabos, douches) doivent être mises à disposition des travailleurs, correctement équipées et en nombre suffisant, permettant aux travailleurs de se nettoyer fréquemment les mains et le visage à l'eau et au savon et de se laver en fin de poste pour limiter l'incrustation des particules dans la peau. En cas de forte contamination, les installations sanitaires doivent elles-mêmes faire l'objet d'un nettoyage méticuleux.
- Des douches oculaires portatives conçues pour fournir immédiatement le liquide de rinçage et des fontaines rince yeux/visage fixes doivent être disponibles.
- Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs : l'entreposage des tenues de travail doit avoir lieu à l'abri de la poussière (le rangement des tenues de ville et des tenues de travail doit être séparé).
- Pas de vêtement ample ou flottant, pas de cheveux longs ou alors attachés.
- La gestion et le nettoyage des vêtements de travail et autres équipements individuels de protection fournis aux travailleurs doivent être pris en charge par l'employeur.
- Des procédures de travail en ambiance chaude (fonte, proximité des fours) doivent être édictées et respectées de manière à réduire la contrainte thermique : absorption en quantité suffisante d'eau et de boissons renfermant des sels minéraux, rythme travail-repos aménagés en zone tempérée.
- La trousse de secours doit contenir des produits spécifiques : gluconate de calcium en solutions injectable et buvable, ou en crème en cas d'accident avec l'acide fluorhydrique, matériel d'oxygénothérapie et pour perfusion, kits de traitement en cas d'intoxication avec les cyanures.
- Interdiction de fumer ou de manger dans l'atelier à cause du risque d'absorption de produits toxiques et d'incendie. - Le port d'équipements de protection individuel adéquat
Les équipements de protection individuelle sont nécessaires pour réduire le risque d'exposition non totalement éliminé par les mesures de protection collectives précédentes : gants, vêtements de protection, chaussures et lunettes de sécurité, différents et adaptés à la tâche effectuée.
- La protection des mains
S'il y a possibilité de contact avec la main lors des transvasements de produits chimiques par exemple, il s'avère indispensable de porter des gants de protection adaptés au produit manipulé : il n'existe pas de gant de protection universel. Le type de gants conseillé, imperméables, à longues manchettes, pour éviter la pénétration des produits à l'intérieur, doit être adapté aux différents produits manipulés, notamment pou la résistance aux acides, selon leur composition qui figure sur la Fiche de Sécurité (FDS). Les gants en nitrile, néoprène, butyle sont les plus utilisés lors de la manipulation des solvants, des acides et autres produits utilisés dans la bijouterie.
Des gants appropriés doivent être aussi utilisés pour éviter les coupures aux mains, d'autres pour la protection contre la chaleur ainsi que des manchettes en isolant thermique : les gants anti-chaleur du fondeur, ou pour la manipulation des pièces chaudes, sont en fibre aramide.
- La protection du corps
Les vêtements de protection (bleu de travail ou blouse) doivent être complétés selon les postes par des tabliers en caoutchouc ou en cuir efficaces en cas de projection d'éclats (lapidaire, polisseur), ou ignifugés pour protection contre la chaleur.
- La protection des yeux
Le port de lunettes de sécurité est indispensable :
- pour la taille des pierres ou le meulage, l'affutage
- pour le soudage
- avec verres teintés filtrant les infrarouges pour le fondeur
- résistantes aux acides pour le décapage et le dérochage
- La protection des pieds
Le port de chaussures de sécurité permet de protéger les pieds en cas de déversement de liquide corrosif.
- En cas d'urgence ou pour des travaux exceptionnels d'entretien de courte durée, si le système de ventilation ne suffit pas à empêcher l'accumulation de vapeurs ou de poussières, un appreila de protection respiratoire adéquat doit être fourni pour éviter l'exposition à une concentration élevée : masque à cartouche FFP3 avec un filtre adapté au produit.
- La protection de l'ouïe
Des protections auditives sont nécessaires pour le lapidaire et le polisseur.
- Les mesures de prévention du stress
- Il convient, pour les travaux de précision, de prévoir des temps de pauses suffisants pour limiter la à la fois la fatigue visuelle et la contrainte psychologique.
- La conception des lieux de travail, qui concerne l'aménagement, la disposition, le verrouillage ou les obstacles physiques, l'éclairage et la surveillance électronique doit prendre en compte les risques d'agression :
- contrôle des accès, mise en place de sas d'entrée, installation d'écrans protecteurs,
- mise en place d'équipements ou de dispositifs de protection collective (systèmes de vidéo- ou de radio-surveillance, dispositifs d'alarme et d'alerte, vitrages renforcés, détecteurs de métaux),
- caisse et coffre automatiques.
- La surveillance médicale
Pour les bijoutiers exposés aux poussières de métaux, aux agents cancérogènes, au bruit, il faut réaliser des visites médicales régulières dans le cadre d'une surveillance médicale renforcée :
- Tests respiratoires (spiromètre) à l'embauche pour détecter une déficience des fonctions pulmonaires et tous les 2 ans pour dépister l'apparition des troubles respiratoires.
- Radiographie thoracique si nécessaire, épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR) conseillées,
- Audiogramme et analyses urinaires si nécessaire.
- Interdiction d'exposition des femmes enceintes ou des femmes allaitant à des travaux les exposant aux risques toxicologiques (solvants, plomb, mercure) et à la chaleur et aux vibrations excessives.
- Généralement, il y a un long délai entre l'exposition et le diagnostic d'un cancer professionnel (en général au moins 10 ans et jusqu'à 50 ans) ce qui nécessite une traçabilité au travers de la rédaction d'une fiche d'exposition et d'une surveillance médicale régulière, à visée de dépistage, réalisées par le médecin du travail.
A sa sortie de l'entreprise, le travailleur exposé doit recevoir une attestation d'exposition qui lui permettra de continuer à se faire suivre médicalement. La reconnaissance d'un cancer professionnel est importante, car elle ouvre droit à une réparation intégrale du préjudice subi pendant l'arrêt de travail (indemnisation et gratuité des soins) et au-delà s'il y a des séquelles (capital ou rente d'incapacité).
- Le dossier médical doit stipuler la nature du travail effectué, la durée des périodes d'exposition et les résultats des examens médicaux. Ces informations sont indiquées dans l'attestation d'exposition et le dossier médical doit être conservé 40 ans après la cessation de l'exposition.
- Suivi post professionnel (article D. 461-25 du code de la Sécurité sociale) : quand le salarié n'est plus exposé ou part à la retraite, ce suivi permet d'assurer pour les cancers professionnels qui se déclareraient après, une réparation du dommage subi. - La formation et l'information du personnel
La formation, par un organisme agréé, sur les dangers des produits utilisés et sur les moyens de se protéger, est indispensable : par exemple, comprendre les étiquettes du contenant des produits, informer sur le risque potentiel de maladies pulmonaires et sur les moyens de les prévenir, connaître l'attitude à adopter en cas de fuite ou de déversement accidentel, savoir utiliser les E.P.I adéquats, règles de sécurité lors des transvasements et des mélanges chimiques.
De même, la formation aux premiers secours (projections d'acide, blessures et incendie), la formation PRAP (Prévention des Risques liés à l'Activité Physique) sont nécessaires.
Janvier 2013
Partagez et diffusez ce dossier
Laissez un commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.
Les avis des internautes
07/02/2023