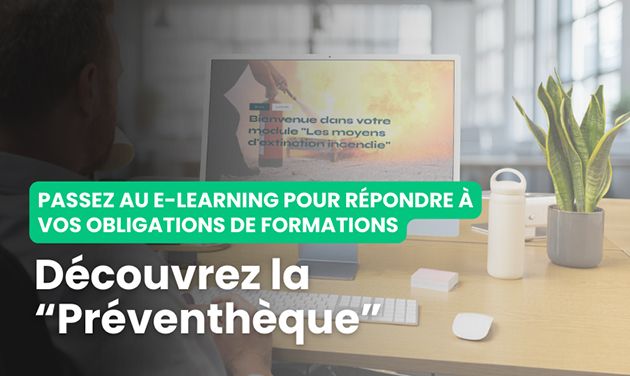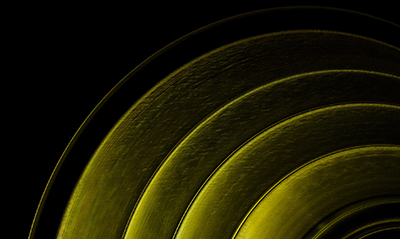Les agriculteurs des grandes cultures sont soumis à de nombreux dangers inhérents aux multiples risques professionnels auxquels ce métier est exposé, avec un taux de sinistralité professionnelle agricole supérieur à la moyenne, avec des maladies et accidents graves et parfois mortels plus fréquents. Ces travaux agricoles de plein champ comportent une combinaison de risques naturels et de risques liés à l'emploi de produits et de machines dangereux ...
Les agriculteurs des grandes cultures sont soumis à de nombreux dangers inhérents aux multiples risques professionnels auxquels ce métier est exposé, avec un taux de sinistralité professionnelle agricole supérieur à la moyenne, avec des maladies et accidents graves et parfois mortels plus fréquents. Ces travaux agricoles de plein champ comportent une combinaison de risques naturels et de risques liés à l'emploi de produits et de machines dangereux :
- Risques physiques liés à la nature des exigences et postures du travail agricole (ports de charges lourdes, manutentions...) et au matériel utilisé (conduite d’engins agricoles, parties mobiles en mouvement des machines ...),
- Risques chimiques liés à l’ensemble de procédés et produits mis en œuvre (pesticides, engrais chimiques, lubrifiants ...),
- Risques biologiques liés aux contacts avec des animaux, insectes ou micro-organismes divers (poussières et engrais organiques, ...).
Des conditions de travail particulières aggravent manifestement les conséquences de la dangerosité intrinsèque du métier d’agriculteur :
- Le travail avec des horaires atypiques selon les saisons (moisson ...),
- Le travail isolé des travaux agricoles de plein champ, avec retard dans l’alerte et éloignement des centres de secours, facteur majorant de gravité,
- L'exposition à la chaleur ou au froid, à l’humidité, au vent (refroidissement éolien) et à l'humidité, aux rayons ultraviolets solaires dans ce métier s'exerçant à l'extérieur.
De plus, les signes de souffrance mentale due au contexte socio-économique de l’agriculture sont fréquents, dont notamment un excès de risque de décès par suicide chez les travailleurs du secteur agricole.
Tous les risques des agriculteurs peuvent être maîtrisés par des moyens de prévention collective et individuelle : choix d’outils et de machines ergonomiques et bien entretenus, équipement de protection individuel adapté indispensable, ainsi que des pratiques gestuelles appropriées, une organisation rationnelle des travaux d’agriculture de plein champ, des techniques éprouvées suite à une bonne formation, des actions de sensibilisation sur les risques et les moyens de les prévenir et le strict respect des règles d’hygiène au travail.
Les principaux risques professionnels des agriculteurs
Un agriculteur, dans une exploitation agricole de plein champ, céréalière, fourragère, oléagineuse, légumière, sucrière ... procède à la mise en culture de la terre, qui comprend préparation des sols, semaison ou plantation, protection phytosanitaire, récolte et stockage. Il peut mettre en œuvre des monocultures ou des polycultures et, en fonction de l'importance des surfaces, employer des ouvriers agricoles que ce soit de façon permanente ou saisonnière.
Les secteurs des cultures de plein champ sont divisés en grandes cultures de céréales, oléagineux, protéagineux et légumes de plein champ (par exemple blé, orge, colza, maïs, pommes de terre, betterave etc.).
Il faut préparer les sols, semer, planter, épandre les engrais, récolter et stocker, le tout à l’aide d’engins mécaniques agricoles dont l’agriculteur doit assurer la première maintenance :
- travaux de préparation du sol (fumure de fond ou fertilisant organique, labour, décompactage, préparation du lit de semence, etc.);
- travaux des semis ou plantations ;
- travaux de fertilisation : apports d’engrais azotés et d’autres éléments pouvant nécessiter plusieurs passages sur la parcelle ;
- travaux de protection des cultures, qui peuvent donner lieu à plusieurs passages phytosanitaires sur le champ ;
- travaux de récolte (moisson, arrachage ...) et travaux de stockage (ensilage, séchage en grange, ...).
La pratique de l’agriculture de plein champ expose les travailleurs à de nombreuses situations à risques :
- Exposition à des contraintes physiques
Les agriculteurs sont particulièrement soumis à des nuisances physiques : contraintes posturales et articulaires répétitives et prolongées lors des travaux de plantation et d’arrachage des végétaux, de préparation des sols, port de charges lourdes (sacs d’engrais, caisses et cageots pleins, manutention diverses...), déplacements d’objets volumineux et encombrants (palettes, chariots, containers...), exposition à des bruits nocifs et aux vibrations transmises aux membres supérieurs au niveau de l’axe main/bras, par les engins et machines agricoles, ... Ces contraintes sont souvent cumulées, avec des efforts et mouvements répétitifs de la main et du membre supérieur, des positions accroupies, agenouillées ou penchées en avant fréquentes, une station debout prolongée et marche sur sol inégal, boueux, sableux...
Les risques liés à ces gestes et postures sont majorés si le travail s’effectue dans des conditions climatiques pénibles, de froid et d’humidité ou de chaleur excessives ou si la configuration du terrain est difficile (pentes...).
Les agriculteurs figurent parmi les métiers les plus concernés par les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire les affections péri-articulaires provoquant des douleurs des poignets (syndrome du canal carpien), des coudes (épicondylite , épitrochléite), des épaules (tendinites) et des lésions de la colonne vertébrale (cervicalgies, lombalgies, compressions du nerf sciatique) ainsi que des traumatismes aux genoux et aux chevilles (entorses).
Le vieillissement progressif des structures ostéoarticulaires peut aboutir à une inaptitude professionnelle, ce qui, de par leur fréquence et leur impact, tant médical que socioprofessionnel, constitue un problème majeur de santé au travail pour les agriculteurs : le risque total dépend de tous les facteurs (vibrations, élongations, torsions...) en instantané, mais aussi de la totalité des effets reçue au cours de la journée de travail et de la vie professionnelle.
Les risques liés à ces gestes et postures sont majorés si le rythme est trop soutenu par les conditions de rémunération au rendement, si le travailleur est inexpérimenté et/ou mal formé (notamment les saisonniers). - Exposition aux risques du machinisme agricole
La totale mécanisation des grandes cultures entraine l’usage de nombreuses machines et engins agricoles très variés pendant toutes les phases de l’exploitation, depuis la préparation des sols (épandage, labourage), les semis, les traitements des cultures jusqu’à la récolte (moisson, ...).
Les engins peuvent être des tracteurs auxquels sont attelés des remorques ou des outils (charrue, semoir, multiples autres outils selon la nature des travaux ...) ou bien des engins autotractés tels que la moissonneuse-batteuse, l’ensileuse, l’épandeur d’engrais ...
Les facteurs de risque professionnel sont souvent relatifs à des conditions dans lesquelles une énergie non contrôlée est libérée, gravitationnelle (chutes, renversements..), cinétique (heurts, happements...).
La durée d'exposition à la condition dangereuse, influence considérablement l’incidence des facteurs de risque : or, pour de nombreux agriculteurs, l’usage de ces engins est permanent tout au long de l’année, dans les champs et sur la route d’accès aux exploitations agricoles.
Les risques professionnels liés au machinisme agricole peuvent être classés selon qu’ils sont :
- mécaniques : heurts et happements (des doigts ou bras, de la chevelure ou des vêtements) par les parties mobiles en mouvement des machines (herses rotatives, lames en rotation rapide, fond de la trémie d’épandage ...), écrasement par des chutes de charges ou le renversement des engins dans les déclivités ou profondes ornières, coupures et perforations par les outils de travail, projections de particules solides (de bois, de roche, de débris végétaux dans les yeux), chute lors de la descente de l’engin ... La puissance relative par rapport au poids élevée, la faible stabilité pour les tracteurs enjambeurs notamment (hauteur du centre de gravité, polygone de sustentation) sont des facteurs aggravants de dangerosité d’origine mécanique.
- physiques : vibrations produites par les engins dans le poste de conduite, niveau sonore trop élevé, courant électrique, ...
Les accidents du travail causés par l’utilisation d’engins et de machines agricoles sont particulièrement graves et fréquents dans les exploitations agricoles :
Les interventions en cas de bourrage, les opérations d’attelage et de dételage, les travaux concernant les liaisons tracteurs-outils autour de l'arbre de transmission à cardans (avec des pièces mobiles à vitesse de rotation élevée), le contact direct avec une ligne électrique aérienne figurent parmi les situations les plus dangereuses. Le taux d’accidents mortels causé par l’éjection du conducteur de son siège ou consécutif au retournement du tracteur et à l’écrasement ou coincement du conducteur, est important dans le secteur agricole : soit des renversements sur le côté durant les opérations sur pente raide, au bord d’un fossé, soit des renversements vers l’arrière (cabrage) consécutif à une élévation de l’avant de l’engin.
Les chutes à la descente de la cabine du tracteur sont fréquentes du fait de l'engourdissement des membres inférieurs et/ou de la glissance du marchepied ou de la chaussée boueuse.
Les lames en rotation rapide peuvent aussi occasionner des projections sur les membres ou sur le visage d’éclats de bois ou de pierres ou de poussières ou de corps étrangers dans les yeux. Il y a des risques de happements des doigts, de la chevelure ou des vêtements dans les organes mobiles, lors des débourrages de machines par exemple.
Il y a aussi des risques de renversement des tracteurs dans les déclivités, de heurts avec les engins motorisés lors de leurs manœuvres.
Le jet d’un nettoyeur haute pression peut se révéler un sérieux danger pour l’opérateur ou son entourage sur toute partie du corps exposée, mais le danger peut provenir aussi du coup de fouet d’un flexible, de projections de débris pulvérisés par le jet.
Enfin, la faible vitesse relative des engins agricoles par rapport aux autres véhicules sur la route, leur gabarit important sont sources de risques d'accident routier. - Exposition aux risques chimiques agricoles
- De nombreux travailleurs agricoles, utilisent des pesticides (fongicides, insecticides, herbicides, raticides ...) de façon intensive et prolongée. Les grandes cultures céréalières et oléagineuses accumulent une forte proportion des pesticides utilisés du fait des vastes surfaces concernées. Les cultures de pomme de terre sont aussi très consommatrices de produits phytosanitaires.
Il y a le danger d’une intoxication aiguë, lors d’une exposition accidentelle, qui se manifeste par des troubles cutanés, digestifs, respiratoires, musculaires, nerveux, cardiovasculaires. Mais plus néfastes sont les risques d’intoxication chronique, résultant d’une exposition fréquente et prolongée à des doses faibles. Ils peuvent provoquer des troubles du système nerveux, des effets cancérigènes et mutagènes, et des perturbations endocriniennes : les risques induits par l'exposition directe et/ou indirecte aux pesticides ont des effets marquants sur la fréquence de certains cancers, les maladies neuro-dégénératives et le développement fœtal.
L’utilisation des pesticides, produits phytosanitaires pour la protection des récoltes ou produits contre les parasites, fréquente et massive, par épandage ou pulvérisation, présentent ainsi des risques importants pour la santé des travailleurs exposés et pour l’environnement. Le risque de contamination direct correspond au risque du travailleur qui est exposé directement aux produits lors du traitement par épandage ou pulvérisation du pesticide, mais aussi lors de la préparation du produit, du nettoyage et de la vidange de la cuve, de tout disfonctionnement du pulvérisateur (buses bouchées, rupture de tuyaux...).
Le risque de contamination indirecte correspond aussi à tout contact avec un élément pollué, tel que le matériel et l’emballage du produit pesticide, le végétal, le sol, les équipements, outils et engins de travail, les vêtements.
La pulvérisation par jet est le procédé actuellement le plus répandu (désherbage, protection). Les traitements aériens sont réservés aux surfaces d’accès difficile.
L’exposition des agriculteurs aux traitements phytosanitaires, lors de la préparation des bouillies, de l’épandage (défaut d’étanchéité des combinaisons, particulièrement au niveau des poignets, et des cabines), du nettoyage du matériel de pulvérisation ou des équipements de protection, de la ré-entrée sur les sites agricoles, est génératrice de risques chimiques importants.
Toute opération de pulvérisation commence par la préparation des bouillies et le remplissage de l’appareil. Cela constitue des phases critiques car des produits toxiques très concentrés sont alors manipulés avec des risques importants pour l’opérateur et l’environnement.
Les opérations de vidange et de nettoyage des appareils entraînent des incidents difficiles à gérer sans danger (prise en masse des produits dans la cuve, déversement accidentel des fonds de cuve).
Le traitement des semences pose aussi le problème de l’émission de poussières toxiques lors du stockage et de l’utilisation dans les semoirs.
On distingue les effets aigus (dus à des concentrations élevées) et chroniques (dus à de faibles concentrations, mais à des expositions répétées). Les effets aigus s'observent lors de fuites, éclaboussures suite à des rejets accidentels massifs de pesticides sous forme de gaz ou de liquides toxiques.
Si pour la toxicité aigue, le rapport de causalité est clairement identifié, il n'en est pas de même pour la toxicité chronique qui est beaucoup plus malaisée à cerner avec précision.
Les pesticides pénètrent dans le corps humain par trois voies :
orale (bouche, œsophage, appareil digestif)
La pénétration par cette voie se fait soit par ingestion accidentelle d’un produit ou par déglutition de produit, soit par contact direct, en portant des mains ou des objets souillés à la bouche.
respiratoire (nez, trachée, poumons)
Ce type de pénétration se fait par inhalation de poussières, fumées, gaz ou vapeurs, particules fines émises à la préparation du traitement et lors de la pulvérisation du brouillard de produit.
Ce risque est ainsi fortement présent lors des différentes phases de traitement. Les poumons ont une grande capacité de contact, de rétention et d’absorption des produits toxiques.
De plus, les voies respiratoires sont constituées de telle sorte qu’elles facilitent une diffusion très rapide de ces substances dans le sang.
C’est pourquoi l’inhalation de produits toxiques produit une action très rapide.
cutanée (y compris les yeux et les muqueuses)
C’est la voie principale de pénétration des produits : la peau est une barrière imparfaite contre les divers produits pesticides qui peuvent favoriser leur absorption par effet irritant ou décapant.
Certains produits sont susceptibles de traverser la peau, puis de passer dans le sang pour se fixer sur certains organes (foie, rate...) ou tissus (nerveux, graisseux) et aboutir, par conséquent, à des intoxications parfois très graves.
D’autres produits peuvent causer des lésions sur la peau à l’endroit du contact (rougeurs, irritations, brûlures...).
De plus, la chaleur et la transpiration accélèrent très souvent ce phénomène de pénétration.
L’effet peut être local, c’est-à-dire au point de contact (brûlures, irritations) ou général si le produit pénètre à travers la peau ou les muqueuses.
Dans la plupart des cas, si la protection des voies respiratoires est importante, bien trop souvent le risque de pénétration par la peau ou les muqueuses est encore sous-estimé.
- Si les risques des substances chimiques des pesticides sont très importants pour la santé des agriculteurs, les engrais présentent eux aussi des dangers quoique bien moindres, mais qu’il ne faut pas négliger pour autant : toutefois, les effets toxiques, après exposition professionnelle aux engrais, sont assez restreints compte tenu des millions de tonnes manipulées chaque année.
Les divers produits fertilisants peuvent causer des lésions sur la peau à l’endroit du contact (rougeurs, irritations, ...) par effet irritant. La chaleur et la transpiration accélèrent très souvent ce phénomène.
Le principal danger des engrais minéraux chimiques inorganiques vient des composantes azotées, qui sont présentes dans la plupart des engrais. Les composants azotés sont les nitrates NO3, l'ammonium NH4 (généralement sous la forme de nitrate d'ammonium NH4NO3) et l'urée.
Les particules très fines de nitrate d’ammonium pénètrent dans les poumons : lors de l’épandage en milieu agricole ou de la remise en suspension depuis les lieux de dépôt ou lors de certaines manutentions, l’inhalation de poussières peut être responsable d’une irritation oculaire, rhino-pharyngée et trachéale, irritation des muqueuses et des voies respiratoires, une toux accompagnée de difficultés respiratoires.
La projection de poussières de nitrate d’ammonium dans les yeux peut causer larmoiement, douleurs, troubles de la vision, irritations et atteinte de la cornée.
Les engrais azotés sont à l’origine de décompositions avec émanations de composés gazeux d’azote, à partir du sol ou de la matière fertilisante azotée, par dégagement direct dans l’atmosphère d’ammoniac ou d’oxyde d’azote.
L'ammoniac (NH3) est produit par les engrais azotés qui exhalent ce gaz qui se volatilise par dégagement direct dans l’atmosphère, ou du fait de l’hydrolyse en ammoniac par l'enzyme uréase présente dans le sol : l’ammoniac est toxique pour ceux qui épandent l'engrais, notamment par temps chaud, sec et sans vent ; l'inhalation provoque l'irritation du nez, de la gorge et des poumons. En plus, l'ammoniac libéré par volatilisation au moment de l’épandage d’engrais se combine avec d'autres polluants présents dans l’atmosphère, formant des particules secondaires très fines en suspension (matières particulaires PM 10 à PM 2.5, c'est-à-dire « Particulate Matter » de taille inférieure à 10 ou à 2.5 microns) qui peuvent stagner dans l'air environnant pendant plusieurs jours et qui atteignent les bronches et les alvéoles pulmonaires, à l’origine à la longue de l’inflammation des tissus pulmonaires et de maladies respiratoires chroniques.
L’inhalation des gaz libérés par la décomposition thermique du nitrate d’ammonium (oxydes d’azote très toxiques) en milieu confiné provoque une irritation aiguë des voies respiratoires.
La cyanamide calcique (CaCN2) doit être utilisée avec précaution : nocive en cas d’ingestion, elle irrite aussi la peau, les muqueuses et les voies respiratoires et peut provoquer des risques de lésions oculaires.
- Renversement et contact avec huiles, carburants utilisés pour les engins agricoles, sortie des gaz d’échappements non conforme et moteurs mal réglés, et exposition notamment à la présence d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dont certains sont cancérigènes et qui peuvent provoquer des troubles neurologiques. - Exposition aux risques biologiques agricoles
- L'exposition à des environnements de travail agricole contaminés en poussières organiques est à l’origine de nombreuses pathologies professionnelles pulmonaires : asthme, bronchite chronique, pneumopathie d’hypersensibilité, broncho-pneumopathie chronique obstructive, syndrome toxique des poussières organiques.
La manipulation de céréales, de paille, de compost, de grain moisi, exposent les agriculteurs à des quantités élevées de poussières organiques et de micro-organismes (acariens, moisissures et microbes et leurs toxines fongiques et bactériennes), responsables en particulier de la fréquente maladie du « poumon du fermier » (pneumopathie d’hypersensibilité), de la « fièvre des poussières » (syndrome toxique des poussières organiques ou ODTS Organic Dust Toxic Syndrom).
De nombreux symptômes relatifs à l’exposition aux poussières organiques sont encore largement sous-diagnostiqués avec une épidémiologie souvent mal connue et une dangerosité plus insidieuse, notamment en agriculture.
Ces poussières se retrouvent souvent en concentrations élevées dans les lieux clos et espaces confinés (zones de stockage, caves, ateliers ...).
Les poussières organiques en suspension dans l’air sont facilement inhalables, se logent dans la muqueuse nasale et certaines particules très fines réussissent à traverser la cavité nasale et à pénétrer jusqu’aux alvéoles pulmonaires à travers tout l’arbre respiratoire.
- Les sources potentielles de danger par inhalation lors d’épandage d’engrais organiques (fumier, purin, lisier, boues de stations d’épuration...) sont les émissions toxiques diffuses de vapeurs, poussières, la présence de composés traces organiques (CTO), d’éléments traces métalliques (ETM), de bioaérosol, l’envol de micro-organismes, ...
Les engrais organiques issus de déjections animales, boues de station d’épuration ... présentent des dangers biologiques (bactéries, virus et parasites) dont les possibilités de contamination sont faibles, du fait du traitement d’hygiénisation (consistant à détruire les micro-organismes pathogènes) auxquels ils ont été soumis.
Des infections digestives par les salmonelles, les listeria, les escherichia coli, les clostridies, d’autres entérobactéries ou encore par des œufs d’helminthes ou cysticercose (ténia), sont néanmoins possibles suite à l’ingestion accidentelle de particules d’engrais organiques. De même que des infections cutanées secondaires à des blessures septiques ou coupures souillées par de la terre contaminée qui peuvent se surinfecter à cause des germes pathogènes contenus dans les fertilisants organiques (panaris des doigts, furoncles, ...).
Les troubles de contact respiratoire sont aussi assez fréquents avec les fertilisants organiques, responsable de rhinites, d'asthmes professionnels, de maux de tête et de nausées.
- Les morsures d’animaux (venins des serpents ...), les piqûres d’insectes (abeilles, guêpes et frelons ...) exposent les agriculteurs à d’autres risques biologiques. - Les risques des travaux en extérieur
Le travail en extérieur conduit les agriculteurs des grandes cultures à être exposés aux ultraviolets (UV), aux intempéries, au froid ou à la chaleur, et à l’humidité.
L’exposition fréquente aux UV, surtout torse nu, peut être responsable de cancers de la peau, et, en tout cas, d’érythème solaire (coup de soleil).
Les problèmes de santé dus à la chaleur et à l'action prolongée du rayonnement solaire sur la tête (effets de l’insolation, de la déshydratation...) génèrent des risques de malaise général, de crampes musculaires, de pertes de connaissance. Indirectement, le travail par fortes chaleurs augmente aussi les risques d'accidents du travail par la fatigue, la sudation, la diminution de la vigilance.
Pour des travaux en extérieur, le risque lié au froid est accru par une exposition au vent (refroidissement éolien) et à l’humidité. Le refroidissement des parties du corps peut provoquer des engelures, des lésions cutanées. Les mains et les pieds (surtout doigts ou orteils) ont tendance à se refroidir plus rapidement que le torse : l’exposition au froid est susceptible de déclencher le syndrome de Raynaud (doigts blancs et douloureux par vasoconstriction). Les mycoses aux pieds sont favorisées par les travaux dans des zones humides et/ou boueuses. Comme pour la chaleur, le froid entraine des risques indirects, favorisés par la diminution de la dextérité due au refroidissement des extrémités, à la diminution des performances musculaires et à l’incapacité à effectuer des mouvements fins. La vigilance mentale est également réduite en raison de l'inconfort causé par le froid. - Les risques professionnels des travailleurs agricoles saisonniers
Les emplois saisonniers sont très nombreux dans les secteurs de l’agriculture et les travailleurs saisonniers sont plus exposés aux risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles du fait de la précarité de cette main d’œuvre, leur manque d’information, de formation et de connaissances des lieux et des procédés qui augmentent ainsi leur vulnérabilité.
De nombreuses études montrent que le travail saisonnier est associée à une dégradation des conditions de travail et de la situation des saisonniers en matière d’hygiène et de sécurité (fréquence et gravité des accidents de travail, notamment les premiers jours d’emploi et en fin de contrat).
Le contexte de travail du saisonnier génère de multiples facteurs qui affectent ses conditions de travail et plusieurs raisons expliquent la vulnérabilité supérieure des saisonniers, notamment pour les saisonniers agricoles (dissémination sur les exploitations, enchainement de contrats courts, pénibilité et rythme du travail, population souvent précarisée) ; cela provoque notamment :
- Risques physiques liés aux contraintes du travail en extérieur (exposition aux rayons ultra-violets, à la chaleur, piqures d’insectes, corps étrangers dans les yeux...)
- Risques de chutes de plain-pied et de hauteur : glissades et trébuchements liées à la topologie du terrain ou à un obstacle non repéré sur un sol encombré (entorses, contusions...),
- Mais aussi exposition non protégée aux produits chimiques notamment phytosanitaires (troubles cutanés, respiratoires...),
- Risques liés au manque de formation, d’expérience pour résoudre un problème efficacement et sans danger, ce qui se traduit par un « bricolage » hasardeux, entrainant des risques mécaniques, électriques... - Les risques du travailleur agricole isolé
Le travailleur agricole de plein champ effectue souvent seul des travaux ou une tache en étant hors de portée de vue ou de voix pendant un certain temps, et ainsi, il ne dispose pas de possibilité de recours en cas d’aléas, d’accident ou de malaise. La durée d’isolement majore évidemment le risque : le travail isolé aggrave la dangerosité de l’activité, car, par exemple, des réactions inadaptées à une situation imprévue peuvent apparaître du seul fait de ne pouvoir se faire aider.
Le travail isolé peut être dangereux intrinsèquement pour des raisons médicales : certaines personnes présentent des pathologies entrainant des symptômes d’apparition brusque et pouvant handicaper au moins temporairement la poursuite du travail, la rendre dangereuse (en particulier lors de la conduite d’engins), voire impossible : crises d’angoisse, d’épilepsie, cardiaques, diabétiques, vertigineuses ...
Bien entendu, l’isolement aggrave non seulement la probabilité d’accident mais aussi sa gravité, c'est-à-dire majore le niveau de criticité de l’activité professionnelle sur ses deux composantes. En effet, les conséquences de l’accident sont aggravées parce que les dommages causés par l’accident empirent par manque de secours immédiat et/ou adapté. - Les risques psychologiques du travailleur agricole
L’isolement géographique et social ou encore le faible revenu des exploitants agricoles accroissent les exigences et des pressions psychologiques exercées sur le psychisme de l’agriculteur. L’excès de charge mentale qui en résulte génère des conditions de travail stressantes, responsables de risques psychosomatiques, conduites addictives et somatisations (maladies cardio-vasculaires, troubles musculo-squelettiques, troubles gastro-intestinaux, états d’anxiété et dépressifs, suicides...).
Les mesures de prévention des risques professionnels des agriculteurs
Voir les dossiers suivants :
- La prévention des risques des engins et machines agricoles
- La prévention des risques professionnels des pesticides
- La prévention des risques professionnels des engrais
- La prévention des risques professionnels des risques des poussières organiques
- Les équipements de protection individuelle de prévention des risques phytosanitaires
Pour aller plus loin
Pour les cultures spécialisées :
- La prévention des risques professionnels de l’horticulture et du maraîchage
- La prévention des risques professionnels des arboriculteurs
Septembre 2019
Partagez et diffusez ce dossier
Laissez un commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.