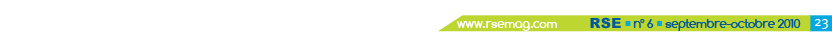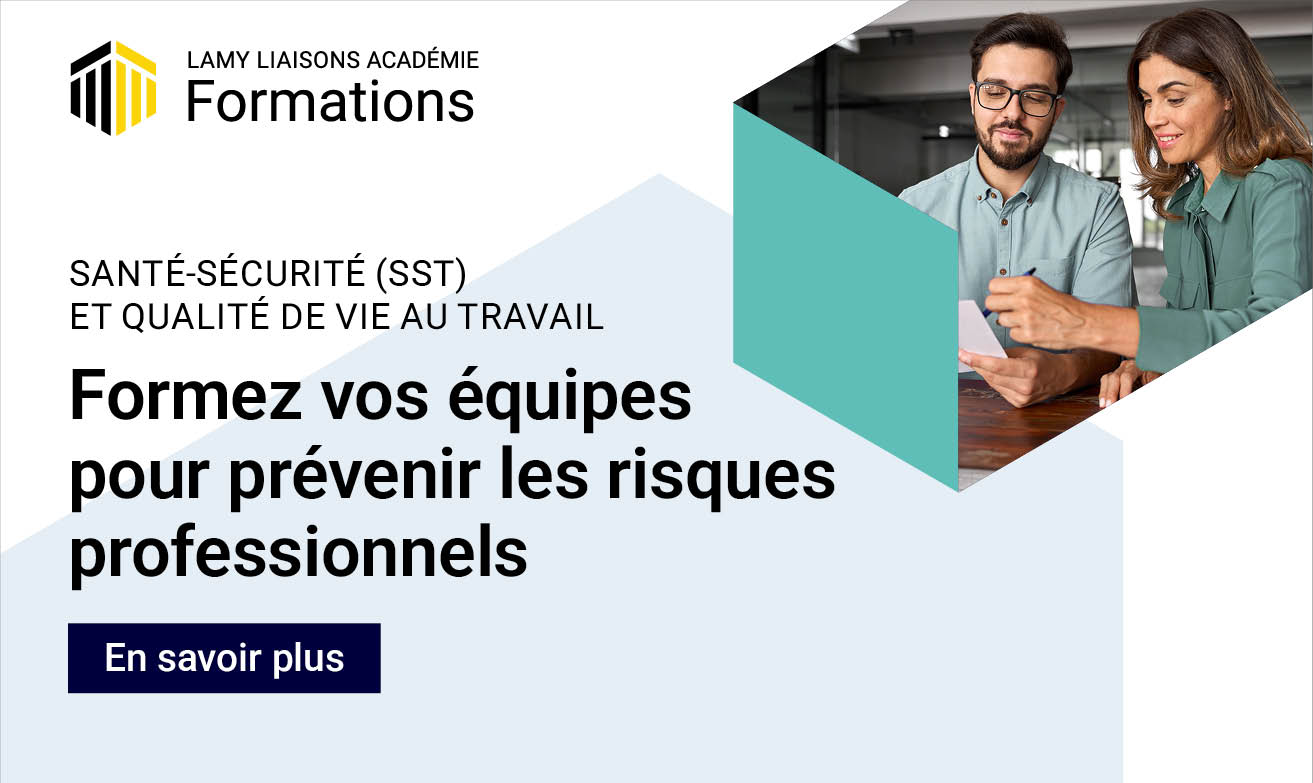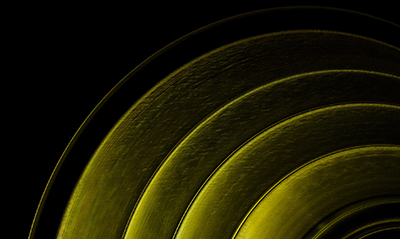SST et environnement : de la difficulté des victimes à être indemnisées
Les procédures d'engagement de la responsabilité semblent plus favorables au salarié qu'à la victime extérieure d'un accident. Mais les conditions d'indemnisation profi tent davantage à celle-ci qu'à la victime salariée...
Si la finalité de la responsabilité civile est de nos jours essentiellement focalisée sur l'indemnisation des dommages, la victime n'est pas toujours placée dans une situation favorable lui permettant soit de poursuivre le responsable, soit d'obtenir une réparation intégrale des préjudices qu'elle a subis. Un accident qui aurait des répercussions à la fois sur les salariés de l'entreprise et à l'extérieur de celle-ci aurait pour conséquence de placer les victimes dans des situations très inégales, selon que l'on considère le responsable comme employeur ou comme tiers par rapport à la victime. Force est de constater des procédures d'engagement de la responsabilité plus favorables au salarié qu'à la tierce victime, et à l'inverse des conditions d'indemnisation plus favorables à celle-ci qu'à la victime salariée.
Des procédures d'engagement de la responsabilité civile difficiles pour les victimes extérieures à l'entreprise
La loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail et les textes suivants1 ont constitué une avancée sur le plan de la responsabilité, en abandonnant le fondement de la faute : la responsabilité du chef d'établissement est engagée de manière automatique dès lors qu'il a failli à son obligation de sécurité de résultat. Les salariés bénéficient ainsi d'un régime de responsabilité particulier ayant pour effet de simplifier les procédures d'indemnisation. D'une part, tout accident survenu au temps et au lieu du travail est réputé d'origine professionnelle, sauf preuve d'une cause étrangère au travail. D'autre part, sont réputées d'origine professionnelle les maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles, listant les produits ou les travaux susceptibles de les provoquer et les délais de prise en charge2. Le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ouvre droit à une indemnisation automatique du salarié.
À l'inverse, la victime d'un accident industriel, ayant subi des dommages corporels ou matériels (mobiliers, immobiliers) ou développant une maladie dont la cause est liée à la pollution générée par une entreprise riveraine, se heurte à de multiples obstacles pour engager des poursuites contre le responsable.
L'existence d'un contrat d'assurance couvrant les dommages occasionnés par un accident industriel constitue le moyen le plus simple pour la victime d'obtenir une indemnisation de son dommage. En cas de survenance d'un accident dans une installation classée soumise à autorisation ou à déclaration et endommageant un grand nombre de biens immobiliers3 ou d'accidents liés au transport de matières dangereuses ou causés par les installations mentionnées à l'article 3-1 du Code minier (cavités souterraines naturelles ou artificielles), la reconnaissance de l'état de catastrophe technologique ouvre droit pour les victimes à des modalités spécifiques d'indemnisation des dommages (réparation intégrale des dommages, dans la limite des valeurs déclarés au contrat, des biens à usage d'habitation ou placés dans des locaux à usage d'habitation situés en France, ainsi que des dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur). L'indemnisation est versée par l'assureur des biens de la victime, lorsqu'elle est assurée ou par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, si les biens ne sont pas assurés. Cependant, les règles d'indemnisation mises en place par la loi de 2003 ne concernent que les dommages matériels, mobiliers et immobiliers.
Les préjudices corporels ne bénéficient pas de la même simplification des règles de procédure, permettant d'obtenir l'indemnisation des dommages. En conséquence, pour ce type de préjudice et ceux n'entrant pas dans le champ d'application de la catastrophe technologique, la victime n'a d'autre choix que de s'adresser à l'assureur du responsable.
Mais celui-ci est-il assuré en responsabilité civile ? Hormis quelques activités identifiées par le législateur4, l'exploitant d'une activité industrielle n'est pas obligé de s'assurer pour les dommages que son activité est susceptible de causer et peut ne pas être couvert en cas de sinistre. De ce fait, la victime peut se trouver confrontée à l'insolvabilité du responsable.
De plus, même si celui-ci a pris soin de contracter une garantie d'assurance, la victime peut pour autant ne pas être indemnisée.
Tout dépendra de l'étendue de l'engagement de l'assureur, qui peut avoir prévu des plafonds de garanties, c'est-à-dire un montant maximal d'indemnisation au-delà duquel l'assureur n'intervient pas, à charge pour le responsable d'indemniser le dommage résiduel.
L'exploitant d'une activité industrielle n'est généralement pas obligé de s'assurer pour les dommages que son activité est susceptible de causer
La victime peut aussi se heurter au refus de l'exploitant d'assumer sa responsabilité, auquel cas il lui faudra engager une action en justice avec la difficulté de choisir, parmi la multitude de régimes de responsabilité, le plus adapté pour obtenir une indemnisation de son dommage. Il faut préciser qu'il n'existe pas de régime de responsabilité spécifique relatif au risque industriel. La victime doit ainsi fonder son action sur les régimes de responsabilité de droit commun et apprécier, au moment de son recours, la voie la mieux adaptée à la nature de son préjudice : responsabilité pour faute (articles 1382 et 1383 du Code civil), qui reste le droit commun de la responsabilité civile ou régime de responsabilité objective, si les conditions sont remplies (dommages liés à l'utilisation de l'énergie civile à des fins civiles, dommages de pollution résultant de rejet d'hydrocarbures transportés par voie maritime, dommages causés par les produits défectueux, responsabilité du fait des choses en vertu de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, responsabilité pour troubles anormaux du voisinage).
Mais d'une manière générale, toute voie contentieuse de règlement des conflits constitue une embûche : coût, lenteur de la procédure, crainte de perdre un procès... La victime d'un préjudice dont le fait générateur est liée à une activité industrielle, souvent réduite à ses seules forces, peut ainsi hésiter à s'orienter vers une action contentieuse, notamment si le montant de son préjudice est dérisoire, bien qu'en réalité considérable en raison du nombre de victimes.
De plus, les régimes de responsabilité civile applicables dans le domaine des risques industriels présentent plusieurs inconvénients qui sont autant d'écueils pour les victimes : preuve du non-respect d'une obligation en cas de responsabilité pour faute, limite des plafonds de garantie et prescription dans le temps des actions en responsabilité, dans certains régimes légaux de responsabilité objective5, exonération de responsabilité pour force majeure ou cause étrangère.
La victime tierce à l'entreprise se trouve également confrontée à une autre difficulté : la charge de la preuve. L'accident industriel ne conduit pas à établir des dérogations par rapport aux règles classiques de procédures : le plaignant doit établir le lien de causalité entre l'événement et le dommage subi. La décision concernant l'explosion d'AZF du 19 novembre 2009 est particulièrement éloquente sur la difficulté relative à l'établissement du lien de causalité. Les magistrats du tribunal correctionnel ont relevé que « si les dommages (décès, blessures, dégradations) sont patents et la preuve des fautes organisationnelles dans l'enchaînement causal retenu par l'acte de poursuites démontré, le lien de causalité qui doit être établi entre ces préjudices et ces fautes est incertain, la présence de DCCNA dans la benne blanche litigieuse déversée entre 15 et 30 minutes avant la catastrophe dans le bâtiment 221 [n'est] pas avérée ».
Dans la même décision, ils soulèvent la difficulté d'établir le lien de causalité, dans la mesure où « l'ampleur de la catastrophe a effacé toute traces du composé qui a initié l'explosion ».
Dans cette affaire, les magistrats ont noté l'impossibilité d'établir de manière certaine le fait générateur, ce qui ne permet par conséquent pas d'établir le lien de causalité entre le fait générateur et l'explosion.
Les victimes du travail sont les seules victimes d'un dommage corporel à ne pas être intégralement indemnisées de leurs préjudices
Quant à l'indemnisation des préjudices, la situation est inverse. Une fois les écueils judiciaires franchis, les victimes tiers à l'entreprise peuvent obtenir la réparation de l'intégralité des dommages, directs et indirects, qu'elles ont subis : préjudices physique, matériel, moral, préjudice d'agrément (perte de la qualité de vie), pretium doloris (prix de la douleur). À l'inverse, le salarié, victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie reconnue comme maladie professionnelle, ne perçoit qu'une indemnisation forfaitaire de son dommage.
Des conditions d'indemnisation défavorables aux salariés
Cette indemnisation forfaitaire est la contrepartie prévue par la loi de 1898 sur les accidents du travail, en échange de la présomption d'imputabilité bénéficiant à la victime.
En 1898, la reconnaissance d'une responsabilité automatique de l'employeur est le fruit d'un « compromis social » : les salariés sont assurés d'une réparation automatique de leurs dommages corporels en échange de quoi ne pèse pas sur les employeurs l'indemnisation intégrale des préjudices subis par les victimes.
Les frais médicaux et paramédicaux sont pris en charge à 100 % par le régime Accidents du travail / maladies professionnelles (AT/MP), mais laisse à la charge de la victime les franchises médicales, ainsi que les suppléments d'honoraires. Ne sont pas non plus pris en charge les frais occasionnés par l'adaptation du véhicule ou du logement en cas d'handicap, ni les frais relatifs à l'assistance d'une tierce personne. Les indemnités journalières pour l'incapacité temporaire, versées dès le lendemain de l'accident et pendant les 28 premiers jours, s'élèvent à 60 % du salaire de référence et à 80 % passé ce délai de 28 jours. En ce qui concerne l'incapacité permanente partielle (IPP), pour une incapacité inférieure à 10 %, l'indemnité est versée sous forme de capital en application d'un barème forfaitaire, et pour une incapacité supérieure à 10 %, sous forme de rente, correspondant à une fraction de salaire perçu par la victime au cours des 12 mois précédant l'accident.
La mesure de l'IPP s'appuie sur un barème essentiellement médical et s'avère déconnectée de toute réalité, dans la mesure où il n'y a pas de relation entre ce taux et les conséquences professionnelles d'une invalidité. Ainsi, une faible IPP peut entraîner de lourdes conséquences sur le plan professionnel, sans recevoir de compensation financière.
Il faut préciser que la faute inexcusable6 commise par l'employeur ouvre la possibilité pour la victime d'obtenir une indemnisation complémentaire (article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale) : majoration de la rente ou du capital, réparation des préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudices esthétique et d'agrément...). Néanmoins, dans la réalité, même si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, la victime ne percevra pas pour autant une indemnisation de son entier dommage.
Plusieurs rapports ont dénoncé l'iniquité du régime AT/MP, l'inadéquation des modalités d'évaluation des dommages fondées sur la mesure de l'incapacité physique, l'insuffisante prise en compte des conséquences professionnelles pour la victime, son caractère obsolète ou anachronique au regard des évolutions juridiques relatives à l'indemnisation des dommages : rapport Dorion de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) relatif à la modernisation de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles (1991)7, rapport Massé intitulé « Réflexions et propositions relatives à la réparation intégrales des accidents du travail et des maladies professionnelles »8, rapport Yahiel9, « Vers la réparation intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles » (2002), rapport de la Cour des comptes (2001). Récemment, la Fédération nationale des accidentés de la vie a publié un livre blanc pour l'amélioration de l'indemnisation des victimes du travail10.
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel n'a pas fondamentalement remis en cause le régime d'indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles
À l'heure actuelle, le régime d'indemnisation AT/MP apparaît ainsi en complet décalage avec les autres régimes de responsabilité. Les victimes du travail sont les seules victimes d'un dommage corporel à ne pas être intégralement indemnisées de leurs préjudices.
Cette situation est d'ailleurs contraire à l'article 1 de la résolution (75) 7 du Conseil de l'Europe relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles (14 mars 1975) : « Compte tenu des règles concernant la responsabilité, la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci en ce sens qu'elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit ».
La réparation forfaitaire n'est pas le seul problème posé par le régime AT/MP. Les victimes peuvent se trouver dans des situations complètement inégales, du fait de l'intervention de certains fonds d'indemnisation ou de certains régimes de responsabilité, permettant à certaines d'entre elles d'obtenir une réparation intégrale de leurs préjudices, notamment en cas d'accident de la route en faisant appel au Fonds d'indemnisation des victimes d'infraction ou encore au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Pendant quelques semaines, les victimes AT/MP ont fondé leur espoir sur la décision du Conseil constitutionnel, suite à sa saisine selon les nouvelles modalités prévues par l'article 29 de la loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008. Depuis le 1er mars 2010, les justiciables bénéficient d'un nouveau droit leur permettant de poser une « question prioritaire de constitutionnalité », quel que soit l'état d'avancement de la procédure (première instance, appel, cassation) et quelle que soit l'instance (administrative ou judiciaire – civile, sociale, commerciale, ou pénale, y compris devant le juge d'instruction, sauf devant la cour d'assises). Cette « question » consiste à soutenir que la loi appliquée est contraire à une disposition constitutionnelle. La juridiction saisie doit ensuite examiner si la question posée est recevable, suffisamment sérieuse, et si elle n'a pas été déjà tranchée par le Conseil constitutionnel à l'occasion d'une saisine antérieure.
Elle la transmet le cas échéant à la juridiction suprême dont elle dépend (Conseil d'État ou Cour de cassation). À son tour, la juridiction suprême étudie la question et décide de la transmission ou non au Conseil constitutionnel. Celui-ci doit y répondre dans les trois mois de sa saisine. Si la disposition est reconnue comme non-conforme à notre constitution, elle est supprimée de notre droit, et le procès reprend sur de nouvelles bases. Dans le cas contraire, la juridiction devant laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée, applique le texte contesté. Cette disposition ne pourra plus faire l'objet d'une question de constitutionnalité, lors d'une autre procédure.
Cependant, rien n'empêche un juge, dans ce dernier cas, de déclarer la disposition contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme11.
Par un arrêt du 7 mai 201012, la Cour de cassation a transmis une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la question de la réparation intégrale des préjudices du fait d'un accident du travail. La victime énonçait que les dispositions du Code de la sécurité sociale sont contraires au principe constitutionnel d'égalité devant la loi et devant les charges publiques (articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789) et à l'article 4 de cette même Déclaration (tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige par celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer), ce qui fait obstacle à une réparation intégrale des préjudices subis et conduit en l'état actuel du droit, à laisser à la charge de la demanderesse les frais relatifs à l'aménagement de son domicile, ainsi que l'adaptation de son véhicule.
Cependant, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 18 juin 201013, n'a pas fondamentalement remis en cause le régime d'indemnisation des AT/MP. Il a estimé que les dispositions garantissent l'automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation et que la réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l'incapacité, l'exclusion de certains préjudices et l'impossibilité, pour la victime ou ses ayants droit, d'agir contre l'employeur n'instituent pas des restrictions disproportionnées par rapport aux objectifs d'intérêt général. Le Conseil constitutionnel a néanmoins émis une réserve relative à la réparation des dommages en raison de la faute inexcusable de l'employeur, en soulignant que les dispositions du Code de la sécurité sociale ne peuvent faire obstacle à ce que les victimes puissent demander la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Pour les victimes d'accident industriel, tiers par rapport à l'entreprise, la question reste aussi entière et ne semble pas faire l'objet d'une prochaine évolution. Le projet de réforme du droit des obligations, dit projet Catala14, prévoyait notamment d'introduire un nouveau cas de responsabilité de plein droit, incombant à l'exploitant d'une activité anormalement dangereuse, c'est-à-dire celle qui crée un risque de dommages graves pouvant affecter un grand nombre de personnes simultanément15. Pour l'heure, ce rapport n'a donné lieu à aucune modification du Code civil et certaines de ses propositions ont été contredites par un autre rapport du Sénat16.
Force est de constater le décalage entre la reconnaissance de principes forts en droit du travail et en droit de l'environnement et la réalité de l'application des régimes de responsabilité. Malgré les principes posés notamment par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Déclaration européenne des droits de l'homme, la Charte constitutionnelle de l'environnement du 1er mars 2005, le droit français n'a pas encore pleinement reconnu ces principes, pour faciliter ou permettre l'indemnisation des victimes, quel que soit leur lien juridique avec l'entreprise responsable.
Valérie Godfrin (CRC, Mines Paristech)
1. Notamment loi du 25 octobre 1919 (création des deux premiers tableaux de maladies professionnelles), loi du 27 janvier 1993 (portant diverses mesures d'ordre social), lois du 30 octobre 1945 et du 30 octobre 1946 (indemnisation des salariés victimes à la sécurité sociale), directive cadre 89/391/CEE du 12 juin 1989 (amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs).
2. Si la maladie dont souffre le salarié ne figure pas dans ces tableaux ou si toutes les conditions décrites dans le tableau ne sont pas remplies, il a la possibilité de déclencher une procédure complémentaire de reconnaissance en saisissant le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
3. Fixés à cinq cents logements rendus inhabitables, par l'article R. 128-1 du Code des assurances.
4. Par exemple, expert-comptable, médecin, avocat, agence de voyage, agent immobilier...
5. Par exemple, dix ans en matière nucléaire à compter de la manifestation du dommage ; dix ans en matière de produits défectueux à compter de la mise sur le marché du produit, mais la victime dispose de trois ans à partir du moment où elle a eu ou aurait dû avoir connaissance soit du dommage, soit du défaut, soit de l'identité du producteur.
6. La Cour de cassation a, par deux arrêts en date du 28 février 2002 (n° 00-11793, Bull. civ. IV, n°81), donné une nouvelle défi - nition de la faute inexcusable : elle est caractérisée dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié victime.
7. La Documentation française.
8. Réflexions et propositions relatives à la réparation intégrales des accidents du travail et des maladies professionnelles
9. Rapport Yahiel
10. Livre blanc pour l'amélioration de l'indemnisation des victimes du travail
11. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
12. n° 12005 (09-87.288).
13. n° 2010-8 QPC.
14. Rapport au Garde des Sceaux, 22 septembre 2005.
15. Art. 1362 du projet.
16. A. Anziani, L. Béteille, 2009.
Partagez et diffusez ce dossier
Laissez un commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.