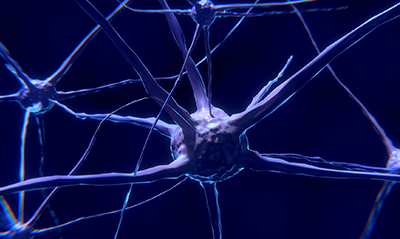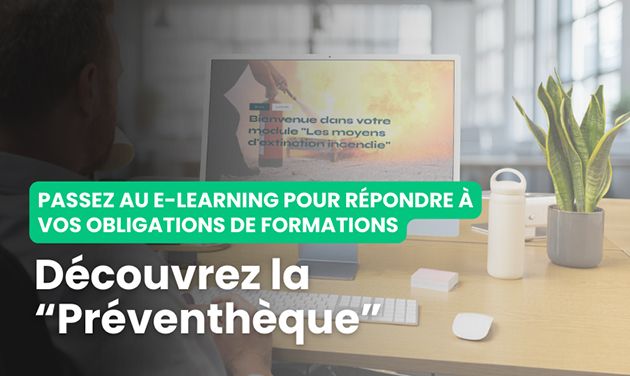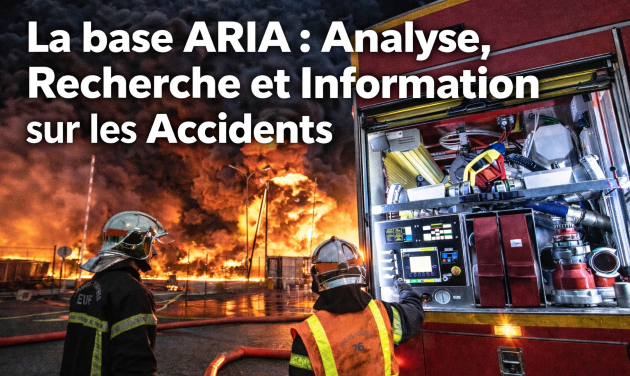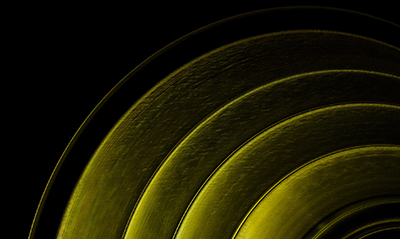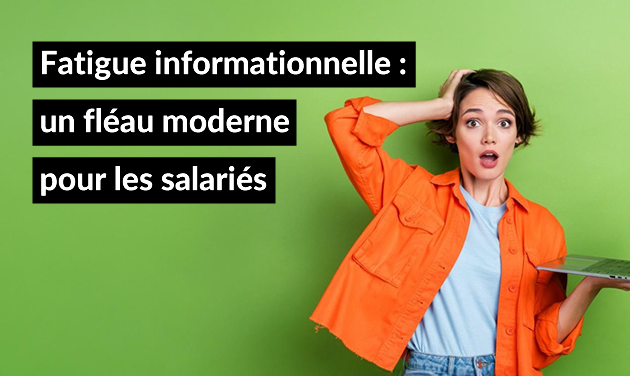
Les PME face aux risques professionnels
La recherche internationale met en avant de nombreuses spécifi cités des PME en matière de SST, de sorte que les méthodes et outils de prévention effi caces dans les grandes entreprises s’avèrent inadaptés. État des lieux.
Le poids des PME n’a cessé de croître dans les pays développés à économie de marché depuis les années 1970 ; elles y représentent aujourd’hui 50 % de la population active.
Cependant, alors que ces organisations semblent parées des vertus de la flexibilité et de l’innovation dans un contexte général de recherche de la performance, force est de constater qu’elles se distinguent nettement des grandes entreprises en termes d’accidents du travail, de maladies professionnelles et d’exposition des salariés aux risques liés à la santé et la sécurité au travail (SST). Pour l’ensemble des pays européens en 2000 (European Commission, 2003), les entreprises de moins de 250 salariés totalisaient 77,7 % des accidents du travail et 81 % du nombre de morts au travail.
Paradoxalement, alors que la PME gagnait ses lettres de noblesse en tant qu’objet d’étude des sciences de gestion dans les années 80, la problématique de la sécurité et de la santé dans ces entreprises est jusqu’à très récemment restée un sujet de recherche marginal et, il faut bien le dire, circonscrit à la littérature anglosaxonne. Hasle et Limborg en 2006, dans un état de l’art sur ce thème, ne recensaient que 284 références pertinentes dont 184 en langue anglaise, une large majorité de ces références (71 %) ayant été publiée entre 1995 et 2004. La question ne semble cependant pas sans intérêt dans la mesure où quel que soit le secteur d’activité, on constate des différences significatives des indicateurs de la SST selon la taille des entreprises.
La recherche internationale met ainsi en évidence plusieurs caractéristiques jouant un rôle non négligeable sur la performance SST de ces organisations :
– le rôle fondamental du chef d’entreprise, qui imprime un type de management fortement lié à sa personnalité et à son niveau de formation (Lamm, 2001) ;
– la particularité des relations sociales entre employeurs et salariés à l’origine d’une posture du chef d’entreprise qui déroge aux formes de management que l’on retrouve dans les grandes entreprises (Eakin, 1992 ; Eakin et al., 2003) ;
– une faiblesse en matière de représentation du personnel (Walters, 2001), particulièrement pour les entreprises de moins de 50 salariés qui ne disposent pas de CHSCT ;
– une main-d’oeuvre plus jeune, moins qualifiée et sous contrat de travail précaire (Lamm et Walters, 2002 ; Quinlan, 1997) ;
– une fragilité financière et un manque de moyens d’information, les petites entreprises n’ont ni les compétences ni les ressources pour assurer une veille juridique (Lamm et Walters, 2004) ;
– un isolement par rapport aux organismes de prévention. Dans le cas de la France, Lanoë (ISAST, 2006) a montré que lorsque le taux de couverture des services de la caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) variait entre 20 et 25 % pour les établissements de plus de 100 salariés, celui-ci n’était que de 10 % pour les PME de 10 à 49 salariés et d’à peine 1 % pour les très petites entreprises de moins de 10 salariés ;
– une vulnérabilité, conséquence dudéveloppement de la sous-traitance qui, en maintenant bon nombre de petites entreprises en situation de dépendance, aurait conduit les grandes entreprises donneuses d’ordres à externaliser une partie de leurs risques professionnels (Mayhew et Quinlan, 1997 ; Mayhew et Quinlan, 2001).
Les méthodes et outils de prévention conçus pour les grandes entreprises ne peuvent donc pas être transférés aux PME et la réflexion engagée sur les actionsà mener dans ces entreprises a été à l’origine d’un certain nombre d’actions de prévention, qui peuvent être schématiquement classées en deux grands groupes. Le premier groupe d’actions cible le chef d’entreprise considéré comme un acteur essentiel du niveau de prévention des risques, mais défaillant en termes d’information et de moyens, et a pour objectif de l’informer. C’est la raison pour laquelle les actions mises en place doivent susciter l’intérêt du dirigeant en utilisant l’environnement de l’entreprise. L’environnement réglementaire, quel que soit son degré de coercition, est une condition nécessaire mais non suffisante pour améliorer le niveau de prévention. Le dirigeant d’une petite entreprise est souvent peu au fait de ses obligations réglementaires. Une étude française à caractère monographique portant sur 22 entreprises de moins de 20 salariés a fait apparaître que sur le total d’entreprises, 7 seulement avaient entrepris une démarche d’évaluation des risques (ISAST, 2006). Pour être efficace l’information doit donc être relayée par des partenaires de l’entreprise tels que les experts-comptables, les clients, les fournisseurs et les donneurs d’ordres lorsqu’il y en a (Lamm, 1998 ; Walters, 2001).
Entreprises |
% |
Nombre d'accidents du travail pour 100 00 salariés* |
Nombre de morts pour 100 00 salariés |
% |
Entreprises individuelles |
5,2 |
2 309 |
3,6 |
8,1 |
Microentreprises (1-9 salariés) |
25,2 |
3 886 |
6,4 |
36,9 |
Petites entreprises (10-49 salariés) |
28,6 |
5 218 |
6,1 |
28,7 |
Entreprises moyennes (50-249 salariés) |
23,9 |
4 085 |
3,1 |
15,4 |
Grandes entreprises (+ 250 salariés) |
17,1 |
3 254 |
2,4 |
10,4 |
* Accidents du travail supérieurs à 3 jours (European Agency, 2003)
Accidents du travail dans neuf secteurs européens et Norvège en fonction de la taille
D'après les statistiques sociales européennes-accidents au travail et santé au travail-données 1994-2000, Eurostat, 2002
Un second groupe d’actions de prévention s’intéresse aux salariés. Le niveau de prévention des risques est en effet très largement lié à une co-construction des risques et de la prévention par le dirigeant et le salarié ; or, la particularité des relations sociales dans les petites entreprises constitue un frein à l’information. Ce manque général d’information des salariés (que soulignent d’ailleurs toutes les études internationales) plaide pour la mise en place de représentants du personnel et pour un rôle plus actif des syndicats (Walters, 2001). C’est l’objectif suivi par les études européennes qui s’inspirent largement du modèle suédois (Fricks et Walters, 1998).
Quelle que soit la cible des actions à mener, les différentes études posent la question des acteurs à mobiliser pour atteindre un niveau de prévention acceptable et celle des outils de prévention à mettre en oeuvre.
Dans ce dossier spécial sur la gestion des risques dans les petites entreprises, l’accent est mis à la fois sur les contraintes pesant sur les modes de gestion de ces organisations et sur la pression économique qu’elles subissent de leur environnement. En effet, dans un modèle économique marqué dans le même temps par une forte interdépendance des entreprises et un contexte accru de compétitivité, la prévention des risques professionnels ne peut être indépendante de ces facteurs. La recherche d’une gestion globale des risques adaptée aux niveaux de développement de l’organisation peut alors être une des réponses possibles aux défis qui sont lancés aux dirigeants des petites entreprises pour pérenniser leurs activités en garantissant la sécurité de leurs salariés.
Pour aller plus loin
Eakin, J. 1992. Leaving it up to the workers: Sociological perspective on the management of Health and Safety in small workplaces. International Journal of Health Services, 22. 689-704.
Eakin, J. et Mac Eachen, E. 1998. Health and the social relations of work: a study of health related experiences of employees in small workplaces. Sociology of Health and Illness, 20 (6), 896-914.
Eakin, J. Lamm, F. et Limborg, H.J. 2000. International perspectives on the promotion on health and safety in small workplaces. In Frick, Jensen PL, Quinlan M, Wilthagen T (ed). Systematic Occupational Health and safety management-Perspectives. On an International Development, Elsevier.
European Agency for Safety and Health at Work. 2003. Improving occupational Health and safety in SMEs.
European Commission. 2003. Work and health in the EU: A statistical portrait, Data 1994-2002. Eurostat, Theme 3 Population and social conditions.
Fricks, K., Walters, D.R. 1998. Worker representation on health and safety in small enterprises: lessons from a Swedish approach. International Labour Review, vol. 137 n°3 pp. 367-389.
Hasle, P., Limborg, H.J. 2006. A review of the literature on preventive occupational health and safety activities in small enterprises. Ind. Health 44, 6-12.
ISAST. 2006. Les pratiques et les politiques de prévention des risques professionnels dans les très petites entreprises, étude commandée par la DARES.
Lamm, F. 1997. Small Businesses et OHetS Avisors’. British Journal of Safety Science, 25 (1-3). 153-161.
Lamm, F. 1999. Occupational Health and Safety in Australian Small Businesses : What can be done to reduce the lack f awareness and raise the level of compliance in Australian small businesses? National Occupational Health and Safety Commission, Canberra.
Martin, C., Guarnieri, F. Pratiques de prévention des risques professionnels dans les PME-PMI (2008).
Tec & Doc Lavoisier, Paris.
Mayhew, C., Quinlan, M. 1997. The management of health and safety where sub-contractors are employed.
Journal of Occupational Health and Safety. Australia.
Mayhew, C., Quinlan. M. 2001. The effect of changing patterns of employment on reporting occupational injuries and making worker’s compensation claims, Safety Science Monitor, Vol 5. Issue 1.
Walters, D.R. 2001. Health and safety in Small enterprise. European Strategies for Managing improvement, P.I.E-Peter Lang S.A, Brussels.
Partagez et diffusez ce dossier
Laissez un commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.