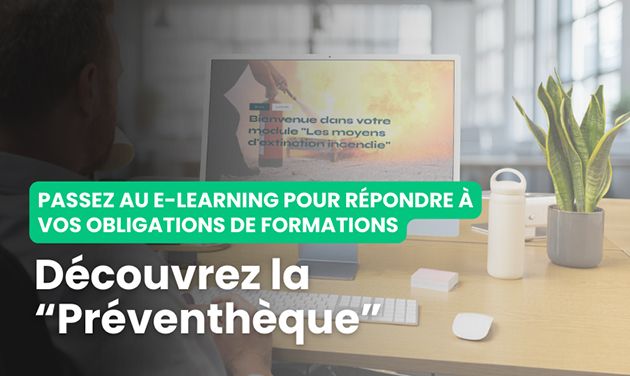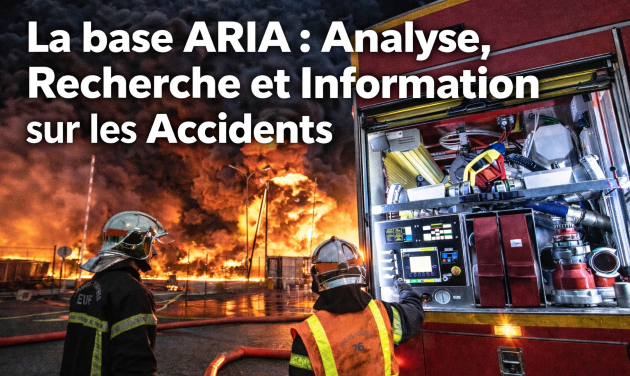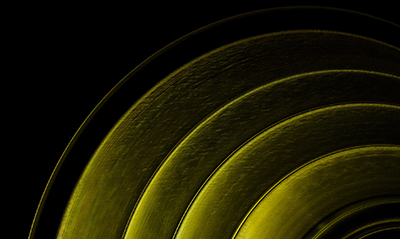L'industrie fabrique et utilise de grandes quantités de caoutchouc (pneus, courroies, joints, tuyaux, bottes, gants imperméables,...,) et la préparation du mélange à base de caoutchouc et de nombreux ingrédients chimiques (noir de carbone, soufre, huiles, ...), ainsi que la vulcanisation et la transformation du caoutchouc en produit fini, nécessitent la manipulation d'agents chimiques dangereux, dont certains sont cancérogènes et d'autres allergisants ou irritants respiratoires ou cutanés. Par ailleurs, les opérations de mise en œuvre des produits en caoutchouc s'effectuent à des températures élevées qui, outre le dégagement de poussières et l'émanation de vapeurs toxiques, génèrent des risques d'explosion et d'incendie redoutables ...
L'industrie fabrique et utilise de grandes quantités de caoutchouc (pneus, courroies, joints, tuyaux, bottes, gants imperméables,...,) et la préparation du mélange à base de caoutchouc et de nombreux ingrédients chimiques (noir de carbone, soufre, huiles, ...), ainsi que la vulcanisation et la transformation du caoutchouc en produit fini, nécessitent la manipulation d'agents chimiques dangereux, dont certains sont cancérogènes et d'autres allergisants ou irritants respiratoires ou cutanés.
Par ailleurs, les opérations de mise en œuvre des produits en caoutchouc s'effectuent à des températures élevées qui, outre le dégagement de poussières et l'émanation de vapeurs toxiques, génèrent des risques d'explosion et d'incendie redoutables à la mesure des matériaux et gaz inflammables présents dans les ateliers et des risques de brulures pour les travailleurs.
De plus, il faut prendre en compte les risques professionnels non spécifiques à cette industrie, liés aux manutentions, au bruit, à la possibilité des contacts avec des conducteurs électriques sous tension, ...
Par des mesures de prévention appropriées, on peut réduire toutes ces expositions et diminuer fortement les risques professionnels dans les industries du caoutchouc.
Les principaux risques dans les industries du caoutchouc
Il y a de multiples sortes de risques dans l'industrie du caoutchouc, liés aux produits, aux procédés et aux machines utilisées : chimiques (respiratoires et cutanés), thermiques, mécaniques, incendies ou explosions.
- Les risques chimiques causés par la toxicité des composants du caoutchouc
Le caoutchouc, qu'il soit naturel (latex) ou synthétique (butyle, nitrile, néoprène, ...), s'utilise malaxé à d'autres ingrédients qui donnent au mélange des propriétés particulières facilitant la mise en œuvre ou apportant des qualités spécifiques aux produits finis (élasticité, résistance mécanique, à l'abrasion, aux rayons ultraviolets) : charges renforçantes (noir de carbone...), accélérateurs ou retardateurs de vulcanisation à base de composés organiques soufrés (dithiomorpholine...), agents plastifiants (phtalates, huiles ou cires), agents gonflants pour le caoutchouc alvéolaire ou expansé, ignifugeants, antioxydants (amines aromatiques) ...
La toxicité du caoutchouc provient donc à la fois de la composition de l'élastomère initial, des composants auxiliaires dans les mélanges et du dégagement de produits de dégradation thermique lors les opérations de mise en œuvre et d'usinage, dont la composition peut être différente des produits initiaux.
Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) classe l'industrie du caoutchouc (dont le rechapage) dans le groupe 1, comportant des expositions qui sont reconnues comme cancérogènes avérées ou possibles selon les produits chimiques concernés.
Les risques cancérogènes sont dus à l'inhalation de fumées, voire à l'ingestion de particules, contenant des amines aromatiques, des nitrosamines, des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) dont le benzène, et des poussières de suies de carbone.
Un excès du risque de cancers de la vessie, du poumon et de leucémies a été constaté chez les ouvriers ayant longtemps travaillé dans l'industrie du caoutchouc et ces maladies figurent dans tableaux des maladies professionnelles indemnisables n°4 (Hémopathies provoquées par le benzène), n°15 ter (Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques), n°16 bis (Affections cancéreuses provoquées par les suies de combustion du charbon).
Si le danger d'exposition est le plus important durant la production de caoutchouc synthétique (par exemple au butadiène, à l'isoprène...) et les étapes de vulcanisation (par exemple avec la réaction chimique d'accélérateurs et de stabilisateurs chimiques aminés avec l'azote), l'émission de produits volatiles à partir du produit en caoutchouc refroidi dans les lieux de stockage peut aussi se produire.
Outre le risque de cancer, les fumées émises lors des étapes de production, de vulcanisation et de transformation du caoutchouc sont irritantes pour les voies respiratoires, et peuvent provoquer de l'asthme professionnel. Les pathologies induites présentent un caractère le plus souvent chronique, hors exposition accidentelle à des concentrations massives (entrainant des troubles neurologiques, vertiges, céphalées...) : les effets respiratoires chroniques n'apparaissent qu'après une exposition régulière et prolongée, comme la pneumoconiose au graphite, les broncho-pneumopathies chroniques ou la fibrose pulmonaire.
Par ailleurs, les caoutchoucs (surtout le latex et les accélérateurs de vulcanisation), induisent des eczémas et dermites par réaction allergique lors d'un contact cutané.
Une concentration atmosphérique devient très dangereuse lorsque des travailleurs souffrent de picotements des yeux, d'irritations respiratoires, de céphalées, vertiges, nausées, ce qui implique une évacuation et le port d'équipements individuels de protection respiratoire pour les agents chargés des réparations des installations de production ou de ventilation.
- Les risques thermiques causés par les procédés de fabrication des produits en caoutchouc
Les opérations de mise en œuvre, malaxage, moulage ou extrusion, vulcanisation... s'opèrent à des températures approchant ou dépassant 200 °C.
Le malaxage s'effectue dans des cylindres chauffants, le moulage par injection dans un moule chauffé ou par compression avec formage sous une presse hydraulique chauffante (dont les parois sont usinées afin de reproduire les sculptures et les marquages des pneus par exemple), l'extrusion (pour la fabrication des tuyaux) avec vulcanisation sous autoclave ou dans un four à air chaud ou à micro-ondes.
Du fait de ces procédés, les locaux des ateliers sont donc particulièrement exposés aux températures élevées et aux risques de brûlures thermiques.
Les mouleurs et les démouleurs, les autoclavistes sont exposés à la chaleur lors de l'ouverture des fours ou des moules sortant des presses ou lorsqu'ils s'approchent de pièces chaudes pour le travail d'ébarbage : les efforts physiques et la chaleur dans ces postes provoquent une hyperventilation, et la proximité d'une source de chaleur peut entrainer des céphalées, hypersudation, tachycardie, hypotension et, conjuguée à des températures de l'air élevée, provoquer des malaises dus à la déshydratation et des troubles circulatoires. Au-delà de 25 oC, l'inconfort se fait ressentir avec, de plus, toutes les conséquences psychologiques que cela peut avoir sur la précision des gestes, la vigilance et donc la sécurité (diminution des capacités de réaction, irritabilité, agressivité).
Les interventions sur des machines et des équipements chauds entrainent la possibilité de brûlures, notamment pendant les périodes de montage, réglage et maintenance.
- Les risques mécaniques causés par les machines de fabrication des produits en caoutchouc
Des risques mécaniques de happement et de coincement existent notamment pour les travailleurs chargés de la maintenance, avec la possibilité que des parties du corps et/ou des vêtements soient entraînés par des machines en marche. Dans les opérations de calandrage (mise en forme du caoutchouc pour fabriquer des feuilles), ces dangers sont présents lorsque les travailleurs essayent de débloquer le bourrage des mécanismes lors d'un incident de fonctionnement avec les cylindres de la machine encore en rotation.
- Les risques d'incendie et d'explosion dans les usines du caoutchouc
Beaucoup de composés utilisés dans les industries du caoutchouc présentent un risque important d'incendie et d'explosion lorsqu'ils sont exposés à la chaleur, aux étincelles, aux flammes ou aux oxydants. Par exemple, le butadiène forme facilement des peroxydes susceptibles de s'enflammer spontanément s'il est exposé à l'air ou à l'oxygène. Les dispersions de poudres, de poussières explosives, les accumulations de matériaux inflammables et de poussières de caoutchouc brûlant facilement en contact avec des matériaux chauds ou des flammes libres ou étincelles d'appareillages électriques mal isolés, génèrent des risques particulièrement graves d'incendie ou d'explosion.
- Autres risques des industries du caoutchouc
D'autres risques ne sont pas spécifiques aux métiers des usines de caoutchouc, mais communs à toute activité industrielle : chutes de plain pied sur sol glissant, inégal ou encombré, projections de corps étranger dans les yeux, électrisation/électrocution par utilisation d'outillage défectueux ...
Les charges lourdes portées manuellement, ou le nombre excessif de manipulations et mouvements avec torsion du dos, rotation pour le déplacement, flexion pour le soulèvement, ou la station debout prolongée ... sont à l'origine d'accidents de travail concernent la colonne vertébrale (dorsalgies, lombosciatiques) et le vieillissement progressif des structures ostéoarticulaires.
Les sources de bruits dues au fonctionnement des machines dans les ateliers de fabrication de produits en caoutchouc sont nombreuses : en dehors des atteintes au système auditif (déficit auditif, acouphènes...), le bruit ambiant excessif peut entraîner une gêne ou un stress vecteur de troubles du psychisme qui nuisent non seulement à la santé du travailleur mais aussi à la sécurité de son travail par baisse de vigilance et de dextérité ou de concentration.
Les mesures préventives des risques dans les industries du caoutchouc
La prévention la plus efficace est la prévention primaire avec la mise en place de technologies qui permettent des actions sur les produits (suppression ou emploi de produits de substitution de moindre impact potentiel sur l'homme) et/ou des actions sur les procédés (emploi de matériels ou de machines supprimant ou limitant au maximum les impacts, par de très faibles rejets atmosphériques, par de bas niveaux sonores...).
Les moyens de prévention à mettre en œuvre pour pallier les risques professionnels dans les industries du caoutchouc résident ensuite dans la prévention collective (ventilation efficace de l'atelier et aspiration à la source des poussières et fumées, stockage des produits chimiques et installation électrique et de protection incendie conformes aux normes, respect des règles générales d'hygiène...) qui diminue fortement les expositions et la fréquence ces accidents, puis dans la prévention individuelle (équipements de protection) qui en diminue nettement la gravité, enfin dans la l'information et la formation à la sécurité des travailleurs.
Par ailleurs, une surveillance médicale renforcée est obligatoire pour les salariés exposés aux risques chimiques des industries du caoutchouc.
- La suppression / substitution des produits les plus toxiques
La première étape consiste à repérer en particulier les agents chimiques cancérogènes ou dangereux dans le cadre de l'évaluation des risques du Document Unique de Sécurité (DUS).
Les Fiches de Données de Sécurité (FDS), obligatoires pour tout produit chimique dangereux, comportent les renseignements relatifs à la toxicité des produits, donc notamment leur caractère cancérogène éventuel.
La suppression ou la substitution des produits cancérogènes ou dangereux est la mesure de prévention prioritaire qui s'impose à l'employeur. Des fiches d'aide à la substitution sont disponibles sur le site de l'INRS, et, par exemple, il existe des tableaux avec des produits de remplacement pour certains adjuvants précurseurs des nitrosamines.
Le choix d'une forme physique des produits limitant la production de poussières lors des mélanges est également un moyen de prévention efficace, par exemple en prohibant l'emploi de poudres et en utilisant des granulés, et surtout des produits enrobés par des huiles ou des plastifiants.
- La ventilation générale et l'aspiration à la source des poussières et fumées de caoutchouc
Il est indispensable de limiter dans les ateliers la quantité de poussières, de vapeurs de caoutchouc et de ses fumées et gaz de décomposition thermique, sans aucune recirculation de l'air pollué, c'est à dire avec évacuation hors du milieu de travail.
Pour ce faire, un système de ventilation générale d'une part et locale d'autre part à l'aide de captation à la source des fumées de caoutchouc doivent impérativement être mises en œuvre, ainsi qu'un procédé en système clos lorsque c'est techniquement possible (ce qui n'est pas néanmoins une protection absolue du fait des fuites éventuelles et des ouvertures des appareils et des moules) : il convient d'assurer une concentration dans l'atmosphère de l'atelier la plus basse possible et pour éviter en tout cas l'exposition des travailleurs à une concentration supérieure à celle des limites de sécurité (valeurs limites et moyennes d'exposition VLE et VME).
• La ventilation générale repose sur une extraction et soufflage de l'air avec un système de collecte par des ventilateurs, avant son rejet à l'atmosphère après épuration dans des filtres : l'air est transporté dans le local par un ventilateur de soufflage et extrait du local par un ventilateur d'évacuation. L'extraction de l'air se fait grâce à un système de collecte par ces ventilateurs, des gaines de diffusion, et un réseau de conduits qui captent et concentrent les poussières et vapeurs jusqu'aux filtres et aux épurateurs qui permettent de nettoyer l'air, puis de l'évacuer à l'extérieur. Les composants aérauliques comme les ventilateurs, les conduits entre autres doivent être accessibles et faciles d'entretien et de nettoyage. En particulier, les réseaux s'encrassent rapidement avec de filtres hors d'usage, une évacuation des condensats obstruée...
• La ventilation locale repose sur des systèmes de captage des gaz et poussières au plus près de leur point d'émission, avant leur dispersion dans le local : hottes ou buses d'aspiration au dessus des malaxeurs, des balances de pesée et des bacs des poudres, des presses, des calandres, des moules, des autoclaves, des zones de stockage de pièces chaudes, des points d'accrochage où les pièces de caoutchouc continuent de libérer des fumées...
La ventilation générale des ateliers doit être déterminée en fonction des aspirations locales pour ne pas perturber l'efficacité des captages à la source.
• avec surveillance régulière de l'atmosphère, pour vérifier l'efficacité des mesures d'aspiration par dosages atmosphériques. Ces analyses métrologiques sont confiées à des spécialistes de la sécurité au travail (hygiéniste, ingénieur sécurité). Les rapports d'analyses, d'intervention et de maintenance seront intégrés à la documentation de sécurité au travail de l'entreprise (Document Unique de Sécurité).
- Un stockage des produits chimiques rigoureux
Le stockage des produits chimiques présente des risques tels que l'incendie, l'explosion, le risque de chute ou de renversement ou de détérioration d'emballage ... Toutes ces caractéristiques rendent nécessaire, outre les précautions lors de leur emploi, l'aménagement de locaux de stockage, avec des rayonnages métalliques, des planchers et des palettes normalisées. La réduction des risques existants passe par une réflexion sur la structure du local, sur les modalités de rangement et sur les incompatibilités entre les produits. Des procédures de stockage non adaptées peuvent entraîner une fragilisation des emballages à l'origine de fuites ou de ruptures accidentelles, de pollution, de réactions dangereuses ou d'accidents ou induire une modification ou une dégradation des produits qui le rendent plus dangereux car ils peuvent libérer des vapeurs inflammables ou nocives.
L'empilement doit être stable et sa hauteur ne doit pas affecter l'intégrité des emballages.
Le stockage des bidons et autres sacs ou récipients, doit se faire dans un local ventilé par un système de ventilation mécanique, à l'abri de la chaleur et de l'humidité, et tous les conteneurs de produits chimiques doivent toujours être bien refermés.
Les fûts d'huile doivent disposer des bacs de rétention régulièrement vidés par aspiration. Les bouteilles de butadiène doivent être stockées debout, dans un local frais, sec, bien ventilé, loin des sources de chaleur, des flammes nues et des étincelles, séparé des locaux où sont entreposés l'oxygène, le chlore et autres produits et gaz oxydants ou matières combustibles.
L'installation électrique du local de stockage est à réaliser avec du matériel utilisable en atmosphère explosible.
Une bonne tenue des sols des locaux de stockage est essentielle pour éviter l'accumulation des matières déversées.
L'interdiction de fumer dans les locaux doit être absolument respectée et signalée de manière apparente (de même que toutes les autres consignes de sécurité).
Il faut stocker les plus faibles quantités de produits possibles car le risque d'incident ou d'accident croît avec la durée et le volume de stockage.
- Une installation électrique conforme
L'incendie et/ou l'explosion peuvent provenir des équipements électriques, et en particulier, l'équipotentialité et la bonne mise à la terre de toutes les installations métalliques doivent être contrôlées, les prises défectueuses remplacées. Les étincelles, arcs et échauffements provoqués par les moteurs et appareillages électriques en fonctionnement peuvent aussi déclencher la catastrophe.
Il convient d'utiliser de l'appareillage électrique conçu pour atmosphères dangereuses afin de prévenir que le matériel, y compris l'éclairage, soit à l'origine d'un incendie ou d'une explosion.
La protection contre les contacts avec les masses mises accidentellement sous tension est obtenue par un dispositif de coupure automatique en cas de défaut d'isolement.
Il est fortement recommandé de placer des explosimètres dans les zones de réception / manutention / stockage / expédition.
Dans le domaine des atmosphères explosives (Atex), des normes européennes fixent le cadre de travail des industriels et des installateurs. Depuis juin 2003, tout nouveau site de type Atex doit être équipé avec du matériel certifié, avec des enveloppes antidéflagrantes. Les autres installations doivent, depuis juin 2006, avoir été mises à niveau.
- L'utilisation de machines et équipements adaptés
• Dispositifs de sécurité des machines :
Toute machine doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs afin de supprimer ou réduire au minimum les risques de coupure, d'entraînement, d'écrasement, de cisaillement causés par les éléments exerçant une action directe sur la matière.
Cette identification doit être réalisées par des pictogrammes et couleurs normalisées. Les éléments de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
Les panneaux de signalisation seront choisis et disposés de façon à être perçus et compris facilement sans ambiguïté.
Chaque machine doit être munie d'un ou plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence clairement identifiables, (câble ou barre frontale de protection...) accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter les situations dangereuses en train de se produire.
• Dispositifs anti-fuites des machines
Il convient de vérifier que les raccords des installations en circuit fermé, les joints pour empêcher les pompes de fuir sont en bon état et correctement posés.
• Dispositifs antibruit
Les machines et équipements doivent être conçues et fabriquées de façon à ce que les émissions sonores soient réduites au niveau le plus bas possible en application d'une directive européenne 2003/10/CE du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques liés au bruit.
Par le choix ou l'achat de machines et par l'utilisation de procédés silencieux, les émissions sonores peuvent être maintenues à un bas niveau.
Les machines bruyantes doivent être munies de capots insonorisants et pour réduire les bruits transmis par les sols et les structures, des blocs anti-vibrations peuvent être placés entre la machine et la surface d'appui.
- Le respect des règles d'hygiène
Une bonne tenue des sols des locaux par aspiration ou par un procédé à l'humide est essentielle pour éviter l'accumulation de déversements et de poussières sous ou autour des machines. Les déversements peuvent créer un danger de glissement et par conséquent doivent être nettoyés immédiatement.
Des mesures complémentaires d'hygiène des locaux doivent être mises en œuvre tel le nettoyage régulier des machines et des parois de l'atelier à l'aide d'un aspirateur industriel adapté avec un filtre absolu qui ne disperse ainsi pas les poussières dans l'air.
Des lavabos, postes de rinçage oculaire et des douches de sécurité doivent se trouver à proximité des postes de travail.
Celles-ci permettent les mesures d'hygiène générale : lavage des mains fréquent avec moyens adaptés, douche en fin de poste... En effet, le respect des règles d'hygiène s'étend aux comportements individuels : ne pas avoir les mains sales afin de ne pas ingérer par inadvertance un produit cancérogène ou toxique et ne pas manger sur le lieu de travail.
Le personnel doit avoir à sa disposition des vestiaires et des sanitaires correctement équipés et en nombre suffisant. Des vestiaires doubles doivent être mis à la disposition des travailleurs : l'entreposage des tenues de travail doit avoir lieu à l'abri de la poussière et des souillures (le rangement des tenues de ville et des tenues de travail doit être séparé).
- Des équipements de protection individuelle appropriés
Les équipements de protection individuelle sont nécessaires pour réduire le risque d'exposition non totalement éliminé par les mesures de protection collectives précédentes, ou lorsque les mesures de prévention technique ne suffisent pas dans le cas d'incidents : gants, vêtements de protection, masques respiratoires filtrants, lunettes de sécurité si il y a un risque de projection oculaire.
S'il y a possibilité de contact avec la main avec les substances chimiques utilisées lors des transvasements par exemple, il s'avère indispensable de porter des gants de protection adaptés à la tâche effectuée et au produit manipulé : il n'existe pas de gant de protection universel. Le type de gants conseillé, imperméables, à longues manchettes, pour éviter la pénétration des produits à l'intérieur, doit être adapté aux différents produits manipulés selon leur composition qui figure sur la Fiche de Sécurité (FDS). Pour éviter les blessures avec des pièces chaudes ou des parties mobiles des machines, le port des gants anti-brûlures ou anti-coupures sont recommandés.
Il est recommandé aussi de porter des vêtements à manches longues et des combinaisons aux propriétés ininflammables, surtout lors des interventions près des surfaces chaudes (moules chauffés), et des combinaisons jetables pour la manipulation de produits dangereux ou pour l'entretien.
Pour les opérations de pesées des poudres par exemple, des masques anti-poussières sont nécessaires et, en cas de nécessité (incidents techniques avec émanations...), des appareils de protection respiratoire adéquats doivent être fourni avec masque à cartouche doté d'un filtre adapté au produit.
- Une surveillance médicale renforcée
Généralement, il y a un long délai entre l'exposition et le diagnostic d'un cancer professionnel (en général au moins 10 ans et jusqu'à 50 ans) ce qui nécessite une traçabilité au travers de la rédaction d'une fiche d'exposition et d'une surveillance médicale régulière, à visée de dépistage, réalisées par le médecin du travail.
A sa sortie de l'entreprise, le travailleur exposé doit recevoir une attestation d'exposition qui lui permettra de continuer à se faire suivre médicalement. La reconnaissance d'un cancer professionnel est importante, car elle ouvre droit à une réparation intégrale du préjudice subi pendant l'arrêt de travail (indemnisation et gratuité des soins) et au-delà s'il y a des séquelles (capital ou rente d'incapacité).
Les modalités générales de la surveillance des travailleurs exposés à des agents chimiques cancérogènes, donc ceux des industries du caoutchouc, sont précisées dans le Code du travail (décret n°2001-97 du 1er février 2001, décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 et n° 2004-725 du 22 juillet 2004) et (Article R. 4412-40 du Code du Travail) : fiche d'exposition aux produits CMR (Cancérogènes, Mutagènes et Reprotoxiques) et liste des salariés exposés aux produits chimiques dangereux.
• Suivi médical et toxicologique régulier, au moins annuel. En cas d'anomalie, tout le personnel concerné doit bénéficier d'un examen médical.
• Fiche d'aptitude avec mention de l'absence de contre-indications médicales à l'exposition au risque après étude du poste de travail.
• Le dossier médical doit stipuler la nature du travail effectué, la durée des périodes d'exposition et les résultats des examens médicaux. Ces informations sont indiquées dans l'attestation d'exposition et le dossier médical doit être conservé 40 ans après la cessation de l'exposition.
• Suivi post professionnel (article D. 461-25 du code de la Sécurité sociale) : quand le salarié n'est plus exposé ou part à la retraite, ce suivi permet d'assurer pour les cancers professionnels qui se déclareraient après, une réparation du dommage subi.
- La formation et l'information du personnel
La formation, par un organisme agréé, sur les dangers des produits utilisés et sur les moyens de se protéger, est indispensable : par exemple, comprendre les étiquettes du contenant des produits, connaître l'attitude à adopter en cas de fuite ou de déversement accidentel, savoir utiliser les E.P.I adéquats, formation aux premiers secours et incendie...
Septembre 2011
Partagez et diffusez ce dossier
Laissez un commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.