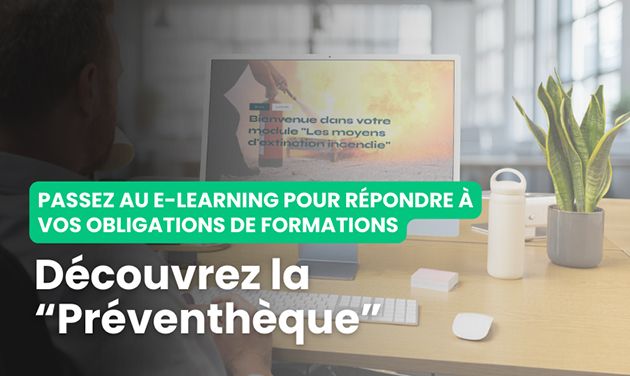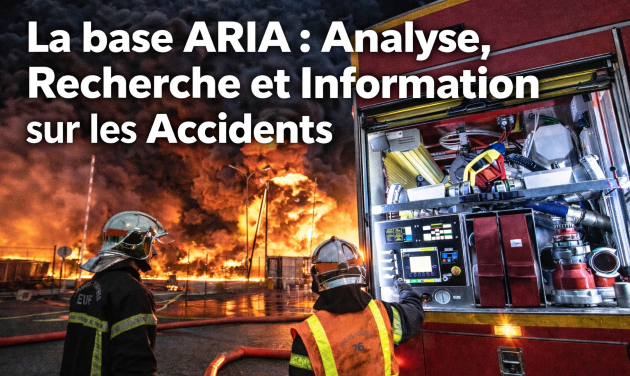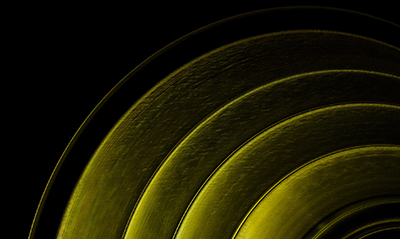Le nautisme est un secteur en pleine expansion : la préparation, la réparation, l’accastillage de bateaux de plaisance emploient de très nombreux techniciens de maintenance en marine travaillant en atelier ou sur les chantiers à flot ou à sec...
Les dangers de chute, de manipulation de produits, d’inhalation de poussières, de blessures, de fortes contraintes posturales, de travaux en hauteur, occasionnent de fréquents accidents du travail.
Le nautisme est un secteur en pleine expansion : la préparation, la réparation, l’accastillage de bateaux de plaisance emploient de très nombreux techniciens de maintenance en marine travaillant en atelier ou sur les chantiers à flot ou à sec. Les dangers de chute sur des sols ou ponts mouillés, de manipulation de produits (vernis, colles, hydrocarbures...), d’inhalation de poussières (ponçage), de blessures avec les outils ou moyens de levage, de fortes contraintes posturales, de travaux en hauteur, occasionnent de fréquents accidents du travail. Les conditions environnementales (vent, pluie, soleil ...), la proximité d’autres intervenants sur les quais, les pontons ou les zones de carénage, le travail isolé et dans un espace restreint, majorent les risques des agents de maintenance nautique.
Ces conditions de travail soulèvent généralement des problèmes de sécurité, et par conséquent doivent faire l’objet d’une attention particulière pour en maîtriser les risques.
Les situations professionnelles à risques dans la maintenance nautique
L’entretien de tout le matériel nautique de plaisance est très exigeant du fait de l’environnement humide et glissant, des aléas météorologiques, des dures conditions de travail dans des embarcations exigües et mouvantes, du travail en hauteur sur les coques à sec, des dangers de la sortie ou mise à l’eau des bateaux et aussi à cause de la préoccupation constante de sécurité à bord (électrocution, incendie, chutes par-dessus bord ...).
Les domaines de la maintenance des embarcations de plaisance (inférieures à 24 mètres, au-delà il s’agit de réparation navale) pour la navigation en mer et sur les grands lacs, regroupent un ensemble d’activités très diverses : réparations des bateaux en bois ou en plastique, des moteurs et équipements du navire (voiles, éléments de confort à bord, électronique embarquée, armement de sécurité ...), accastillage (accessoires des superstructures du navire servant aux manœuvres, de gréement et de fixation de liaison entre la coque et le pont), levage, calage, stockage et mise à l’eau des bateaux.
Les agents de maintenance nautique interviennent aussi sur des embarcations de différents types avec des équipements variés : bateaux de plaisance, à moteur hors-bord et in-bord, embarcations pneumatiques, voiliers, véhicules nautiques à moteur (motos marines,...), petits bateaux de pêche de loisir, petits matériels de sport nautique (dériveurs, planches à voile, ...) ...
Ces activités s’exercent soit dans un atelier couvert, soit dans un port à flot et port à sec, c'est-à-dire à l’extérieur, éventuellement en pleine mer lors d’essais ou de réglages.
- Les techniciens de maintenance nautique sont grandement tributaires des aléas climatiques, exposés aux ultraviolets (UV), aux intempéries, au froid ou à la chaleur, et à l’humidité. Ces conditions climatiques variables (chaleur, pluie, vent) accentuent les risques liés aux postures de travail contraignantes et ne permettent pas de travailler en toute sécurité.
- Le travail à flot s’exerce sur un support mouvant du fait des vagues, du tangage et du roulis, ce qui rend beaucoup plus dangereux l’utilisation d’outils et de machines, comme la scie à ruban, les disqueuses électriques portables et autres outillages électroportatifs. A cela s’ajoute, l’éblouissement lorsque le soleil se reflète sur l’eau.
- La manutention manuelle des matériels lourds et encombrants (moteurs, caisses à outils, grandes voiles ...) est très fréquente.
- Certaines opérations sont intrinsèquement sources de graves dangers : sortie ou mise à l’eau du bateau, opération de calage, matage et démâtage, peuvent provoquer le basculement intempestif et dangereux des mats et des coques.
- L’utilisation de produits chimiques (solvants, peintures, vernis, colles, résines ...) est potentiellement à l’origine de brulures ou d’irritations cutanées, d’intoxication par inhalation, de réactions allergiques, lors des travaux de décapage, peinture et de ponçage des coques, de la découpe des cordages, ...
- Le traitement des coques à sec exige un travail en hauteur.
- Le déplacement sur des surfaces inégales, encombrées, mouillées et glissantes des ponts des bateaux, des pontons, des quais, ou des zones de carénage, occasionnent des risques de trébuchement et de glissades provoquant des chutes de plain-pied. Ces risques sont aggravés par l’éventuelle chute par-dessus bord dans la mer ou dans les eaux des ports ou des lacs, avec danger de noyade ou d’hypothermie.
- Les conditions de travail amènent souvent à adopter des postures contraignantes : le travail de maintenance s’exerce sur des éléments d’équipements ou de moteurs difficilement accessibles au démontage et au remontage, et/ou lourds à manipuler, dans les espaces clos à l’intérieur des bateaux, mal éclairés, exigus voire insalubres dans les cales.
- Les risques électriques sont accrus avec l’utilisation de connexions électriques de mauvaise qualité, d’où possibilité de contacts avec des conducteurs électriques sous tension aggravée par le milieu humide, mauvaise mise à la terre, prises de courant ou outillages, prolongateurs, ... défectueux.
- La présence de produits inflammables en milieu confiné des cabines (gaz, fuel, solvants ...) génère un risque d’incendie important.
- L’agent de maintenance nautique effectue le plus souvent seul les taches en étant hors de portée de vue ou de voix pendant un certain temps à l’intérieur du bateau, et ainsi, il ne dispose pas de possibilité de recours en cas d’aléas, d’accident ou de malaise.
- Sur les quais, la stabilité des masses stockées (conteneurs, palettes...), le balan des charges soulevées, la tension des câbles et cordages ... sont des risques causés par les autres intervenants portuaires.
- Tous ces risques sont aggravés pour le personnel saisonnier, souvent embauché par les entreprises de location par exemple : les travailleurs saisonniers sont plus exposés aux risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles du fait de la précarité de cette main d’œuvre, leur manque d’information, de formation et de connaissances des lieux et des procédés qui augmentent ainsi leur vulnérabilité.
Les principaux risques professionnels des agents de maintenance nautique
- Les risques traumatiques
Le travail dans la maintenance nautique expose à de nombreuses sources de traumatismes.
- Les chutes de plain-pied par glissades du fait de sols mouvants, souvent humides des ponts des bateaux ou rendus glissant à la suite de salissures de déchets sur les quais, ou par trébuchement sur des sols inégaux des pontons ou encombrés de cordages, caisses ... entrainent de nombreuses lésions physiques cutanées et/ou ostéoarticulaires : foulure, entorse, contusions, plaies cutanées et hémorragies, fractures. Ces risques sont aggravés par l’éventuelle chute par-dessus bord ou chute du quai dans les eaux du port, et risque de noyade, d’immobilisation dans des filets et d’hypothermie.
- Des chutes de hauteur, suite à l’absence de garde-corps ou à des rambardes détériorées ou à un accès inadapté sur un bateau (échelle, passerelle...) sont à l’origine de graves accidents, tout comme le travail sur les mats.
Dans les travaux de maintenance nautique, les chutes de hauteur représentent une part importante des accidents graves. Ils sont provoqués à terre par des échafaudages inadaptés, mal stabilisés, mal ancrés, la mauvaise utilisation d’échelles mal entretenues, mal placées et/ou mal fixées, entrainant leur glissement ou renversement.
- Les dangers liés aux manutentions manuelles dépendent de la nature des charges, au nombre excessif de manipulation et au mouvement de torsion, déplacement, soulèvement. Les lombalgies d'effort sont fréquentes lors de la manutention du matériel de calage et d'arrimage ou le transport de moteurs, d’outils ou de colis ou de bagages. Non seulement les risques d'accidents de travail concernent le dos (lombosciatiques) mais aussi les membres inférieurs (entorses ...) ou les extrémités (coincement des doigts ...) et le vieillissement progressif des structures ostéoarticulaires peut aboutir à une inaptitude professionnelle.
De plus, les surfaces anguleuses ou rugueuses, les chutes d'objets figurent parmi les causes de blessures, de lacérations, de contusions ou de traumatismes crâniens pendant les opérations de manutention manuelle, notamment dans l’espace restreint des cabines agitées par les vagues.
- Le travailleur peut également subir des blessures s'il entre en collision avec des objets : les risques d'accident provoqué par des manutentionnaires effectuant des manœuvres sur le port, avec heurt avec une charge (grue, chariots...) sont importants.
- Coincement ou lacération des mains, des bras ou cisaillement des doigts sont susceptibles d’être provoqués lors de la mise en tension des câbles et cordages, ou par suite du positionnement des différents composants des accessoires de levage lors du grutage des bateaux.
- Coupures avec les hélices, les outils tranchants (cutters ...).
- Piqûres par une épissure de câble, cordage ou de filin d’acier détériorée.
- Les fausses manœuvres de calage peuvent être à l’origine du renversement du bateau pouvant occasionner des traumatismes gravissimes, voire mortels.
- L’utilisation d'outillage manuel ou électroportatif (perceuses, visseuses-dévisseuses, scies sauteuses ...) sans dégagement, dans un espace restreint et mouvant, est la source de possibilités de multiples plaies lors de réparations des équipements nautiques.
- Risque de brulures lié à l’exposition aux parties chaudes d’un moteur, d’un pot d’échappement.
- Risques traumatiques des jets de lavage sous haute pression. - Les risques du travail à l’extérieur
L’exposition fréquente aux UV, surtout torse nu, peut être responsable de cancers de la peau, d’ophtalmies (brûlure de la cornée) particulièrement en bord de mer, et, en tout cas, d’érythème solaire (coup de soleil).
Les problèmes de santé dus à la chaleur et à l'action prolongée du rayonnement solaire sur la tête (effets de l’insolation, de la déshydratation...) génèrent des risques de malaise général, de crampes musculaires, de pertes de connaissance, qui peuvent être vitaux dans les cas extrêmes (coup de chaleur). Indirectement, le travail par fortes chaleurs augmente aussi les risques d'accidents du travail par la fatigue, la sudation, la diminution de la vigilance.
Les agents de maintenance nautique peuvent subir aussi une exposition au froid excessif en morte saison, qui peut s’avérer parfois importante. Le risque lié au froid est accru par une exposition au vent (refroidissement éolien) et à l’humidité maritime.
Non seulement travailler dans un environnement froid peut être dangereux directement pour la santé, mais aussi indirectement du fait des risques liés à la baisse de dextérité manuelle et de vigilance mentale qui augmentent les taux d'accidents du travail.
L’exposition au froid est aussi susceptible de déclencher le syndrome de Raynaud (doigts blancs et douloureux par vasoconstriction).
Les ambiances froides associées à des courants d’air et à l’humidité de l’air favorisent aussi l’apparition d’affections aiguës des voies respiratoires supérieures.
Le froid modifie les caractéristiques des vêtements. Une situation de travail qui impose des passages du froid au chaud, peut ainsi entraîner des condensations successives sur et dans le vêtement (transpiration) qui réduisent la protection thermique.
L'hypothermie causée par une chute dans une eau froide représente la pathologie due au froid la plus grave; elle résulte d'une perte excessive de chaleur corporelle et de l'abaissement consécutif de la température centrale du corps. - Les risques chimiques
Le travail dans la maintenance nautique nécessite l’utilisation de nombreux produits chimiques.
- Toutes les opérations d'entretien et de nettoyage font appel, pour débarrasser des surfaces inertes de toutes souillures visibles et inactiver ou tuer les micro-organismes présents, à des agents détergents, désinfectants, décapants, détartrants qui utilisent souvent des produits chimiques très agressifs susceptibles de provoquer des intoxications par inhalation ou absorption et des brûlures cutanées ou oculaires, ou des sensibilisations allergiques.
- Les travaux de traitement des coques exposent notamment aux résines polyesters insaturées, époxydes, polyuréthanes et diluants des résines (styrène, méthacrylate de méthyle), aux solvants organiques, des peintures, vernis, colles ... Les pathologies irritatives et/ou allergiques atteignent le plus souvent la peau (dermites, eczéma), suivies des atteintes des muqueuses oculaires (conjonctivite), nasales (rhinite) et bronchiques (asthme...). Les Composés Organiques Volatils (COV) contenus dans ces produits provoquent aussi des troubles neurologiques (céphalées, vertiges, agitation ou somnolence, ...).
- Le ponçage expose aux poussières de bois, de résines, de résidus de peinture : ces opérations génèrent une quantité importante de fines particules irritantes qui se logent dans le nez, et certaines particules très fines réussissent à traverser la cavité nasale et à s'attaquer à la trachée et aux poumons, ou elles engendrent une inflammation des muqueuses des bronches : l’inhalation de poussières provoquent des rhinites et peuvent être à l’origine de réactions asthmatiques.
Par ailleurs, l’exposition aux poussières de bois génère un risque de cancer naso-sinusien, qui, même si c’est rare et d’apparition tardive, a été longtemps sous-estimé.
- L’exposition au plomb entraine des risques lors de découpage de tôles ou autres pièces métalliques recouvertes de minium antirouille (tétraoxyde de plomb), de grattages ou meulages de pièces recouvertes de peintures au plomb anciennes.
Les effets néfastes du plomb résident dans sa toxicité sanguine, neurologique et rénale (anémies, neurasthénies, insuffisances d’élimination urinaire...) - Les fumées de soudure sont irritantes et toxiques et sont responsables de diverses pathologies importantes. Les fumées de soudage sont répertoriées cancérogènes.
- Le contact cutané avec les huiles minérales usagées, lors des vidanges moteur, et avec les solvants de dégraissage est irritant pour la peau des mains : dermatoses, eczémas, se traduisant par des rougeurs (sur le dos des mains et entre les doigts), des démangeaisons (prurit), des fissures, desquamations et des crevasses et le contact répété peut donner une acné professionnelle (les « boutons d'huile »).
- Les vapeurs des carburants et les gaz d'échappement contiennent des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), dont du benzène cancérogène, qui agissent sur le système nerveux et provoquent des troubles graves de la formule sanguine pour les effets provoqués par de très fortes concentrations que l’on peut éventuellement rencontrer suite à des émanations ou fuites dans les milieux confinés des cales.
- Les décapants pour peinture (par exemple dichlorométhane) et produits pour solidifier les plastiques endommagés peuvent être cancérogènes, toxiques pour le système nerveux et irritants cutanés et respiratoires.
- La découpe à chaud des cordages provoque l’émission de vapeurs émises de dégradation thermique avec présence de produits très toxiques voire cancérogènes (formaldéhyde, benzène). - Les risques d’électrocution et d’incendie
L’électrisation/électrocution par contact avec un conducteur sous tension ou par utilisation d’outillage mal entretenu ou de prises défectueuses, sont des dangers potentiels surtout dans un environnement humide, au même titre que les risques importants d’explosion et d’incendie, en raison de l'utilisation de tous les produits inflammables (solvants, carburants) et de sources de chaleur nombreuses (soudage, meulage, températures élevées des moteurs et pots d'échappement, fort ensoleillement) dans des enceintes confinées et mal ventilées des bateaux de plaisance.
Les mesures de prévention des risques de la maintenance nautique
Une organisation rationnelle des tâches, de bonnes méthodes de travail avec des outils adaptés et bien entretenus, une bonne formation et le respect des règles d’hygiène sont nécessaires, mais insuffisantes compte tenu du caractère peu maitrisable d’un travail très diversifié (allant de la peinture à la mécanique) et l'adoption de vêtements et accessoires de protection (casquettes, chaussures ou bottes de sécurité antidérapantes, gants, pantalons anti-coupures, et selon les situations, équipement individuel de flottaison, casque et masque de protection, une protection thermique appropriée, etc.) s'avère indispensable.
Les travaux de maintenance nautique doivent faire l’objet d’une analyse poussée des risques pour permettre la rédaction du Document Unique de Sécurité en appréciant à la fois l’environnement matériel et technique (outils, machines, produits utilisés) et l’efficacité des moyens de protection existants et de leur utilisation selon les postes de travail.
Les salariés doivent être aussi informés à propos des produits dangereux mis en œuvre et formés aux pratiques professionnelles sécuritaires. Les Fiches de Données de Sécurité (FDS), obligatoires pour tout produit chimique dangereux, comportent les renseignements relatifs à la toxicité des produits.
Les agents de maintenance nautique isolés doivent être dotés de moyens de communication et d’alerte, au minimum d’un téléphone portable, d’un talkie-walkie ou mieux d’un DATI (Dispositif d’Alarme pour Travailleurs Isolés) qui comporte un émetteur et un récepteur, et permet la détection de l’état physique de l’employé et sa localisation.
- La suppression / substitution des procédés les plus dangereux
Une prévention efficace est la prévention primaire qui résulte d’un choix de produits permettant la suppression ou l’emploi de produits de substitution de moindre impact potentiel sur l'homme et l’environnement.
La suppression des COV ou leur substitution par des COV beaucoup moins toxiques apparaissent comme des solutions prioritaires.
Par exemple,
- le dichlorométhane ou chlorure de méthylène, solvant utilisé comme décapant à peinture et vernis, peut être remplacé par des procédés à chaud sans solvant ou d'autres procédés chimiques à cause de ses effets nocifs. Néanmoins, il faut tenir compte du fait que les produits alternatifs au dichlorométhane ont une action plus lente et ne sont pas non plus dénués d’effets toxiques et / ou corrosifs.
- Des dégraissants sans N-hexane (neurotoxique) existent.
- Privilégier les peintures aqueuses à la place des peintures à solvants organiques, si techniquement possible.
- Choisir des produits prêts à l’emploi pour éviter les transvasements et mélanges.
- ... - Prévention des risques des chutes
- Pour le travail à l’extérieur
L'installation de dispositifs de protection bien sécurisés par des barrières, rambardes, passerelles, garde-corps ...et des échelles de sortie est impérative.
L’accès au bateau, que cela soit au moyen d’une échelle à terre ou d’une passerelle à quai, doit être sécurisé : les échelles portables peuvent être utilisées comme poste de travail uniquement s’il s’agit de travaux de très courte durée ne présentant pas de caractère répétitif ou risqué. Dans tous les cas, des mesures particulières de sécurité doivent être prises : l’échelle doit reposer sur des supports stables et résistants, leurs échelons ou marches doivent être horizontaux.
Les échafaudages sur roues doivent être privilégiés lors de la phase de traitement de la coque à sec : les échafaudages roulants sont vite mis en place, polyvalents et avantageux en cout.
Les échafaudages sur tréteaux doivent surtout être utilisés pour des travaux à des petites hauteurs.
Il convient de s’assurer que la passerelle est pourvue de garde-corps ou de filières et supporte la charge à transporter.
La prise en en compte des conditions météorologiques implique de ne pas effectuer de sortie en mer en cas de forte houle, vents violents ... qui rendraient périlleux les travaux de maintenance.
La vérification de la bonne mise en place du harnais et des drisses est impérative avant de monter au mat.
- Pour le travail à l’intérieur
Les glissades, les pertes d'équilibre sont souvent provoquées par un sol défectueux ou un trébuchement contre un obstacle non repéré.
On doit veiller à maintenir l'ordre dans le local de travail et surtout dans les zones de stockage. Les voies de circulation doivent être débarrassées de tout obstacle. Il faut éviter les zones d'ombre en optimisant l'éclairage et signaler les escaliers, les dénivelés, les encombrements temporaires...
Des revêtements de sol antidérapants doivent être privilégiés, les inégalités de surfaces et/ou obstacles doivent être soit supprimés soit clairement signalés, notamment dans les lieux de passage, les sols doivent être nettoyés et essuyés régulièrement et tout produit accidentellement répandu, lors d’une fuite ou déversement, doit être immédiatement épongé.
Les travailleurs doivent être équipés de chaussures de sécurité avec semelles antidérapantes (conformes à la norme générale EN 345 S2).
L'environnement de travail doit offrir un éclairage suffisant, dont il faut entretenir régulièrement les dispositifs (remplacement des tubes fluorescents et ampoules ...). - Prévention des risques chimiques
- Dans l’atelier, la prévention collective indispensable concerne la ventilation et l’aération du local, ensuite un captage efficace des vapeurs et poussières et un stockage correct des produits dangereux, et une limitation de la quantité de produits présents sur chaque poste de travail.
La bonne aération et ventilation générale permettent un renouvellement de l’air qui diminue la densité des polluants dans les locaux, en particulier celle des produits volatils, des solvants des peintures, vernis, colles, décapants qui sont utilisés souvent. Les entrées d'air doivent être compensées par des sorties forcées. L’utilisation de ces systèmes d’extraction d’air permet d’éviter les affections respiratoires. L'entretien régulier du système de ventilation (nettoyage des conduits d'extraction, changement des filtres) est une condition indispensable de bon fonctionnement.
La refermeture systématique de tous les bidons et autres conteneurs de produits est aussi un moyen simple de limiter la présence de composés volatils dans l’air ambiant.
- A l’intérieur d’un bateau, il convient de bien aérer la cabine et la cale (ouverture des capots ...) avant de séjourner dans l’habitacle du bateau, puis de disposer de systèmes de ventilation portables pour évacuer l’air vicié à l’extérieur avec une prise d’air neuf de compensation
- La prévention individuelle concerne le port de protections individuelles (gants, masques, vêtements de travail ...) adaptées aux produits utilisés. La mise en place d’une protection individuelle est nécessaire, puisque la manipulation, l’inhalation et le contact avec les produits restent incontournables, même si les préconisations de ventilation sont respectées.
C’est ainsi que le port d’équipements de protection individuels (EPI) s’impose pour réduire le plus possible l'exposition aux agents chimiques nocifs, notamment lors des transvasements ou de dilution : il s’avère indispensable de porter des gants de protection adaptés à la tâche effectuée et au produit manipulé. Il n'existe pas de gant de protection universel. Le type de gants conseillé, en néoprène, imperméables, à longues manchettes, pour éviter la pénétration des produits à l’intérieur, doit être adapté aux différents produits utilisés selon leur composition qui figure sur la Fiche de Sécurité (FDS). Le port de lunettes de protection évite les lésions par projections de produits (mais aussi de matières). Le port d’un masque prenant le nez et la bouche en papier ou cartonnés, légers, jetables, filtrant les particules, de type FFP3, de durée d’efficacité limitée à quelques heures, est indispensable pour les travaux de ponçage. Le port d’un masque à cartouche n’est pas adapté pour le ponçage, car les poussières l’obstruent, mais doit par contre être utilisé lors des expositions aux vapeurs toxiques, avec un filtre ad hoc.
- Le stockage des produits chimiques présente des risques tels que l’incendie, l’explosion, le risque de chute ou de renversement ou de détérioration d'emballage ... Toutes ces caractéristiques rendent nécessaire, outre les précautions lors de leur emploi, l’aménagement de locaux de stockage, des armoires avec étagères de rétention pour les petites quantités, matériels de stockage avec bacs ou cuves de rétention pour prévenir et maîtriser les fuites accidentelles de liquides polluants, dont le gazole.
L’empilement doit être stable et sa hauteur ne doit pas affecter l’intégrité des emballages.
Le stockage des bidons et autres sacs ou récipients, doit se faire dans un local ventilé par un système de ventilation mécanique, à l'abri de la chaleur et de l'humidité, et tous les conteneurs de produits chimiques doivent toujours être bien refermés.
Une bonne tenue des sols des locaux de stockage est essentielle pour éviter l’accumulation des matières déversées.
L’interdiction de fumer dans les locaux doit être absolument respectée et signalée de manière apparente (de même que toutes les autres consignes de sécurité).
Il faut stocker les plus faibles quantités de produits possibles car le risque d'incident ou d'accident croît avec la durée et le volume de stockage. - Prévention des risques thermiques
- Pour le travail au soleil, particulièrement sur les plans d’eau, les travailleurs doivent se couvrir la tête, et porter des sous-vêtements permettant l'évaporation de la sueur (le coton est à privilégier, le nylon est à éviter), sans toutefois négliger le port des équipements de protection individuelle, sont des mesures évidentes. Les travailleurs doivent porter une protection de la peau pour les parties du corps qui ne peuvent pas être couvertes, essentiellement le visage, les oreilles, le cou et la nuque, en appliquant largement une crème solaire sur la peau laissée à nu, et des lunettes de protection avec filtres pour l’ultraviolet pour assurer la protection oculaire.
- Pour le travail au froid, le port de protections individuelles contre le froid (pullover marin, grosses chaussettes, bonnet, vêtements imperméables ...) est indispensable.
- Les agents de maintenance nautique embarqués pour des essais ou interventions en mer doivent disposer de bottes antidérapantes, de casques ou casquettes de protection, de cirés de marine (vareuses..), de gants imperméables et l'amélioration de la sécurité des personnes au travail en milieu maritime contre les risques de noyade, passe par la protection personnelle permanente des vêtements de travail à flottabilité intégrée (VFI), assurée par de la mousse répartie dans l’ensemble du vêtement ou une vessie gonflable pliée dans l’enveloppe reliée à un dispositif de gonflage. - Prévention des risques physiques
Les nombreuses manutentions manuelles de charges lourdes qui entraînent des risques évidents de troubles musculo-squelettiques au niveau du dos et des articulations, peuvent être réduits par l’utilisation systématique de manutention assistée et de moyens de mise à niveau et de préhension des charges : supports de fûts à roulettes, diables, râtelier pour pièces détachées, ventouses à poignées, portiques, potences pivotantes, palans, tables élévatrices et tréteaux réglables pour travailler à la bonne hauteur ...
L’utilisation des accessoires de levage comportent aussi par eux-mêmes des risques : il convient de respecter les charges maximales qu’ils peuvent supporter.
Les conditionnements permettant de limiter les charges sont aussi un bon moyen de réduire les risques dorsolombaires.
Une précaution pour éviter les coupures consiste à utiliser des cutters avec protection automatique du tranchant en fin de coupe : le mécanisme de sécurité avec dispositif de retrait automatique de la lame, qui se déclenche dès qu’on lâche le pouce, protège les mains et le corps d’un faux mouvement. - Prévention des risques électriques
Dans l’atelier, l’installation électrique doit être conforme aux normes de sécurité électrique (norme NF C 15-100), ce qui est d’autant plus important si le travail s’effectue dans une atmosphère ou avec des mains humides. L’installation électrique (armoires électriques, fils et câbles, éclairage) doit être conforme aux normes de sécurité électrique, en particulier, la bonne mise à la terre doit être contrôlée, les prises de courant défectueuses remplacées, les prolongateurs et outils portatifs vérifiés... Un disjoncteur différentiel 30mA doit protéger le circuit électrique et l’appareillage électrique doit disposer d’enveloppes antidéflagrantes dans le cas d’utilisation intensive de solvants et d’hydrocarbures (site de type Atex). Une liaison de terre équipotentielle doit relier toutes les parties métalliques présentes dans l’atelier. - Le respect des règles d’hygiène
- Les vestiaires
Dans le domaine de l’hygiène, les vestiaires et les sanitaires doivent faciliter les pratiques d’hygiène corporelle, être d’un entretien facile, être aménagés de façon à isoler explicitement des zones spécifiques et être adaptés au nombre de salariés.
Des vestiaires doubles appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs car ceux-ci doivent porter des vêtements de travail spéciaux : l’entreposage des tenues de travail doit avoir lieu à l’abri de la poussière et des souillures et le rangement des tenues de ville et des tenues de travail doit être séparé ; il est primordial d'avoir un lieu de rangement pour le linge propre, et un autre pour le linge sale et d’avoir des équipements permettant le séchage des tenues de travail (sèche-bottes, sèche-gants...).
Des lavabos, postes de rinçage oculaire et des douches de sécurité doivent se trouver à proximité des postes de travail.
Celles-ci permettent les mesures d'hygiène générale : lavage des mains fréquent avec moyens adaptés, douche en fin de poste...
En effet, le respect des règles d’hygiène s’étend aux comportements individuels : ne pas avoir les mains sales afin de ne pas ingérer par inadvertance un produit toxique et ne pas manger sur le lieu de travail.
- L’hygiène des mains
Le port de gants ne remplace pas le lavage des mains.
Le lavage des mains avec un savon neutre est indispensable après tout contact avec des souillures, avant chaque pause, etc....
Il est également conseillé à l’utilisateur de se laver les mains à l’eau claire et tiède après chaque utilisation des gants, d’utiliser les gants avec des mains sèches et propres, d’éviter le port de bijoux. Dans le cas de contact temporaire et non prolongé avec l’eau, l’usage d’une crème protectrice hydrorésistante peut être envisagé.
Le lave-mains à commande non manuelle est nécessaire (au genou, au coude, électronique).
Il existe par ailleurs également des distributeurs de savon ou solution désinfectante à commande non manuelle, faciles à installer, simples à utiliser.
- L’entretien des locaux
Une bonne tenue des sols des locaux par un procédé à l’humide (jet d’eau ou système eau/vapeur), est essentielle pour éviter l’accumulation de déversements, de déchets et de poussières sous ou autour des postes de travail. Les déversements peuvent créer un danger de glissement et par conséquent doivent être nettoyés immédiatement.
- Les premiers secours
Les consignes en cas d'accident (n° d'appel d'urgence, conduite à tenir, identification des services de secours) doivent être visiblement affichées.
Une trousse complète contenant un matériel de premiers secours non périmé (solutions antiseptiques, pansements imperméables,...), aisément et rapidement accessible, doit être mise à la disposition du personnel ; toute blessure cutanée doit immédiatement être désinfectée et pansée.
En cas de projection dans l’œil, il convient de rincer immédiatement abondamment à l’eau claire ou avec une solution pour lavage ophtalmique.
Des extincteurs doivent être disponibles en nombre suffisant et vérifiés annuellement.
- La vaccination préventive contre Diphtérie Tétanos Polio doit être à jour, et éventuellement celle contre la Typhoïde, les Hépatites A et B, et la Leptospirose. - Les mesures de formation aux risques
La multiplicité, la fréquence et la gravité des accidents du travail dans les métiers de la maintenance nautique nécessitent d’entreprendre des actions de sensibilisation et de formation des travailleurs à la sécurité.
En particulier, pour le personnel saisonnier et intérimaire, des séances minimales d’information sur les risques et les moyens de les prévenir (notamment pour les dorsalgies, tendinites, coupures, projections oculaires, produits dangereux...) doivent être organisées, à la fois dans le cadre de leur intégration, puis lors d’un suivi particulier et d’un encadrement adapté à leur profil.
- Formation du personnel sur les dangers des produits utilisés et sur les moyens de se protéger (par exemple savoir lire attentivement l'étiquette du contenant des produits et connaître les symboles présents sur les récipients, utiliser les E.P.I adéquats),
- Formation sur les premiers secours pour pallier les conséquences d'un éventuel accident de travail
- Formation PRAP (Prévention des Risques liés à l'Activité Physique) pour prévenir les risques liés aux manutentions manuelles.
Il s’agit d’apprendre les bonnes postures de travail, les positions articulaires adéquates, en appliquant les principes de base de sécurité physique et d’économie d’effort.
- Formation à la mise en œuvre et à l'utilisation des équipements de protection individuelle.
- Formation technique de survie en mer, aux règles de sécurité maritime, permis bateau.
Août 2014
Partagez et diffusez ce dossier
Laissez un commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.