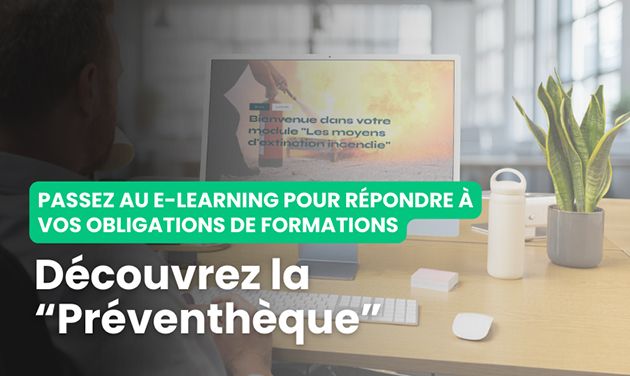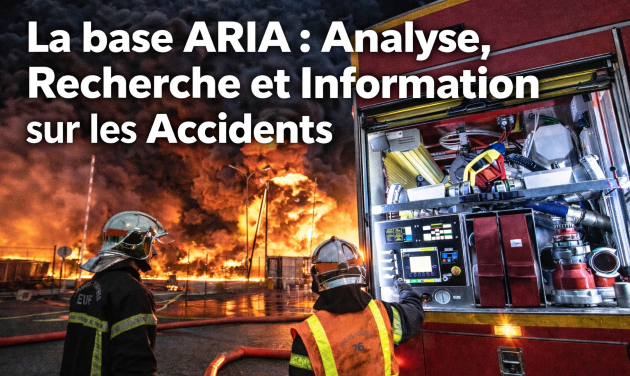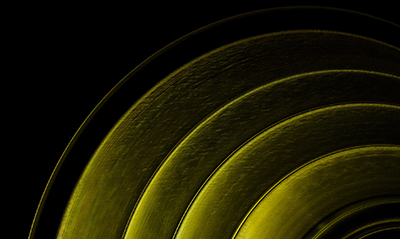Les risques professionnels des activités mytilicoles et ostréicoles sont importants et les accidents du travail dans le secteur de la conchyliculture sont nombreux, soit lors de la navigation en mer ou des déchargements sur les quais, soit lors de la manutention et la préparation des coquillages à l'entrepôt (détroquage, conditionnement…) ou lors de la maintenance du matériel. Les conditions de travail dans un milieu naturel humide, salin et peu maitrisable...
Les risques professionnels des activités mytilicoles et ostréicoles sont importants et les accidents du travail dans le secteur de la conchyliculture sont nombreux, soit lors de la navigation en mer ou des déchargements sur les quais, soit lors de la manutention et la préparation des coquillages à l'entrepôt (détroquage, conditionnement…) ou lors de la maintenance du matériel. Les conditions de travail dans un milieu naturel humide, salin et peu maitrisable, en mer ou dans les parcs ostréicoles, exposé à tous les événements météorologiques, favorisent l'apparition ou aggravent toutes les pathologies professionnelles du mytiliculteur ou de l'ostréiculteur.
Les blessures provoquées touchent à la fois les membres inférieurs (chutes de plain-pied…) et supérieurs (coupures aux mains…). La pénibilité physique du métier de conchyliculteur est aussi source de nombreux troubles musculo-squelettiques (notamment les dorsalgies), soit dus aux ports et déplacements de lourdes charges (retournement des poches…), ou à des gestes répétitifs (remplissage et étiquetage des bourriches…). Le risque de noyade par chute à la mer est omniprésent sur toutes les embarcations.
Les contraintes d'horaires liés aux marées augmentent également les dangers dans la conchyliculture.
Par ailleurs, il faut prendre en compte les risques chimiques liés à l'utilisation de chaux et de produits détergents et désinfectants (irritations cutanées, allergies), à la possibilité de contacts avec des conducteurs électriques sous tension et aux dangers des défauts des installations électriques : les ateliers de conchyliculture sont des locaux à fort risque électrique du fait de l'ambiance humide.
L'évaluation des risques professionnels, l'aménagement de l'environnement du travail, installations et équipements ergonomiques des embarcations et ateliers des conchyliculteurs, des entrepôts et des chambres froides, les mesures de prévention collective (sécurité des machines, état des sols…), le port d'équipements de protection individuelle appropriés, le respect des mesures d'hygiène (tenue agro-alimentaire, …), permettent de diminuer les diverses nuisances et de réduire fortement les risques professionnels des mytiliculteurs et ostréiculteurs.
Ces mesures de prévention permettent aussi de participer au respect des exigences croissantes en termes de sécurité sanitaire des aliments.
Les principaux risques professionnels des conchyliculteurs
La conchyliculture, activité d'élevage d'huitres et de moules essentiellement mais aussi de coques, palourdes,... sur des champs marins et/ou dans des bassins, étangs, est un secteur économique en expansion, grâce en particulier à l'amélioration technique de production de naissain dans les écloseries.
Les élevages sur les parcs à huitres ou sur les zones de bouchots ou de tables se développent tout au long des cotes atlantiques et sur les étangs méditerranéens.
Les travaux de conchyliculture sont marqués par une nette division des tâches, entre le travail à l'extérieur à la mer ou sur les parcs ou les quais , et éventuellement sur les bassins (claires) pour l'affinage des huitres, et le travail à l'atelier ou l'entrepôt conchylicole, avec des emplois assez souvent saisonniers, pour le détroquage, le calibrage, le conditionnement et l'expédition.
Les conchyliculteurs sont grandement tributaires des aléas climatiques (tempêtes, forte houle, froid, soleil) et ont de fortes contraintes de travail liées aux horaires des marées et aux saisons, et sont ainsi soumis à des changements très fréquents d'emploi du temps et à des astreintes de travail de nuit, de week-end et de jours fériés.
De plus, l'entretien des bateaux et de tout le matériel est très exigeant du fait de l'environnement maritime corrosif et la rénovation rigoureuse des bassins (parage) et des installations d'élevage des coquillages est une préoccupation constante.
- Les risques du travail à l'extérieur des conchyliculteurs
Les conchyliculteurs travaillent sur l'estran (espace entre la basse et la haute mer) plus ou moins loin du rivage, c'est-à-dire à sec ou en eau profonde en fonction de la marée et du marnage (hauteur entre la basse et la haute mer). Les déplacements s'effectuent en barge ou bateau caractérisé par un fond plat, muni de grues pour la mytiliculture, pendant les périodes de vives-eaux ou en remorque tirée par un tracteur à marée basse, pour accéder aux bouchots, filières et tables des élevages de moules ou aux parcs à huitres.
Les naissains d'huitres peuvent être aussi élevés sur des parcs en eau profonde jamais découverts et des navires dragueurs hersent le fond pour donner une meilleure forme aux huitres et limiter l'envasement.
- La mécanisation croissante du métier de conchyliculteur, si elle entraine une moindre charge physique, comporte des risques mécaniques supplémentaires liés par exemple aux maniements de matériel de levage, d'une pêcheuse à moules, engin hydraulique constitué d'un tube enfilé sur bouchot (pieu enfoncé dans la vase ou le sable) : risques de coincements par exemple entre la barge et les pieux, de heurts avec des parties fixes ou mobiles, notamment les charges des grues, du fait des mouvements du navire, risques de fouettement ou de rupture des cordages et câbles sous tension, risques de chutes de plain-pied suite à des glissades ou à des trébuchements sur des sols humides et/ou encombrés, avec éventuellement chute par-dessus bord et risque de noyade.
Tous ces dangers sont à l'origine de nombreuses lésions physiques cutanées et/ou ostéo-articulaires : foulure, entorse, contusions, plaies cutanées et hémorragies, fractures.
- Le métier de conchyliculteur comporte encore une part très importante de manutentions lors du travail à la mer : le détroquage des huîtres, la mise en poche et leur retournement, le déchargement et chargement des poches, l'installation et l'enlèvement des tables et des filières, les transferts des cordes…Le détroquage (décollage des huîtres de leurs supports collecteurs et séparation des petites huitres) est un travail long qui crée des vibrations dans les membres supérieurs.
Les conchyliculteurs figurent ainsi parmi les métiers les plus concernés par les troubles musculo-squelettiques (TMS), c'est-à-dire les affections péri-articulaires provoquant des douleurs des poignets (syndrome du canal carpien), des coudes (épicondylite, épitrochléite), des épaules (tendinites des bras tendus) et des lésions chroniques de la colonne vertébrale de la position penchée et/ou en torsion (cervicalgies, lombalgies).
Le vieillissement progressif des structures ostéoarticulaires peut aboutir à une inaptitude professionnelle, ce qui, de par leur fréquence et leur impact, tant médical que socioprofessionnel, constitue un problème majeur de santé au travail pour les conchyliculteurs : le risque total dépend de tous les facteurs (vibrations, élongations, torsions…) en instantané, mais aussi de la totalité des effets reçue au cours de la journée de travail et de la vie professionnelle.
Les risques de neuropathies par transmission des vibrations au bras se manifestent par la perte de dextérité manuelle, la diminution tactile des doigts, des fourmillements dans les mains intermittentes ou persistantes.
- Les risques d'atteintes du rachis par les vibrations des tracteurs et remorques sont fréquents : les nombreuses contraintes posturales dues au travail sur sol accidenté, l'exposition quotidienne due aux vibrations transmises à l'ensemble du corps sont préjudiciables à la santé de l'ostréiculteur : les troubles vertébraux sont provoqués par les forces compressives et de cisaillement répétées principalement aux jonctions dorsolombaires et lombo-sacrées. Il en résulte des lombalgies, cruralgies, cervicalgies, sciatiques par hernie discale … Il faut aussi compter sur les traumatismes (entorses, …) suite à une chute lors de la descente de l'engin.
- Le travail en extérieur conduit le conchyliculteur à être exposés aux ultraviolets (UV), aux intempéries, au froid ou à la chaleur, et à l'humidité. Ces conditions climatiques variables (chaleur, pluie, vent) accentuent les risques liés aux postures de travail contraignantes et ne permettent pas de travailler en toute sécurité.
L'exposition fréquente aux UV peut être responsable de cancers de la peau, d'ophtalmies (brûlure de la cornée) particulièrement en mer, et, en tout cas, d'érythème solaire (coup de soleil).
Les problèmes de santé dus à la chaleur et à l'action prolongée du rayonnement solaire sur la tête (effets de l'insolation, de la déshydratation…) génèrent des risques de malaise général, de crampes musculaires, de pertes de connaissance, qui peuvent être vitaux dans les cas extrêmes (coup de chaleur). Indirectement, le travail par fortes chaleurs augmente aussi les risques d'accidents du travail par la fatigue, la sudation, la diminution de la vigilance.
Le risque lié au froid est accru par une exposition au vent (refroidissement éolien) et à l'humidité. Le refroidissement des parties du corps peut provoquer des engelures, lésions cutanées qui deviennent rouge violacées, douloureuses, avec des crevasses et/ou des phlyctènes. Les mains et les pieds (surtout doigts ou orteils) ont tendance à se refroidir plus rapidement que le torse : l'exposition au froid est susceptible de déclencher le syndrome de Raynaud (doigts blancs et douloureux par vasoconstriction). Comme pour la chaleur, le froid entraine des risques indirects, favorisés par la diminution de la dextérité due au refroidissement des extrémités, à la diminution des performances musculaires et à l'incapacité à effectuer des mouvements fins. La vigilance mentale est également réduite en raison de l'inconfort causé par le froid.
- Les risques du travail à l'entrepôt des conchyliculteurs
Les travaux de triage, de calibrage et de conditionnement (remplissage des bourriches, étiquetage) et d'expédition (mise sur palette) exigent une gestuelle répétitive et rapide constitutive de risques de troubles musculo-squelettiques fréquents : par exemple,
- les opérations de tri sur le tapis roulant et de jet dans un bac, impliquent de très nombreux gestes avec posture penchée, rotation du corps et déplacement qui augmentent la pénibilité du travail. Il en est de même pour le transfert des huitres de la manne dans les bourriches.
- La fixation des étiquettes à l'aide d'agrafes nécessitent un mouvement de bras avec répétition de chocs sur le talon de la main qui entraine des déficiences de l'apport en sang dans les doigts et des caillots ou une dilatation au niveau des artères digitales.
Le travail dans les ateliers de conchyliculture expose aussi à de nombreuses sources de traumatismes cutanés. La main est la partie du corps la plus sollicitée et donc la plus atteinte, mais des plaies ouvertes des membres supérieurs, des corps étrangers dans l'œil, sont aussi des risques de traumatismes fréquents.
- Les coupures avec les instruments à main tranchants (couteau à détroquer…), ou avec les coquilles, avec surinfection fréquente. Les fruits de mer peuvent être porteurs d'agents pathogènes pour l'homme et leur manipulation peut entrainer des risques d'allergies aux protéines animales, des risques septiques ou liés à des toxines spécifiques lors de coupures ou en manutentionnant des déchets. La fréquence des infections secondaires de blessures cutanées par des germes pathogènes contenus par exemple dans les déchets, les eaux de nettoyage… est élevée (panaris des doigts …). On peut noter aussi une contamination transcutanée par contact direct des muqueuses oculaires en cas de projections accidentelles ou manuportée par frottement des yeux.
- Les blessures provoquées par l'utilisation de machines (cercleuse, …) ou équipements de travail (convoyeurs, compacteur à déchets…). Certaines parties des machines, les opérations de nettoyage et de maintenance, les réglages, les démarrages sont sources d'accidents du fait des pièces en mouvement et des organes de transmission de la puissance (courroies…) : en particulier lors des mises en marche intempestives, des arrêts anormaux suite à un bourrage ou à une rupture d'énergie : coupures aux mains, lacérations des avant-bras ou écrasements lors des nettoyages par exemple, ou lors des déplacements des éléments mobiles des machines, frictions, coincements…
- Les agressions chimiques cutanées par contact avec des produits de nettoyage et de désinfection des outils, locaux et surfaces de travail, chambres froides… Toutes les opérations d'entretien et de nettoyage font appel, pour débarrasser des surfaces inertes (sols, murs, plans de travail, …) de toutes souillures visibles et inactiver ou tuer les micro-organismes présents, à des agents détergents, désinfectants, décapants, détartrants qui utilisent souvent des produits chimiques très agressifs susceptibles de provoquer des intoxications par inhalation ou absorption et des brûlures cutanées ou oculaires, ou des sensibilisations allergiques. Ces pathologies irritatives et/ou allergiques atteignent le plus souvent la peau (dermites, eczéma), suivies des atteintes des muqueuses oculaires (conjonctivite), nasales (rhinite) et bronchiques (asthme…). Par ailleurs, le chaulage des tuiles pour la capture des larves d'huîtres au sein des collecteurs, en enduisant les tuiles avec un mélange de chaux et de sable, expose la peau à des irritations en raison du caractère alcalin de la chaux.
- Les chutes de plain-pied par glissades du fait de sols souvent humides ou rendus glissant à la suite de salissures de déchets, ou par trébuchement sur des sols inégaux (carrelages défectueux…) ou encombrés entrainent de nombreuses lésions physiques cutanées et/ou ostéo-articulaires. Des chutes d'objets stockés en hauteur sur des racks ou des étagères, ou effondrements de palettes ou caisses mal empilées génèrent des fractures, traumatismes crâniens, écrasements des membres…
- Le chariot automoteur facilite les manutentions des palettes, des conteneurs ou des caisses et évite le port de lourdes charges, mais comporte aussi des risques de collision avec d'autres engins ou des piétons situés sur la trajectoire du chariot, de chute de la charge (principalement depuis les fourches) et de chute du marchepied en montant ou en descendant du chariot : les traumatismes induits sont d'autant plus fréquents que les aires de manœuvre sont généralement restreintes autour des ateliers des ostréiculteurs.
Les contraintes du travail de nuit, la possibilité des contacts avec des conducteurs électriques sous tension aggravée par le milieu humide, …complètent le tableau des risques de l'ostréiculteur ou du mytiliculteur.
Les travailleurs saisonniers en conchyliculture sont plus exposés aux risques de ces accidents du travail du fait du manque d'information de cette main d'œuvre, de formation et de connaissances des lieux et des procédés qui augmentent ainsi leur vulnérabilité.
Les mesures de prévention des risques des conchyliculteurs
Une organisation rationnelle des tâches, de bonnes méthodes de travail avec des outils et engins adaptés et bien entretenus, une bonne formation et le respect des règles d'hygiène sont nécessaires, mais insuffisantes compte tenu du caractère peu maitrisable du travail maritime et en milieu naturel et l'adoption de vêtements et accessoires de protection (casquettes, chaussures de sécurité, gants, pantalons anti-coupures, et selon les situations, cuissardes, équipement individuel de flottaison, etc.) s'avère indispensable.
Les ateliers de conchyliculture doivent faire l'objet d'une analyse poussée des risques pour permettre la rédaction du Document Unique de Sécurité en appréciant à la fois l'environnement matériel et technique (outils, machines, produits utilisés) et l'efficacité des moyens de protection existants et de leur utilisation selon les postes de travail et pour décrire les actions de prévention complémentaires à mettre en œuvre.
De manière aussi à ce que les salariés puissent être informés à propos des produits dangereux utilisés, les Fiches de Données de Sécurité (F.D.S.) doivent être mises à disposition et la connaissance de leurs risques expliquée au travers de la compréhension de leur étiquetage.
- La suppression / substitution des procédés les plus pénibles
De nouvelles techniques évitent le détroquage : élevage du naissain sur des collecteurs en plastique avec détachement précoce, achat de naissain d'huîtres à partir de larves produites en écloserie. - La prévention des risques du travail en mer ou sur l'estran
- Les déplacements sur remorque
Pour éviter que les ostréiculteurs ne soient déséquilibrés et chutent à l'intérieur ou soient projetés à l'extérieur lors des cahots, ils ne doivent pas être en position debout ou assis sur des poches ou des mannes retournées, mais assis sur des banquettes, et la remorque doit être munie des parois fixes ou amovibles.
Bottes, cuissardes, gants, manteau ostréicole, cotte tablier, manchettes, casquette font partie des équipements de protection individuelle nécessaires.
- Les déplacements sur bateau
Le navire doit être doté de tous les dispositifs de sécurité réglementaires et avoir été régulièrement contrôlé : zones de circulation avec revêtement antidérapant, mains courantes, filière de sécurité, canot de sauvetage, brassières, trajet des câbles et les cordages guidés et séparés des zones de circulation, appareils de levage conformes aux normes…
Les conchyliculteurs embarqués doivent disposer de bottes antidérapantes, de casques ou casquettes de protection, de cirés de marine (vareuses..), de gants imperméables et l'amélioration de la sécurité des personnes au travail passe par la protection personnelle permanente des vêtements de travail à flottabilité intégrée (VFI), assurée par de la mousse répartie dans l'ensemble du vêtement ou une vessie gonflable pliée dans l'enveloppe reliée à un dispositif de gonflage.
Des systèmes de fixation pour assurer la stabilité des masses embarquées (conteneurs, palettes…), pour minimiser le balan des dragues ou de charges soulevées à bord, pour bloquer les câbles et cordages sous tension, doivent être mis en œuvre.
Les machines bruyantes doivent être munies de capots insonorisants, et pour réduire les bruits transmis par les sols et les structures, des blocs anti-vibrations peuvent être placés entre la machine et la surface d'appui.
- Pour le travail au soleil, les travailleurs doivent se couvrir la tête, ne pas travailler torse nu et porter des sous-vêtements permettant l'évaporation de la sueur (le coton est à privilégier, le nylon est à éviter), sans toutefois négliger le port des équipements de protection individuelle, sont des mesures évidentes. Les travailleurs doivent porter une protection de la peau pour les parties du corps qui ne peuvent pas être couvertes, essentiellement le visage, les oreilles, le cou et la nuque, en appliquant largement une crème solaire sur la peau laissée à nu, et des lunettes de protection avec filtres pour l'ultraviolet pour assurer la protection oculaire.
- Pour le travail au froid, le port de protections individuelles contre le froid (pullover marin, grosses chaussettes, bonnet …) est indispensable.
- La prévention dans les ateliers de conchyliculture
- Les sols doivent être antidérapants et maintenus propres, secs et rangés pour éviter les chutes, avec dégagement des voies de passage. Il convient d'assurer l'entretien continu des locaux (nettoyage, élimination des déchets). Les inégalités de surfaces et/ou obstacles doivent être soit supprimés (bouchage des trous) ainsi que, si possible, les zones avec des différences de niveau, ou alors les munir de signalisation bien visible et moyens de protection (rampes, …). L'élimination de l'eau sur le sol nécessite d'écouler le fluide répandu sur la surface par un bon système d'évacuation et régulièrement nettoyé.
- Les glissades, les pertes d'équilibre sont souvent provoquées par un sol défectueux ou un trébuchement contre un obstacle non repéré.
On doit veiller à maintenir l'ordre dans tous les locaux et surtout dans les zones de stockage. Les voies de circulation doivent être débarrassées de tout obstacle. Il faut éviter les zones d'ombre en optimisant l'éclairage et signaler les escaliers, les dénivelés, les encombrements temporaires…
Les travailleurs doivent être équipés de chaussures de sécurité avec semelles antidérapantes (conformes à la norme générale EN 345 S2).
- L'installation électrique doit être conforme aux normes de sécurité électrique (norme NF C 15-100), ce qui est d'autant plus important si le travail s'effectue dans une atmosphère ou avec des mains humides. L'installation électrique (armoires électriques, fils et câbles, éclairage) doit être conforme aux normes de sécurité électrique, en particulier, la bonne mise à la terre doit être contrôlée, les prises de courant défectueuses remplacées, les prolongateurs et outils portatifs vérifiés… Un disjoncteur différentiel 30mA doit protéger le circuit électrique. Une liaison de terre équipotentielle doit relier toutes les parties métalliques présentes dans l'atelier.
- L'environnement de travail doit offrir un éclairage suffisant, dont il faut entretenir régulièrement les dispositifs (remplacement des tubes fluorescents et ampoules …), en particulier pour les postes de travail du tri exigeant un travail minutieux.
- Les postes de travail doivent être équipés d'aide à la manutention (transpalettes, chariots roulants, diables, poignées de préhension. Les conditionnements permettant de limiter les charges sont aussi un bon moyen de réduire les risques dorsolombaires.
- L'ergonomie et l'organisation du travail (par exemple les opérations de tri sur un tapis roulant) sont primordiale pour réduire la pénibilité du travail (par exemple, rapprocher le point de préhension pour éviter une posture penchée) et prévenir l'apparition de troubles musculo-squelettiques, ainsi que des accessoires tels les sièges « assis-debout » et tapis antifatigue. L'instauration d'un système de rotation des travailleurs permet de varier les gestes et postures. Les sièges et les plans de travail doivent être réglables en hauteur pour être appropriés ergonomiquement à la tâche à réaliser. De plus, l'apprentissage et le respect de gestes professionnels corrects sont aussi garants d'une prévention des TMS.
- Les outils du conchyliculteur doivent être choisis pour leur qualité technique et ergonomique : utilisation d'outils sécurisés (cutter à lame rétractable,…), couteaux régulièrement affilés, affutés et nettoyés, réparation ou suppression de tout outil défectueux.
- La protection individuelle des mains reste néanmoins indispensable : gants anti perforation et protège-bras (Norme NF EN 1082-1) contre les coupures et les coups de couteaux à main.
- L'élimination des déchets doit être correcte, c'est-à-dire dans un collecteur ou conteneur spécialement adapté afin d'éviter toute blessure ou contact potentiellement contaminant.
- Les équipements de stockage doivent être conçus et mis en place de manière à pouvoir supporter les charges (résistance et la stabilité des palettes et des rayonnages métalliques) et à empêcher la chute des objets des étagères. Ils doivent par ailleurs être facilement accessibles et à faible hauteur, bien fixés au sol et munis de sabots de protection.
- La prévention des risques chimiques des produits détergents et désinfectants
L'hygiène rigoureuse des locaux et du matériel exige l'emploi d'agents détergents et désinfectants (alcools, lessives, décapants, éthers de glycols…). Des mesures de prévention sont indispensables pour la manipulation de ces produits agressifs, particulièrement lors de la dilution des produits concentrés. La prévention première consiste à substituer les produits désinfectants dangereux par des produits moins agressifs.
La mise en place d'une protection individuelle est nécessaire, puisque la manipulation et le contact avec ces produits de nettoyage restent indispensables.
C'est ainsi que le port d'équipements de protection individuels (EPI) s'impose pour réduire le plus possible l'exposition aux agents chimiques nocifs des détergents et désinfectants, notamment lors des transvasements ou de dilution : il s'avère indispensable de porter des gants de protection adaptés à la tâche effectuée et au produit manipulé. Il n'existe pas de gant de protection universel. Le type de gants conseillé, imperméables, à longues manchettes, pour éviter la pénétration des produits à l'intérieur, doit être adapté aux différents produits utilisés selon leur composition qui figure sur la Fiche de Sécurité (FDS).
Le port de lunettes de protection évite les lésions par projections de produits de nettoyage (mais aussi de matières dont les éclats de coquilles).
Ces produits doivent être stockés dans un local spécifique. - Le respect des règles d'hygiène
- La tenue vestimentaire dans l'atelier de conchyliculture
De manière à ce que le personnel ne soit pas en contact avec le produit, une tenue est obligatoire en agro-alimentaire, car elle évite la contamination qui pourrait venir des habits de ville. La tenue doit couvrir le corps et les bras (blouse, combinaison, tablier imperméable …).
- Les vestiaires
Dans le domaine de l'hygiène, les vestiaires et les sanitaires doivent faciliter les pratiques d'hygiène corporelle, être d'un entretien facile, être aménagés de façon à isoler explicitement des zones spécifiques et être adaptés au nombre de salariés.
Des vestiaires doubles appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs car ceux-ci doivent porter des vêtements de travail spéciaux : l'entreposage des tenues de travail doit avoir lieu à l'abri de la poussière et des souillures et le rangement des tenues de ville et des tenues de travail doit être séparé ; il est primordial d'avoir un lieu de rangement pour le linge propre, et un autre pour le linge sale et d'avoir des équipements permettant le séchage des tenues de travail (séche-bottes, séche-gants…).
Des lavabos, postes de rinçage oculaire et des douches de sécurité doivent se trouver à proximité des postes de travail. Celles-ci permettent les mesures d'hygiène générale : lavage des mains fréquent avec moyens adaptés, douche en fin de poste... En effet, le respect des règles d'hygiène s'étend aux comportements individuels : ne pas avoir les mains sales afin de ne pas ingérer par inadvertance un produit toxique et ne pas manger sur le lieu de travail.
- L'hygiène des mains
Le port de gants ne remplace pas le lavage des mains.
Le lavage des mains avec un savon neutre est indispensable après tout contact avec des souillures, avant chaque pause, etc.…
Il est également conseillé à l'utilisateur de se laver les mains à l'eau claire après chaque utilisation des gants et d'utiliser les gants avec des mains sèches et propres.
Le lave-mains à commande non manuelle est nécessaire (au genou, au coude, électronique).
Il existe par ailleurs également des distributeurs de savon ou solution désinfectante à commande non manuelle, faciles à installer, simples à utiliser.
- L'entretien des locaux
Une bonne tenue des sols des locaux par un procédé à l'humide (jet d'eau ou système eau/vapeur), est essentielle pour éviter l'accumulation de déversements, de déchets et de poussières sous ou autour des postes de travail. Les déversements peuvent créer un danger de glissement et par conséquent doivent être nettoyés immédiatement.
- Les premiers secours
Les consignes en cas d'accident (n° d'appel d'urgence, conduite à tenir, identification des services de secours) doivent être visiblement affichées.
Une trousse complète contenant un matériel de premiers secours non périmé (solutions antiseptiques, pansements,…), aisément et rapidement accessible, doit être mise à la disposition du personnel ; toute blessure cutanée doit immédiatement être désinfectée et pansée.
Des extincteurs doivent être disponibles en nombre suffisant et vérifiés annuellement.
- La vaccination préventive contre Diphtérie Tétanos Polio doit être à jour (tous les 10 ans).
- Des mesures de formation aux risques
La multiplicité, la fréquence et la gravité des accidents du travail dans les métiers de la conchyliculture nécessitent d'entreprendre des actions de sensibilisation et de formation des travailleurs à la sécurité.
En particulier, pour le personnel saisonnier, des séances minimales d'information sur les risques et les moyens de les prévenir (notamment pour les dorsalgies, tendinites, coupures, projections oculaires…) doivent être organisées, à la fois dans le cadre de leur intégration, puis lors d'un suivi particulier et d'un encadrement adapté à leur profil.
- Les conchyliculteurs embarqués doivent savoir nager, avoir suivie une formation technique de survie en mer, sur les techniques d'élingage.
- Les treuillistes, les conducteurs de chariots doivent disposer des brevets et formations nécessaires (CACES)
- Formation du personnel sur les dangers des produits utilisés et sur les moyens de se protéger (par exemple savoir lire attentivement l‘étiquette du contenant des produits et connaître les symboles présents sur les récipients, utiliser les E.P.I adéquats),
- Formation sur les premiers secours pour pallier les conséquences d'un éventuel accident de travail
- Formation PRAP (Prévention des Risques liés à l'Activité Physique) pour prévenir les risques liés aux manutentions manuelles. Il s'agit d'apprendre les bonnes postures de travail, les positions articulaires adéquates, en appliquant les principes de base de sécurité physique et d'économie d'effort.
- Formation à la mise en œuvre et à l'utilisation des équipements de protection individuelle.
- Formation aux règles d'hygiène, nettoyage-désinfection
Septembre 2012
Partagez et diffusez ce dossier
Laissez un commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.