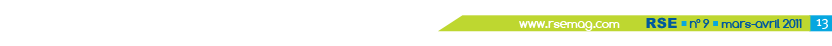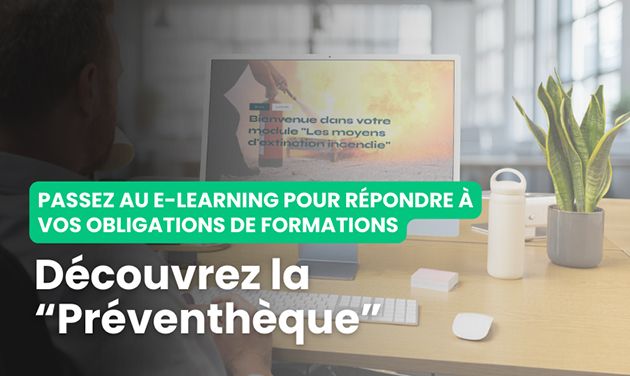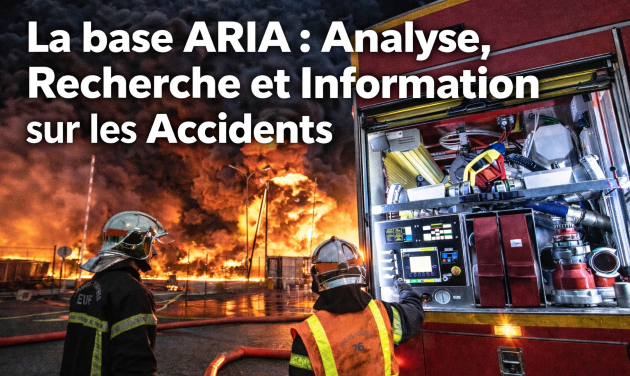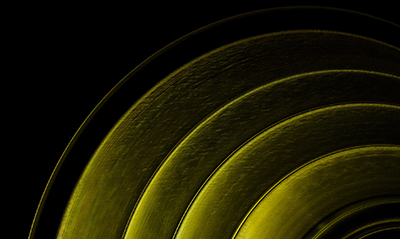Petite histoire des simulateurs d'entraînement dans l'aéronautique
L'industrie de l'aéronautique a été l'une des premières à concevoir et développer des simulateurs d'entraînement. « Survol » des réalisations et des évolutions par l'un des pionniers du domaine : Hugh Dibley est commandant de bord, membre du Royal Aeronautical Society Flight Simulation Group et instructeur en vol d'Airbus Training UK Ltd.
Les premiers simulateurs et leurs limites
Un des premiers simulateurs jamais construit spécifiquement pour l'entraînement des pilotes en France, si ce n'est le premier, a été celui fabriqué pour l'Antoinette. Le pilote disposait de deux volants de chaque côté. Le premier contrôlait le tangage de l'appareil, un mouvement auquel étaient naturellement exposés les avions. Le second contrôlait le mouvement de lacet de droite à gauche. La difficulté liée à la manoeuvre de ces volants a sans doute fait qu'un entraînement important était nécessaire pour en maîtriser les effets. Plus tard, le système alliant manche à balai et gouvernail de profondeur permit de faire évoluer l'appareil dans la direction indiquée par ces commandes. Ce système est encore utilisé aujourd'hui.
Le développement des simulateurs se poursuivit jusqu'à la mise au point de machines capables de restituer les sensations auxquelles le pilote d'un chasseur américain de 1932 pouvait s'attendre. Mais bien que ces systèmes aient été pensés pour favoriser la maîtrise de leurs appareils par les pilotes, l'entraînement au moyen d'avions à double commande restait encore un dispositif d'entraînement plus efficace.
La persistance d'accidents en condition de vol sans visibilité restait toutefois un problème. La Blue Box d'Edwin Link, apparue en 1929 pour remédier à ce problème, a ainsi été le premier vrai simulateur de vol. Elle connut un grand succès à partir de 1934, propulsée commercialement par une série d'accidents tragiques dans l'armée américaine. La Blue Box s'est révélée extrêmement efficace. La manoeuvre des commandes par le pilote entraînait des soufflets installés sous la machine. Ceux-ci reproduisaient les mouvements de tangage et de roulis, qui sont les plus ressentis par les apprentis pilotes, avant même les stimuli visuels. La Blue Box recréait également les bruits de moteur et était équipée d'un enregistreur de données pour alimenter les débriefings. Les conditions ainsi recréées étaient remarquablement similaires à celles que les pilotes pouvaient rencontrer en situation réelle de vol dans les nuages, aux instruments.
Les ventes de la Blue Box se poursuivirent après la Seconde Guerre mondiale. En 1946, l'entraînement au moyen du simulateur d'Edwin Link coûtait 250 fois moins qu'un entraînement basé sur des vols réels. Plus de 10 000 Blue Box furent vendues dans le monde et certaines étaient encore utilisées dans les années 1970.
La multiplication rapide du nombre de types d'appareils a ensuite imposé le développement de nouveaux simulateurs.
Contrairement à la Blue Box qui était un simulateur général, les nouveaux simulateurs devaient être spécifiques à un type d'avion. En effet, il était devenu nécessaire de mener des sessions d'entraînement de transition vers un nouveau type d'appareil, ainsi que les sessions semestrielles d'entraînement régulier. Ces simulateurs, reproduisant un type de machine particulier, ont commencé à être construits dans les années 1950.
Ils reproduisaient exactement la disposition des cockpits d'avions en service pour garantir le réalisme de la formation.
Mais la faible puissance des outils informatiques empêchait une reproduction réaliste du comportement des appareils. Les procédés de restitution physique ne permettaient que de faire tanguer l'avion. Enfin, la restitution de l'environnement visuel était assurée par des caméras de télévision qui filmaient des modèles réduits d'aéroports. Ces installations occupaient souvent des espaces importants de la taille d'un hangar à avions.
L'augmentation de la complexité de ces simulateurs a toutefois eu un effet pervers : les techniciens étaient parfois plus capables de « piloter » que les pilotes euxmêmes.
Ainsi, durant le développement de la Caravelle, les crashs à l'atterrissage sur simulateur étaient très fréquents, même pour des pilotes d'essai. La raison était que les simulateurs des années 1960 ne reproduisaient pas fidèlement le comportement des appareils, nécessitant la tenue de configurations de vol très particulières auxquelles un pilote n'a pas recours en conditions réelles.
Ces simulateurs analogiques avaient pour fonction d'assurer les tests de compétence semestriels des pilotes. En revanche, des situations comme la panne de moteur au décollage ou l'atterrissage sans moteur devaient être pratiquées une fois par an en conditions réelles sur l'avion concerné pour pour que le pilote puisse conserver ses qualifications. Certaines phases des entraînements de transition nécessitaient de réaliser des manoeuvres réelles, imposant des contraintes fortes sur les pneus, les freins ou les moteurs, induisant des coûts de maintenance considérables. L'entraînement à haute altitude était également un facteur d'augmentation de ces coûts et pouvait également conduire à une fatigue plus rapide de la structure de l'appareil. Le prix du carburant, l'encombrement du trafic aérien ainsi que les taxes d'atterrissage et l'immobilisation d'un avion exploitable commercialement s'ajoutaient à ces contraintes. Mais surtout, les risques liés à cet entraînement en situation réelle sont plus élevés que ceux rencontrés dans le cadre des vols commerciaux. Tous ces éléments ont ainsi conduit au développement de simulateurs réalistes, complets et basés sur l'utilisation d'outils électroniques et informatiques.
L'apparition des simulateurs numériques
Les systèmes de simulation visuels ayant recours aux images de synthèse ont ainsi remplacé les caméras de télévision. Les nouveaux simulateurs ont permis d'augmenter à la fois le détail des paysages et l'étendue de l'environnement visible depuis le cockpit. Les systèmes de restitution physique liés à ces outils étaient installés sur des plateformes hexapodes à vérins. Les constructeurs aéronautiques ont contribué à la qualité de ces installations en fournissant des données qui, ajoutées à l'expérience des pilotes, ont permis aux constructeurs des simulateurs de fabriquer des machines au comportement très proche de celui des avions.
L'augmentation de la complexité de ces simulateurs a toutefois eu un eff et pervers : les techniciens étaient parfois plus capables de « piloter » que les pilotes eux-mêmes
Les constructeurs de simulateurs ont de plus en plus souvent inclus les derniers développements technologiques sur leurs modèles les plus récents afin de les proposer ensuite aux compagnies aériennes. En parallèle, les opérateurs aériens ont cherché à obtenir des certifications pour ces installations par les autorités publiques en charge de la régulation du secteur (DGAC, FAA, UKCAA) tout en souhaitant voir réduire les contraintes en termes d'entraînement en conditions réelles. Une forte hétérogénéité entre pays et institutions en a résulté. Certains autorisaient la transition entre deux types d'appareils uniquement après une formation sur simulateur tandis que d'autres persistaient à exiger un entraînement minimal en conditions réelles, avec par exemple au moins trois décollages et atterrissages par pilote. Une unification des standards et des pratiques était devenue nécessaire.
En 1992, le Flight Simulation Group de la Société royale aéronautique du Royaume-Uni1 a publié le document fondateur de l'ICAO2 9625, intitulé Manual of Criteria for the Qualification of Flight Simulation Devices3. Ce texte est devenu le standard international en termes de qualification des simulateurs de vol à usage commercial, bien qu'il ne couvre pas en détail l'ensemble des types de simulateurs. Par conséquent, ce groupe de travail a lancé en 2005 un projet visant à établir un standard intégrant l'ensemble des simulateurs existant. Le travail a commencé par la définition des différentes étapes nécessaires à la qualification d'un pilote de ligne et la création de spécifications pour le développement de simulateurs permettant d'assurer ces formations de base. Ce travail a représenté un changement majeur puisque la situation précédente permettait aux constructeurs de simulateurs de développer leur propre outil sans nécessairement tenir compte de son adéquation avec la tâche visée.
Les composants principaux d'un simulateur d'entraînement
L'ordinateur est l'élément central. Il gère les données entrantes et les intègre au modèle de vol fourni par le constructeur de l'appareil simulé. Il alimente en retour le simulateur et les systèmes de l'appareil. Le cockpit est aussi extrêmement important. Les équipages doivent en effet se sentir immergés dans un environnement réaliste, et le simulateur doit se comporter exactement comme l'appareil. C'est à cette condition que l'entraînement sera le plus efficace. L'exemple de la gestion d'alarmes se déclenchant de manière intempestive pendant la simulation illustre ce besoin de réalisme. Plusieurs événements critiques en vol réel ont été causés par l'acquittement erroné d'alarmes réelles, identiques à des signaux intempestifs survenus au cours de simulations. Quant au système de visualisation, les caméras projettent les images sur un écran incurvé. Les équipages ont ainsi la possibilité d'avoir un angle de vision large et qui respecte la perspective depuis les sièges du pilote et du copilote. Les simulateurs d'hélicoptères, quant à eux, sont parfois à l'intérieur de dômes, ce qui permet de reproduire une vision à 360 degrés. La qualité de l'image dépend du type d'appareil concerné.
Ainsi, simuler l'atterrissage ou le vol stationnaire d'un hélicoptère nécessite une grande précision dans la reconstitution du sol, voire des brins d'herbe, situé en dessous de l'appareil. Cette précision n'est pas nécessaire pour un avion de ligne dont le cockpit se situe à plusieurs mètres au-dessus du sol.
Le système de restitution physique doit quant à lui permettre d'approcher au mieux la réalité. Les plateformes actuelles peuvent reproduire des forces de l'ordre de 0,34 g sous un angle de 20 degrés.
Cette inclinaison est perçue comme une accélération du fait du fonctionnement de l'oreille interne du pilote.
La plateforme se remet ensuite en place à une vitesse imperceptible par le pilote pour être prête à reproduire l'accélération suivante. Enfin, la salle de contrôle du simulateur permet à l'instructeur de contrôler la session et d'en dérouler le scénario.
Le champ de la simulation dans le secteur de l'aéronautique est vaste. Les innovations ne cessent de nous proposer des outils particulièrement remarquables et aptes à satisfaire des attentes en termes de formation toujours plus exigeantes aux regards des impératifs de fiabilité et de sécurité. D'autres domaines industriels se sont ouverts à cette pratique, et c'est tant mieux !
(Traduction : Guillaume Desmorat, doctorant au CRC)
1. UK Royal Aeronautical Society.
2. International Civil Aviation Organisation.
3. Manuel de critères pour la qualification des appareils de simulation de vol.
Partagez et diffusez ce dossier
Laissez un commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.